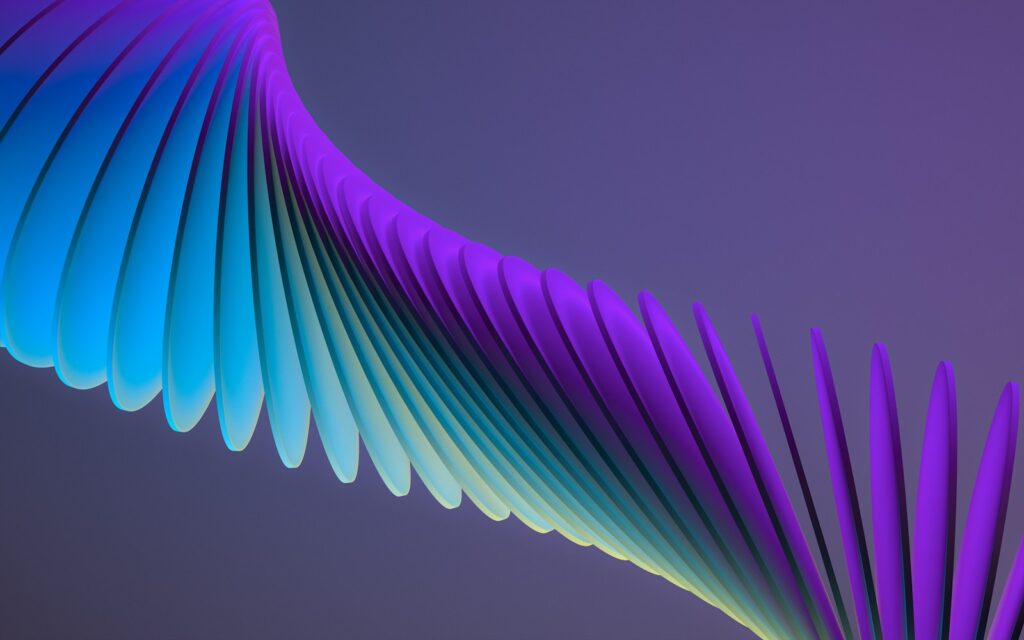Dans l’obscurité d’une chambre d’hôpital psychiatrique, un homme attend la décision du juge des libertés, une situation qui soulève des questions sur la responsabilité de l’État et de ses magistrats. Au même moment, une famille demande réparation pour un accident causé par un véhicule de l’administration. Ailleurs, une personne conteste un refus de certificat de nationalité française. Ces situations partagent un point commun : l’Agent judiciaire de l’État (AJE) y joue un rôle central.
Les hospitalisations psychiatriques sans consentement
Le régime des soins psychiatriques sans consentement a connu un bouleversement majeur avec la loi du 5 juillet 2011, renforçant le contrôle judiciaire. Cette loi a remplacé les termes d’« hospitalisation » par « soins », instauré la procédure de Soins Psychiatriques en cas de Péril Imminent (SPI) et surtout, transféré la quasi-totalité du contentieux au juge judiciaire à partir du 1er janvier 2013.
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique dispose désormais : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. » Ce principe s’inscrit dans le cadre plus large de la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice.
Pour les contentieux antérieurs à 2013, le dualisme juridictionnel persiste. Le juge judiciaire apprécie la nécessité et le bien-fondé de la mesure d’internement tandis que le tribunal administratif contrôle sa régularité formelle.
En matière de contentieux, plusieurs principes clés s’appliquent :
- Bien-fondé de la mesure : Le juge recherche si l’arrêté préfectoral est justifié par les circonstances de fait. Le préjudice réparé peut être moral ou matériel.
- Notification de l’arrêté : Exigence essentielle conforme à l’article 5§2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le défaut de notification ouvre droit à indemnisation.
- Motivation des décisions : L’arrêté préfectoral doit s’appuyer sur un certificat médical circonstancié et énoncer précisément les circonstances justifiant les soins.
La Cour de cassation a clarifié en 2015 le partage des compétences : le certificat médical doit décrire les troubles psychiques avec précision tandis que le préfet apprécie leurs impacts sur la sûreté des personnes ou l’ordre public.
Les hospitalisations à la demande d’un tiers (SDT) ou en péril imminent (SPI) relèvent d’une autre logique. Prononcées par le directeur d’établissement de santé, elles engagent rarement la responsabilité de l’État, sauf si le préfet informé n’a pas examiné la situation en temps utile.
Responsabilité pour dommages causés par un véhicule
La loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 a unifié le contentieux des dommages causés par les véhicules administratifs en attribuant compétence exclusive aux tribunaux judiciaires, appliquant les règles du droit civil, illustrant ainsi le rôle de l’État en tant que sujet de droit.
Cette loi instaure un mécanisme original : la substitution de responsabilité. La personne publique se substitue à son agent auteur du dommage, garantissant aux victimes l’indemnisation par une entité solvable.
Trois notions fondamentales structurent ce contentieux :
- La notion de véhicule est interprétée largement comme tout engin capable de se mouvoir par un « dispositif propre ». Peu importe qu’il soit terrestre, maritime ou aérien. Les engins de travaux publics sont concernés même à l’arrêt.
- La cause génératrice du dommage détermine la compétence. Lorsqu’un véhicule est impliqué, le juge recherche s’il a été la cause déterminante de l’accident.
- L’exercice des fonctions : L’agent doit avoir agi dans l’exercice de ses fonctions pour que la responsabilité de l’État soit engagée.
Une évolution jurisprudentielle notable concerne les accidents de service. Le Tribunal des conflits a précisé dans sa décision « Belhafiane » du 16 novembre 2015 que la juridiction judiciaire reste compétente lorsque l’agent public victime choisit explicitement d’agir sur le fondement de la loi de 1957.
Contentieux de l’état civil et de la nationalité
Le contentieux de l’état civil relève du juge judiciaire, gardien de l’état des personnes selon l’article 29 du Code civil. Ce domaine, où l’AJE n’intervient que lorsqu’une demande indemnitaire est formulée, s’inscrit dans les contentieux spécifiques où l’État peut être appelé à répondre de ses actions.
Plusieurs types de demandes peuvent survenir :
- Délivrance de passeport : Le juge judiciaire est incompétent sauf voie de fait. Le refus de passeport sans justification légale constitue une atteinte à la liberté d’aller et venir.
- Certificat de nationalité française : Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires, son refus peut engager la responsabilité de l’État pour faute lourde ou déni de justice.
- Actes d’état civil à l’étranger : L’article 47 du Code civil prévoit leur validité sauf preuve contraire. Le Service central d’état civil de Nantes intervient pour les transcriptions contestées.
Pour ces contentieux, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de Nantes, siège du Service central d’état civil, qui exerce ses fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
Contentieux des tutelles
La loi du 5 mars 2007 a profondément réformé les régimes de protection des majeurs et modifié le régime de responsabilité de l’État.
L’article 412 du Code civil pour les mineurs et l’article 422 pour les majeurs instaurent un régime dérogatoire : la responsabilité de l’État peut être engagée pour une faute simple commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle.
Cette faute peut concerner :
- La surveillance insuffisante des comptes
- L’inopportunité de certaines modalités d’organisation de la tutelle
- L’absence d’autorisation appropriée pour des actes de disposition
La jurisprudence exige un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Ainsi, le TGI d’Orléans a condamné l’État lorsque le juge des tutelles n’avait pas dessaisi rapidement un administrateur légal défaillant, contribuant aux détournements de fonds.
Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la majorité du mineur ou de la fin de la mesure pour les majeurs. Cette action n’est ouverte qu’à la personne protégée, son représentant légal ou ses ayants droit.
Ces contentieux spécifiques montrent la diversité des interventions de l’AJE pour défendre l’État. La complexité de ces procédures et l’évolution constante de la jurisprudence rendent indispensable l’accompagnement par un avocat spécialisé dans les litiges avec l’État.
Pour toute question concernant une procédure mettant en cause la responsabilité de l’État, notre cabinet propose un premier rendez-vous d’évaluation pour examiner les particularités de votre situation et déterminer la stratégie la plus efficace.
Sources
- Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
- Code de la santé publique, article L. 3216-1
- Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 relative au contentieux de la responsabilité des personnes publiques
- Tribunal des conflits, 16 novembre 2015, Belhafiane, n° C4035
- Code civil, articles 29, 47, 412 et 422
- TGI Orléans, 12 juin 2019, RG n° 15/00083
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
- Cour de cassation, 1re Civ., 28 mai 2015, n° 14-15.686