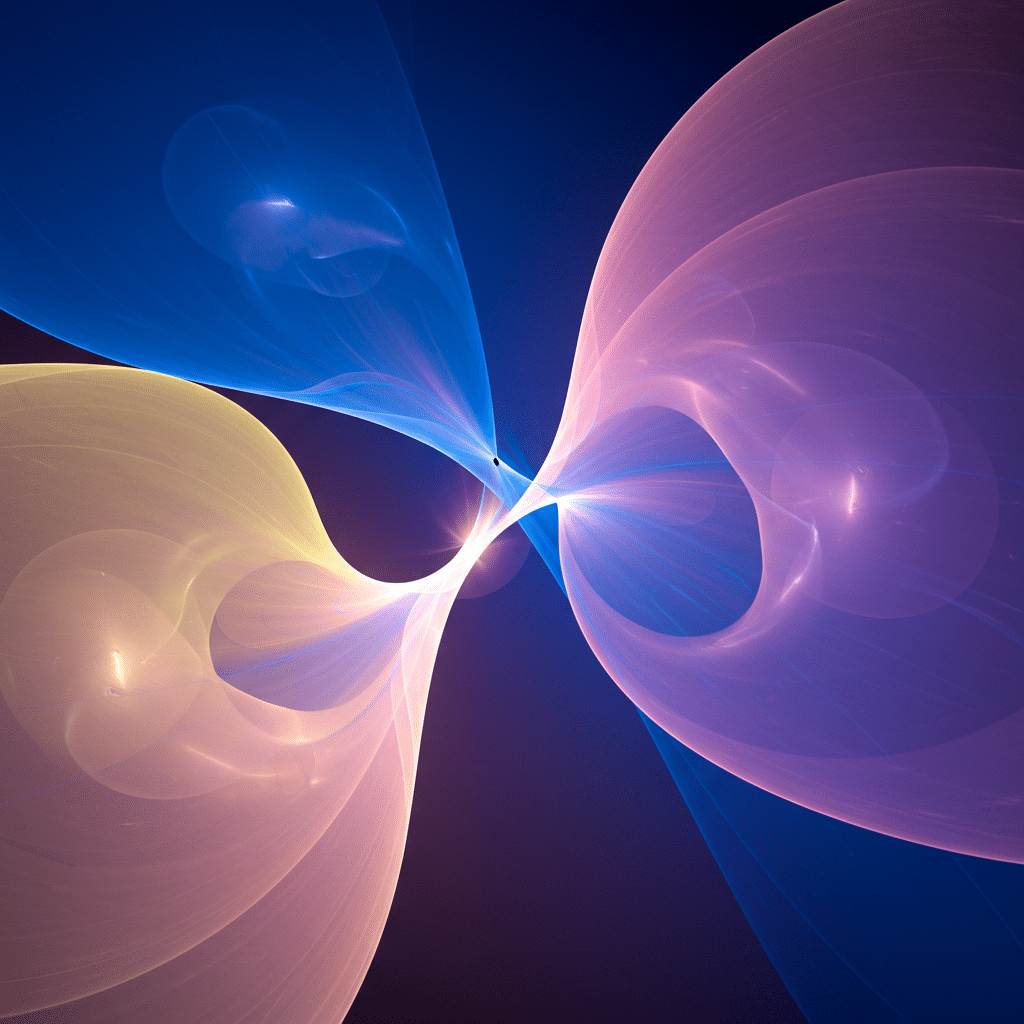« `html
Dans l’ombre des tribunaux se jouent des affaires où l’État est appelé à répondre de ses actes. Ces contentieux particuliers, où la puissance publique doit rendre des comptes pour son activité régalienne, dessinent les contours d’un droit d’exception. Voici un décryptage des principaux contentieux gérés par l’Agent judiciaire de l’État (AJE).
La voie de fait : quand l’administration dépasse les bornes
La théorie de la voie de fait, née au XIXe siècle, vise les situations où l’administration commet une irrégularité si grave qu’elle sort du champ administratif pour tomber sous la compétence du juge judiciaire.
Cette théorie a connu un tournant majeur avec l’arrêt « Bergoend contre ERDF » du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 qui a resserré sa définition. Désormais, la voie de fait n’existe que dans deux cas :
« L’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété » ou une « décision manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir de l’administration » avec les mêmes effets.
La Cour de cassation applique strictement cette nouvelle définition. Elle l’a notamment fait dans plusieurs affaires récentes :
- Un arrêt du 13 mai 2014 concernant le droit de propriété
- Un arrêt du 15 octobre 2014 précisant l’application aux atteintes au droit de propriété
- Un arrêt du 18 janvier 2018 sur l’extinction d’un droit de propriété
La jurisprudence exige que les deux conditions soient cumulatives : une irrégularité grossière ET une atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété.
Le dysfonctionnement du service public de la justice
L’abandon du principe d’irresponsabilité de l’État pour la justice judiciaire a été consacré par la loi du 5 juillet 1972, codifiée à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ce texte dispose que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice« .
Qui peut agir? Initialement, seuls les usagers effectifs du service public de la justice pouvaient engager une action. La jurisprudence a progressivement élargi cette notion:
- D’abord aux personnes directement concernées par la procédure, même sans être parties à l’instance
- Puis aux ayants droit de l’usager, notamment par deux arrêts du 16 avril 2008
- Et enfin aux victimes par ricochet dans certaines circonstances
La faute lourde a connu une évolution jurisprudentielle majeure. Depuis un arrêt d’assemblée plénière du 23 février 2001, la définition subjective (« faute tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eût pas été entraîné« ) a été abandonnée au profit d’une définition objective: « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi« .
Le déni de justice s’entend notamment du délai déraisonnable pour statuer sur les prétentions d’un justiciable, selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Incidents survenus lors d’opérations de police judiciaire
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour traiter des cas d’opérations de police judiciaire entrant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, selon l’arrêt GIRY de la Cour de cassation du 23 novembre 1956.
La distinction entre police administrative et police judiciaire est cruciale:
- La police administrative a une finalité préventive (maintien de l’ordre)
- La police judiciaire a une finalité répressive (recherche d’infractions)
Le critère complémentaire dégagé par le Tribunal des conflits est celui de la « cause déterminante du préjudice » (arrêt « Société Le Profil » du 12 juin 1978).
Même en matière de police judiciaire, la responsabilité de l’État n’est engagée que pour une faute lourde.
En cas de faute personnelle de l’agent détachable du service, la responsabilité de l’État n’est pas engagée. La Cour de cassation a précisé qu’un « comportement qui a le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions » s’illustre par des « actes de brutalité et de violence inutiles » et non par « l’emploi de la force inhérente à l’exercice des fonctions de police » (arrêt du 10 février 2009).
Indemnisation des détentions provisoires injustifiées
L’article 149 du code de procédure pénale prévoit la réparation intégrale du préjudice subi du fait d’une détention dans une procédure terminée par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
La requête doit être déposée dans les six mois de la décision définitive. Ce délai préfix ne peut faire l’objet d’aucune régularisation (Commission nationale de réparation des détentions, 12 octobre 2000).
Sont exclues du bénéfice de l’indemnisation les situations où:
- La décision a pour seul fondement la reconnaissance d’une irresponsabilité pénale
- La décision résulte d’une amnistie postérieure à la mise en détention
- La prescription de l’action publique est intervenue après la libération
- La personne était détenue pour une autre cause
- La personne s’est librement accusée pour faire échapper l’auteur des faits
La faute du requérant peut limiter l’indemnisation. La Commission nationale de réparation des détentions a établi que les « déclarations contradictoires et mensongères » peuvent être considérées comme ayant contribué à la réalisation du dommage (décision du 6 juillet 2000).
Seuls les préjudices matériel et moral directement liés à la privation de liberté sont indemnisables. Les préjudices subis par les proches (victimes par ricochet) ne sont pas pris en compte.
Pour faire valoir vos droits dans ces contentieux complexes, une analyse juridique approfondie est indispensable. Le cabinet est à votre disposition pour évaluer votre situation et déterminer la stratégie la plus adaptée.
Sources
- Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile
- Article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire
- Arrêt du Tribunal des conflits, 17 juin 2013, « Bergoend contre ERDF », n° C3911
- Cour de cassation, assemblée plénière, 23 février 2001, n° 99-16.165
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 novembre 1956, « GIRY », n° 56-11.871
- Article 149 et suivants du code de procédure pénale
- Commission nationale de réparation des détentions, décisions du 12 octobre 2000 (00 IDP 27) et du 6 juillet 2000 (99 IDP 076)
- Tribunal des conflits, 12 juin 1978, « Société Le Profil », Lebon 649
- Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2009, n° 08-84.339
« `