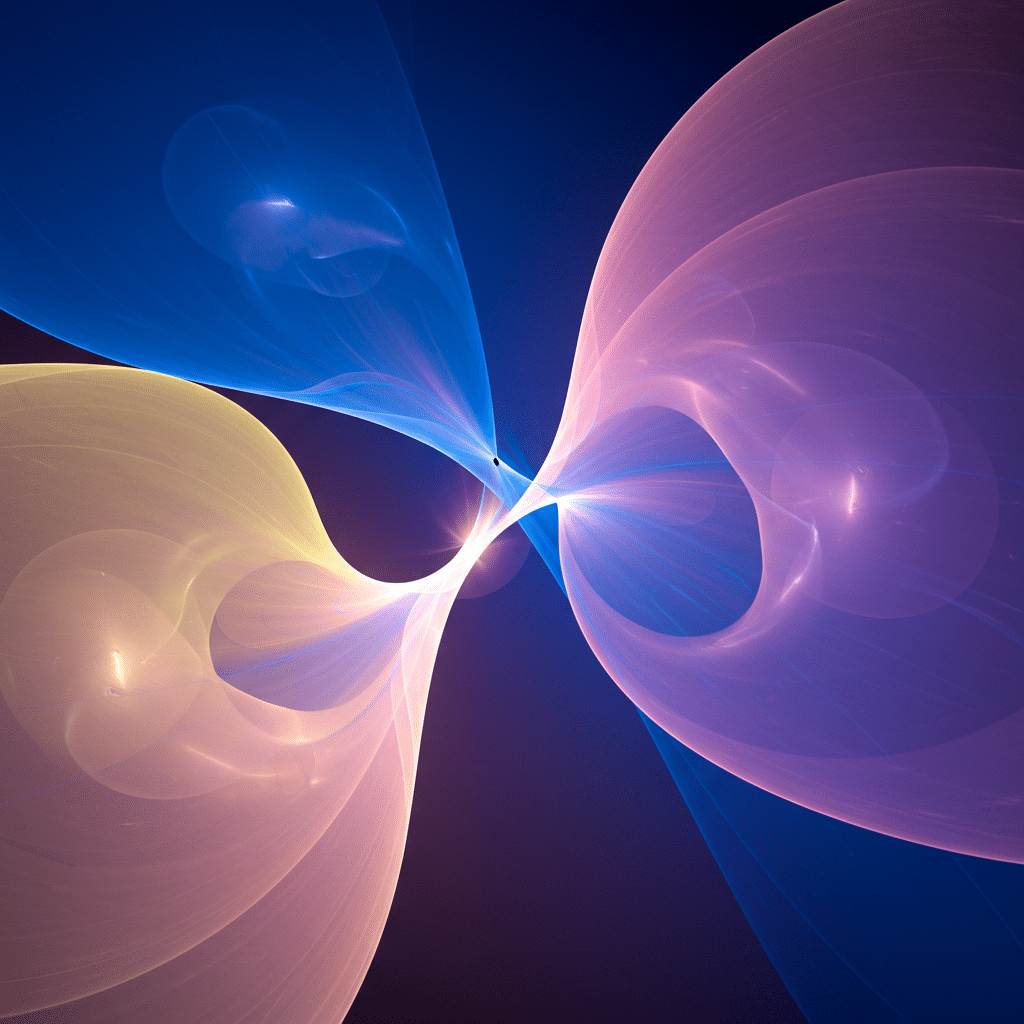Le nantissement de compte-titres est une garantie puissante, mais sa véritable efficacité se mesure au moment de sa réalisation. Lorsque le débiteur ne respecte pas ses engagements, le créancier doit pouvoir transformer cette sûreté en liquidités pour recouvrer sa créance. Cette phase, loin d’être une simple formalité, est un processus juridique encadré par des règles strictes qui visent à équilibrer les droits du créancier et la protection du débiteur. Une erreur peut anéantir les bénéfices de la garantie. Pour un aperçu complet du mécanisme, notre guide sur le nantissement de compte-titres détaille les étapes de sa constitution. Cet article se concentre sur les procédures de mise en œuvre de cette sûreté, c’est-à-dire comment la faire exécuter concrètement.
Les conditions préalables à la réalisation du nantissement
Avant même d’envisager la vente ou l’appropriation des titres, le créancier doit s’assurer que plusieurs conditions impératives sont réunies. Le déclenchement de la réalisation n’est ni automatique ni discrétionnaire ; il obéit à une séquence précise dont le non-respect peut rendre toute l’opération caduque.
Créance certaine, liquide et exigible
Le nantissement est une sûreté dite « accessoire » : il n’existe que pour garantir une dette principale. Par conséquent, pour pouvoir l’activer, la créance doit présenter trois qualités cumulatives. Elle doit être certaine, c’est-à-dire non contestée dans son existence ou son principe. Elle doit ensuite être liquide, ce qui signifie que son montant est connu ou peut être déterminé par un simple calcul. Enfin, elle doit être exigible, le terme du paiement étant arrivé à échéance. Si l’une de ces conditions fait défaut, le créancier ne peut légalement pas engager la procédure de réalisation.
La mise en demeure formaliste : un impératif
La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier notifie formellement au débiteur son intention de réaliser le nantissement faute de paiement. Il ne s’agit pas d’un simple courrier de relance. L’article D. 211-11 du Code monétaire et financier impose un formalisme précis. La mise en demeure doit être envoyée au débiteur, mais aussi au titulaire du compte si c’est une autre personne (le constituant). Elle doit mentionner, sous peine de nullité, qu’à défaut de paiement sous un délai donné, le nantissement sera réalisé. Elle doit également informer le constituant de sa faculté d’indiquer l’ordre dans lequel il souhaite que les actifs soient vendus ou attribués.
L’oubli de cette étape ou une rédaction non conforme n’est pas une simple irrégularité. La jurisprudence considère que son absence vicie la totalité de la procédure de réalisation. Le créancier qui procéderait à la vente des titres sans mise en demeure préalable s’exposerait à devoir restituer la valeur intégrale des actifs, et non simplement à indemniser une éventuelle perte de chance pour le débiteur. Il est à noter que ce régime peut être affecté par l’ouverture d’une procédure collective, qui obéit à des règles propres en matière d’exigibilité des créances et de réalisation des sûretés. Pour approfondir ce point, consultez notre analyse sur l’impact des procédures collectives sur le nantissement de compte-titres.
Le respect du délai légal ou conventionnel
Après réception de la mise en demeure, un délai doit s’écouler avant que le créancier ne puisse agir. La loi fixe ce délai à huit jours. Cependant, les parties peuvent tout à fait aménager cette durée dans la convention de nantissement initiale. Elles peuvent prévoir un délai plus long ou plus court, en fonction de la nature des actifs ou de la relation de confiance. Ce délai a une double fonction : il laisse une dernière chance au débiteur de s’acquitter de sa dette et lui donne le temps de communiquer au teneur de compte ses préférences sur l’ordre de réalisation des actifs.
Les modalités de réalisation des actifs nantis
Une fois les conditions préalables remplies et le délai écoulé, le créancier peut passer à l’exécution. La méthode de réalisation dépend directement de la nature des actifs présents dans le compte. La composition du compte au moment de la réalisation est déterminante. Les actifs disponibles dépendent de la gestion et de l’évolution du portefeuille nanti tout au long de la vie du contrat.
Principe de réalisation à hauteur de la créance garantie
Un principe fondamental gouverne toute la procédure : la proportionnalité. Le créancier ne peut réaliser les actifs que dans la mesure nécessaire pour couvrir le montant de sa créance, augmenté des frais liés à la réalisation. Si la valeur du compte nanti est supérieure à la dette, il ne peut s’approprier le surplus. Comme mentionné, le constituant peut indiquer au teneur de compte l’ordre dans lequel il souhaite que ses titres ou ses liquidités soient utilisés. S’il ne le fait pas dans le délai imparti, le créancier retrouve une totale liberté pour choisir les actifs qu’il réalisera en priorité, ce qui constitue un avantage stratégique non négligeable.
Réalisation des sommes d’argent
C’est le cas de figure le plus simple et le plus direct. Si le compte nanti contient des liquidités (par exemple, des dividendes ou le produit de ventes antérieures), le créancier a le droit de se les approprier directement. Concrètement, il donne l’ordre au teneur de compte de virer les sommes nécessaires sur son propre compte. Le transfert de propriété est alors immédiat et le recouvrement partiel ou total est effectué sans autre formalité.
Réalisation des titres admis aux négociations d’une plateforme
Pour les titres cotés (actions, obligations) sur ce que la loi appelle une « plateforme de négociations » (ce qui inclut les marchés réglementés comme Euronext Paris mais aussi les systèmes multilatéraux comme Euronext Growth), le créancier bénéficie d’un choix entre trois options. Il peut :
- Faire vendre les titres sur la plateforme et s’approprier le produit de la vente.
- Organiser une vente à un cercle restreint d’investisseurs qualifiés.
- Se les attribuer directement en pleine propriété, à concurrence de sa créance, sur la base du dernier cours de clôture connu.
Cette dernière faculté est particulièrement efficace. Elle permet au créancier d’éviter les aléas et les délais d’une vente sur le marché en devenant directement propriétaire des titres.
Réalisation des parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC)
Pour les parts de SICAV ou de FCP, le mécanisme est similaire. Le créancier peut opter soit pour la présentation des parts au rachat auprès de la société de gestion, soit pour leur attribution directe en propriété. Dans ce second cas, la valeur retenue est la dernière valeur liquidative connue, assurant une valorisation objective.
Réalisation des titres non cotés
La situation se complexifie pour les titres de sociétés non cotées (SAS, SARL, etc.). En l’absence d’un marché fournissant un prix objectif, les options de réalisation par défaut sont plus lourdes : la vente publique (aux enchères) ou l’attribution judiciaire, qui nécessite de saisir un juge. Ces procédures sont longues et coûteuses. C’est ici que l’anticipation contractuelle, via le pacte commissoire, prend toute son importance.
Le pacte commissoire : une clause stratégique
Pour les titres non cotés, la meilleure protection pour un créancier est souvent de prévoir contractuellement une solution de sortie efficace. Le pacte commissoire est cet outil.
Principe et licéité du pacte commissoire
Le pacte commissoire est une clause, insérée dans la convention de nantissement, qui autorise le créancier à s’approprier les actifs nantis en cas de défaillance du débiteur. Longtemps regardé avec méfiance par le droit français, il est aujourd’hui parfaitement licite en matière de sûretés, comme le prévoit l’article 2348 du Code civil. Il permet de contourner la vente publique ou l’attribution judiciaire pour les titres non cotés, offrant une voie de réalisation privée, rapide et efficace.
Spécificités de l’évaluation des titres non cotés
L’appropriation ne se fait pas à n’importe quel prix. Pour protéger le débiteur contre une évaluation abusive, la loi impose une condition essentielle lorsque le pacte commissoire porte sur des titres non cotés : la valeur des titres doit être déterminée par un expert au jour du transfert de propriété. Cet expert peut être désigné à l’avance dans la convention ou, à défaut, par le juge. Cette expertise garantit que le créancier s’attribue les titres à leur juste valeur, et qu’il devra restituer au débiteur la différence si cette valeur excède le montant de sa créance.
Le rôle du teneur de compte ou du gestionnaire de DEEP
L’intermédiaire financier qui tient le compte-titres (ou qui gère le dispositif d’enregistrement électronique partagé pour les titres dématérialisés sur blockchain) joue un rôle pivot. Il est le bras armé de l’exécution.
Obligations du teneur de compte
Le teneur de compte n’est pas un arbitre du conflit entre le créancier et le débiteur. Son rôle est d’exécuter les instructions de réalisation que lui transmet le créancier, à condition qu’elles apparaissent conformes aux exigences légales et contractuelles. Lorsqu’il reçoit une instruction de vente ou d’attribution, il est tenu de l’exécuter sans pouvoir s’y opposer, sauf à engager sa propre responsabilité s’il exécute une instruction manifestement irrégulière. Il doit agir avec diligence pour que la réalisation soit effective.
Imputation des frais de réalisation
Toute procédure de réalisation engendre des coûts : frais de courtage pour une vente en bourse, honoraires de l’expert pour une évaluation, etc. Ces frais sont à la charge du débiteur. Ils sont déduits du produit de la réalisation avant que celui-ci ne soit affecté au remboursement de la créance principale. Le créancier est donc en droit de se faire rembourser de ces dépenses en priorité.
L’efficacité d’une garantie dépend de sa bonne exécution. La réalisation d’un nantissement de compte-titres est un processus technique où chaque étape compte. Pour sécuriser le recouvrement de votre créance et bénéficier d’un accompagnement juridique pour la réalisation de vos garanties et sûretés, contactez notre cabinet.
Sources
- Code monétaire et financier (notamment l’article L. 211-20 et les articles D. 211-10 et suivants)
- Code civil (notamment les articles 2347 et 2348 sur le pacte commissoire)
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés