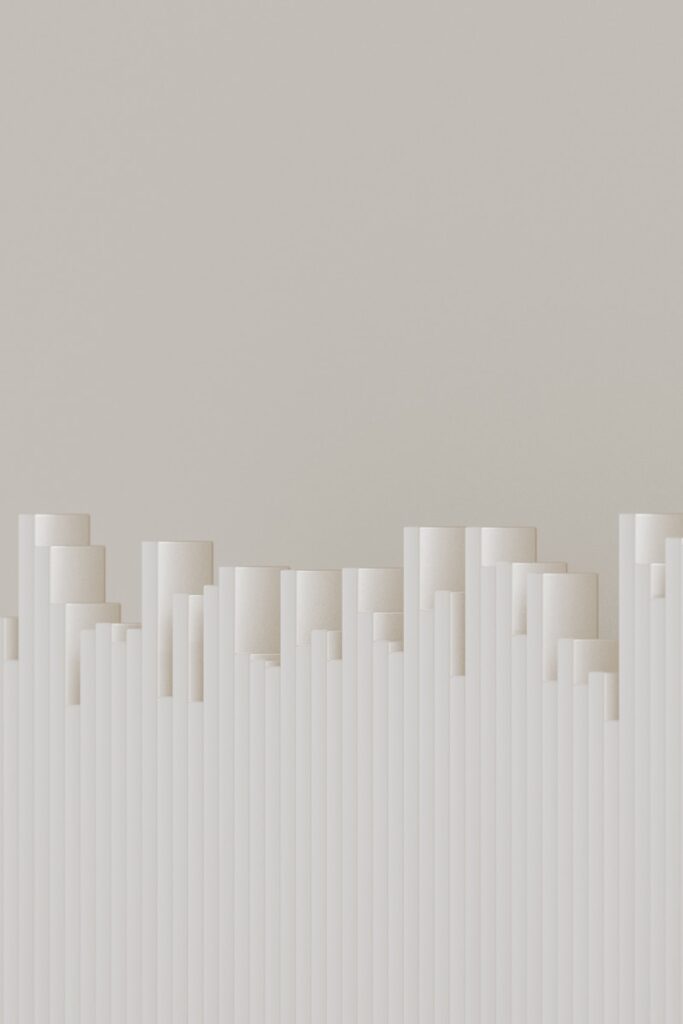La requête est l’un des actes fondamentaux qui permettent de porter un litige devant la justice civile. Moins intimidante que l’assignation signifiée par un commissaire de justice ou qu’une procédure de référé d’urgence, sa maîtrise est un atout pour tout justiciable. Cet acte de procédure, qui permet de saisir un juge sans en informer au préalable son adversaire, obéit à des règles précises, significativement modifiées par la grande réforme de la procédure civile de 2019. Cet article vous offre une vue d’ensemble complète et actualisée des principes qui gouvernent la requête, de ses différentes formes à ses effets juridiques. Face à la complexité des formalités et des enjeux, solliciter l’assistance d’un avocat compétent en procédure civile est souvent une démarche indispensable pour garantir la recevabilité, l’efficacité de sa démarche et en maîtriser les conséquences financières.
Définition générale de la requête et son rôle fondamental
Le mot « requête » est employé dans de multiples contextes, mais sa signification en droit est bien plus technique que dans le langage courant. Il s’agit d’un acte écrit et formalisé, qui ne se limite pas à une simple demande mais constitue le véritable point de départ d’une demande en justice. Il est essentiel de comprendre ses différentes facettes pour en saisir toute la portée.
La requête : au-delà du langage courant
Dans le langage commun, une requête est une sollicitation adressée à une autorité. Juridiquement, le terme gagne en précision : c’est un acte de procédure par lequel une personne, le demandeur, saisit une juridiction pour lui soumettre une prétention. Contrairement à une simple lettre, la requête doit respecter des conditions de forme et de fond pour être valide, c’est-à-dire pour produire des effets juridiques et obliger le juge à examiner la demande.
La requête en droit international, pénal et administratif
La requête n’est pas un outil exclusif à la procédure civile. En droit international, elle permet de saisir des juridictions comme la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme. En procédure pénale, elle peut viser à obtenir l’annulation d’un acte d’instruction. Dans le contentieux administratif, elle est le mode de saisine principal du tribunal administratif, par exemple pour contester une décision administrative qui affecte un service public. Cette universalité démontre son rôle central dans l’accès au juge, que ce soit en matière administrative ou judiciaire.
La requête en procédure civile : un acte polymorphe
En procédure civile, le terme de requête recouvre plusieurs réalités. Il faut principalement distinguer la requête qui introduit l’instance, de celles qui sont formées en cours de procès pour des demandes spécifiques, par exemple pour obtenir l’autorisation de recourir à une procédure accélérée (la procédure à jour fixe). Il faut aussi mentionner les requêtes spécifiques du ministère public lorsque celui-ci agit en tant que partie jointe ou principale. L’étude qui suit se concentre sur la requête comme acte de saisine initial de la juridiction, celui qui donne naissance au procès.
L’évolution de la requête en procédure civile : impact de la réforme 2019
La procédure civile a connu une transformation majeure avec la loi de réforme pour la justice de 2019 et son décret d’application n°2019-1333 du 11 décembre 2019. L’un des objectifs principaux de cette réforme était de simplifier et de rationaliser les modes de saisine des juridictions, accordant ainsi une place nouvelle et centrale à la requête.
La requête avant et après le 1er janvier 2020
Avant 2020, il existait plusieurs manières d’introduire une instance, notamment l’assignation, la requête, la requête conjointe et la déclaration au greffe. Cette diversité était source de complexité. La réforme a simplifié ce paysage en supprimant la « déclaration au greffe », qui était un mode de saisine simplifié pour les petits litiges. Désormais, aux côtés de l’assignation, la requête est devenue l’un des deux principaux modes pour saisir une juridiction civile en première instance.
Les nouveaux domaines d’application et compétences
La réforme a clarifié et étendu le champ d’application de la requête. Elle est devenue le mode de saisine de droit commun devant le tribunal judiciaire pour les litiges dont la demande n’excède pas 5 000 euros. Elle reste également la voie privilégiée dans de nombreuses matières spécifiques fixées par la loi, comme en matière gracieuse (adoption, changement de régime matrimonial) ou devant certaines juridictions spécialisées comme le conseil de prud’hommes.
Impact précis du décret n°2019-1333 sur la procédure
Au-delà de la simplification des modes de saisine, le décret de 2019 a eu un impact concret sur la procédure de requête. Il a notamment unifié le régime des sanctions en cas d’irrégularité. Auparavant, une erreur dans une requête conjointe pouvait entraîner son irrecevabilité, tandis qu’une erreur dans une requête unilatérale entraînait sa nullité. Aujourd’hui, le non-respect des mentions obligatoires est sanctionné par une nullité pour vice de forme, qui suppose la preuve d’un grief pour que la sanction soit prononcée (conformément à l’art. 114 du Code de procédure civile), harmonisant ainsi le traitement des erreurs procédurales.
Les différents types de requêtes : unilatérale, conjointe et spécificités
La requête en procédure civile se présente sous deux formes principales : unilatérale, lorsqu’elle émane d’une seule partie, et conjointe, lorsqu’elle est présentée d’un commun accord par les deux parties. À côté de ces deux formes, il existe des procédures spécifiques comme l’ordonnance sur requête, qu’il ne faut pas confondre.
La requête unilatérale : principes et identification du défendeur
La requête unilatérale est la forme la plus courante. Elle permet de saisir le juge sans en informer préalablement son adversaire. C’est le greffe de la juridiction qui se chargera ensuite de convoquer le défendeur à l’audience. Pour cette raison, la requête doit impérativement contenir, sous peine de nullité, les nom, prénoms et domicile du défendeur s’il s’agit d’une personne physique, ou sa dénomination et son siège social pour une personne morale.
La requête conjointe : notion, domaine et contenu spécifique
La requête conjointe est l’acte par lequel les parties décident ensemble de soumettre leur désaccord au juge. Elle doit exposer leurs prétentions respectives, les points précis de leur désaccord et les arguments de chacune. Elle est particulièrement adaptée lorsque les parties sont d’accord sur le principe de recourir à un juge mais pas sur la solution du litige. Elle peut être utilisée devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, quel que soit le montant de la demande.
Choix stratégique entre requête unilatérale et conjointe
Le choix entre ces deux formes de requête dépend de la nature du litige et de la relation entre les parties. La requête conjointe suppose un dialogue et un accord sur la nécessité de saisir le juge, ce qui peut apaiser le contexte contentieux et simplifier la procédure. La requête unilatérale est, par nature, plus adaptée aux situations conflictuelles où aucune collaboration n’est envisageable. La principale voie de recours contre une décision rendue sur requête est l’appel, mais des recours spécifiques, comme l’opposition, existent dans certaines procédures comme l’injonction de payer.
L’ordonnance sur requête : procédure non contradictoire
Il ne faut pas confondre la saisine du juge par requête et la procédure « sur requête ». Cette dernière est une procédure exceptionnelle et non contradictoire, utilisée lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une décision rapide sans avertir la partie adverse, violant ainsi provisoirement le principe du contradictoire. L’exemple typique est la demande de constat par un commissaire de justice avant que des preuves ne disparaissent, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civil. Le président de la juridiction rend alors une ordonnance sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur. La voie de recours appropriée est alors souvent un référé en rétractation pour rétablir le débat.
Les conditions de validité et formalités essentielles de la requête
Pour qu’une requête soit valide et produise ses effets, elle doit respecter des conditions strictes, tant sur le fond (qui peut agir ?) que sur la forme (comment agir ?). Le non-respect de ces exigences peut entraîner la nullité de l’acte et l’échec de toute la procédure engagée.
Conditions de fond : capacité et représentation
Pour agir en justice, le demandeur doit avoir la « capacité d’ester en justice ». Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle doivent être représentés par leur représentant légal. De même, une personne morale (société, association) agit par l’intermédiaire de son représentant légal (gérant, président), dont le pouvoir est défini par les statuts et l’état du droit des sociétés. Un défaut de capacité ou de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui peut entraîner la nullité de la requête sans même qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice, certaines de ces règles touchant à l’ordre public.
Conditions de forme : support, mentions et transmission
La requête, qu’elle soit rédigée sur papier libre, via un formulaire Cerfa ou de manière dématérialisée, doit comporter des mentions obligatoires listées aux articles 54 et 57 du Code de procédure civile. Celles-ci incluent notamment l’identification complète des parties, l’objet du litige, l’indication de la juridiction saisie et la liste des pièces justificatives. Elle doit être datée, signée, et transmise au greffe de la juridiction compétente pour que le juge en soit saisi.
La sanction des irrégularités : nullité et irrecevabilité
Une irrégularité de forme (oubli d’une mention, erreur de procédure) est sanctionnée par la nullité de l’acte, mais à une condition : que l’adversaire prouve que cette erreur lui cause un préjudice (un « grief »). En revanche, une irrégularité de fond (défaut de capacité d’agir) peut être soulevée à tout moment et n’exige pas cette preuve. Enfin, l’irrecevabilité est une sanction plus sévère qui met fin à la demande, par exemple en cas de non-respect de l’obligation de tentative de résolution amiable préalable.
Pièces justificatives et préparation de la requête
La requête doit lister les pièces sur lesquelles elle se fonde, généralement via un « bordereau de pièces » annexé. Ces documents (contrats, factures impayées, lettres de mise en demeure, etc.) doivent être joints en copie. Pour les demandes devant le Juge aux affaires familiales (JAF) ou pour les litiges de moins de 5 000 euros, où la procédure est souvent orale et sans avocat, la clarté et la pertinence des pièces fournies dans le dossier sont déterminantes pour convaincre le juge.
Procédures spécifiques et applications juridictionnelles de la requête
L’usage de la requête et ses règles varient en fonction de la juridiction saisie et de la matière concernée. Chaque tribunal a ses propres spécificités qu’il convient de connaître pour ne pas commettre d’impair.
La requête devant le tribunal judiciaire
Pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, la saisine du tribunal judiciaire par requête est subordonnée, sauf exceptions, à une tentative de résolution amiable préalable (conciliation, médiation). L’acte doit obligatoirement mentionner les diligences accomplies à ce titre, sous peine d’irrecevabilité. La procédure est alors orale et la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Requêtes en matière familiale : divorce et autorité parentale
En matière familiale, la requête est très utilisée. La demande de divorce par consentement mutuel, lorsqu’elle doit passer devant un juge (cas où un enfant mineur demande à être entendu), est formée par une « requête unique ». Pour les autres divorces contentieux, les époux peuvent opter pour une « requête conjointe ». De nombreuses demandes relatives à l’autorité parentale (délégation, retrait) sont également introduites par requête, avec des mentions spécifiques obligatoires.
La requête devant les juridictions spécialisées et d’appel
Le conseil de prud’hommes est saisi par requête, que la demande émane du salarié ou de l’employeur. Le formalisme y est précisément encadré par le Code du travail. Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la requête est également un mode de saisine prévu par le Code de procédure civile, aux côtés de l’acte d’huissier de justice, pour les litiges spécifiques entre propriétaires et exploitants agricoles. Devant la cour d’appel, l’instance peut être introduite par une requête conjointe des parties, qui doivent alors obligatoirement être représentées par un avocat. En cas de pourvoi, des règles spécifiques de requête s’appliquent également devant la Cour de cassation.
Procédures non contradictoires et spécialisées (injonction, participative)
La requête est l’acte unique pour initier des procédures rapides et simplifiées comme l’injonction de payer (pour le recouvrement d’une créance certaine) ou l’injonction de faire (pour contraindre à l’exécution d’une obligation). Elle est également utilisée pour saisir le juge à l’issue d’une procédure participative, lorsque les parties, assistées de leurs avocats, n’ont pas réussi à trouver un accord total.
Les effets juridiques et stratégiques de la requête en procédure civile
Le dépôt d’une requête au greffe produit des effets juridiques majeurs, tant sur le plan de la procédure que sur le fond du droit. Comprendre ces effets est essentiel pour élaborer une stratégie contentieuse efficace et ne pas perdre ses droits.
Effets procéduraux : introduction d’instance et saisine du juge
La remise de la requête au greffe marque le début de l’instance. C’est à cette date que la juridiction est officiellement saisie du litige. Cet acte crée le « lien juridique d’instance » entre les parties et le juge, faisant naître pour ce dernier l’obligation de statuer sur la demande qui lui est soumise.
Interruption de la prescription et de la forclusion : principes et exceptions
Un des effets les plus importants de la demande en justice est l’interruption des délais de prescription et de forclusion. En saisissant le juge, le demandeur manifeste sa volonté de faire valoir son droit et arrête le cours du temps qui pourrait éteindre son action. Cet effet interruptif est puissant : il est maintenu même si la juridiction saisie est incompétente ou si l’acte est annulé pour un vice de procédure. Attention, il existe des exceptions notables : la requête aux fins de mesure d’instruction avant tout procès (art. 145) ou la requête en injonction de payer n’interrompent pas la prescription.
Effets sur le fond du droit et stratégies contentieuses
La requête produit aussi des effets sur le droit substantiel lui-même. Elle vaut mise en demeure du débiteur et fait courir les intérêts moratoires sur la somme qui sera due, ce qui a une incidence financière directe pour le débiteur. D’un point de vue stratégique, la requête est souvent perçue comme moins agressive que l’assignation, car elle n’est pas directement signifiée par un commissaire de justice. Elle peut s’avérer plus rapide et moins coûteuse. Cependant, l’assignation offre un cadre plus formel et contradictoire dès le départ, ce qui peut être tactiquement préférable pour des litiges complexes où l’on souhaite marquer les esprits et prendre l’initiative.
La requête est un outil procédural puissant mais dont le maniement exige rigueur et précision. Si vous êtes confronté à la nécessité d’introduire une instance ou de répondre à une requête, notre cabinet peut vous accompagner. Pour une analyse personnalisée de votre situation, contactez nos avocats experts en contentieux.
Foire aux questions
Quelle est la différence principale entre une requête et une assignation ?
La requête est déposée au greffe par le demandeur, et c’est le tribunal qui convoque le défendeur. L’assignation est un acte signifié au défendeur par un commissaire de justice (aujourd’hui huissier de justice) avant d’être déposée au tribunal, informant ainsi l’adversaire avant même la saisine du juge.
Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour déposer une requête ?
Non, la représentation par avocat est généralement facultative pour les litiges devant le tribunal judiciaire dont la demande est inférieure à 10 000 euros et devant le conseil de prud’hommes. Toutefois, l’assistance d’un avocat reste fortement recommandée pour sécuriser la procédure et optimiser l’issue financière du litige.
Que se passe-t-il si ma requête comporte une erreur ?
Une erreur dans la requête, comme l’oubli d’une mention, peut entraîner sa nullité. S’il s’agit d’un vice de forme, la nullité sera prononcée seulement si l’adversaire prouve que l’erreur lui a causé un préjudice, ce qui peut affecter la validité du jugement rendu. S’il s’agit d’une irrégularité de fond (ex: défaut de capacité), la nullité peut être prononcée sans cette preuve.
Combien de temps prend une procédure introduite par requête ?
La durée est très variable et dépend de la nature de l’affaire et de l’état d’encombrement de la juridiction. Une procédure par requête peut être plus rapide pour les « petits » litiges, mais pour des affaires complexes, la durée sera similaire à celle d’une procédure initiée par assignation.
Puis-je déposer une requête par internet ?
Oui, pour un nombre croissant de matières, il est possible de déposer une requête par voie électronique de manière dématérialisée via le portail en ligne « justice.fr », un service public numérique, notamment pour saisir le juge aux affaires familiales ou pour des demandes devant le juge des contentieux de la protection.
Qu’est-ce que l’obligation de tentative de résolution amiable avant la requête ?
Pour les demandes devant le tribunal judiciaire n’excédant pas 5 000 euros et pour certains litiges de voisinage (mentionnés dans le Code de l’organisation judiciaire), la loi impose d’avoir tenté de résoudre le conflit à l’amiable (via un conciliateur de justice, un médiateur, etc.) avant de saisir le juge. La requête doit mentionner ces démarches, sous peine d’être déclarée irrecevable.