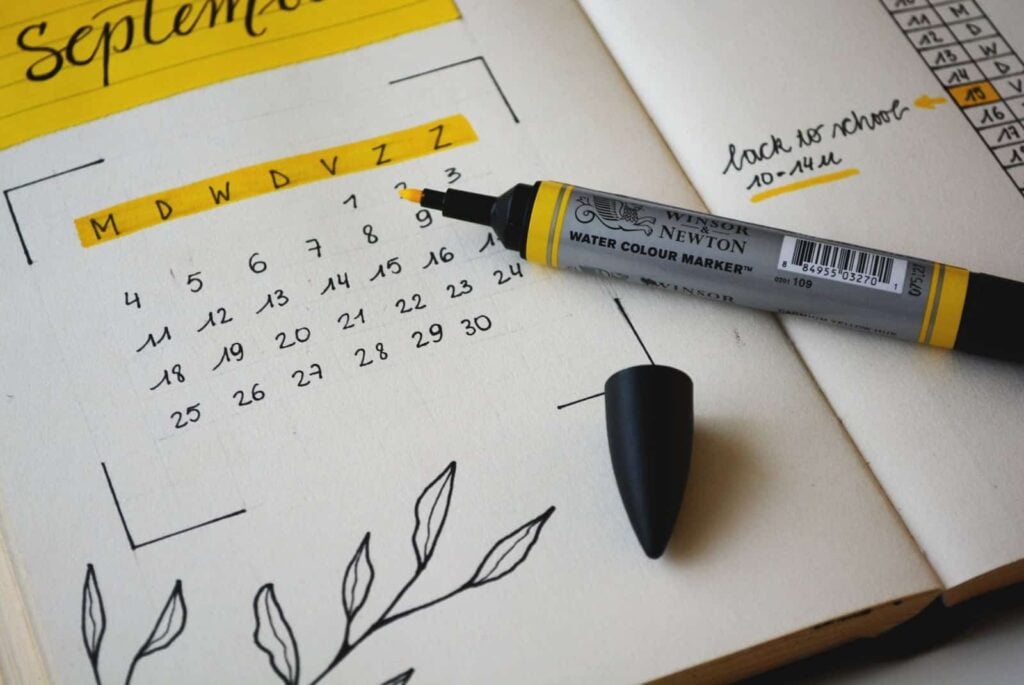Pour tout acteur du monde maritime, le sinistre représente le moment redouté où les risques inhérents à la mer se matérialisent. C’est aussi l’instant où le contrat d’assurance est mis à l’épreuve : la protection promise doit devenir une réalité tangible sous forme d’indemnisation. Mais le chemin entre la survenance d’un événement dommageable et le règlement effectif par l’assureur est souvent complexe en matière maritime. Il implique des procédures spécifiques, des expertises techniques et l’application de règles parfois très anciennes et originales. Dans ce contexte, l’assurance maritime joue un rôle crucial pour assurer la pérennité des opérations maritimes. Elle offre des protections variées face à une multitude de risques, qu’il s’agisse de pertes matérielles, de responsabilités civiles ou de perturbations commerciales. En fin de compte, la solidité du contrat d’assurance et la capacité de l’assureur à répondre promptement peuvent faire la différence entre la survie et la faillite d’une entreprise maritime. Les enjeux de l’assurance maritime ne se limitent pas simplement à la couverture des pertes, mais englobent également la gestion des risques et la prévoyance stratégique. En anticipant les différents scénarios pouvant survenir en mer, les entreprises peuvent mieux se préparer et ajuster leurs opérations en conséquence. Ainsi, une bonne compréhension des enjeux de l’assurance maritime devient essentielle pour naviguer sereinement dans un environnement aussi imprévisible.
Comment définit-on précisément un sinistre couvert par une assurance maritime ? Quelles sont les étapes clés de sa gestion, depuis la déclaration jusqu’à l’évaluation des dommages ? Comment l’indemnisation est-elle calculée et versée ? Et quelles sont ces particularités, comme l’avarie commune ou le délaissement, qui font la spécificité du droit maritime ? Cet article vous plonge au cœur de la gestion des sinistres en assurance maritime. La compréhension des éléments essentiels du contrat d’assurance, tels que les clauses spécifiques liées aux sinistres maritimes, est fondamentale pour naviguer dans ce domaine complexe. De plus, la gestion des sinistres nécessite une coopération étroite entre les parties impliquées, afin d’assurer une évaluation juste et rapide des pertes. Enfin, une connaissance approfondie des droits et obligations de chacun est primordiale pour garantir une indemnisation efficace et équitable.
Quand parle-t-on de sinistre en assurance maritime ?
Pour qu’un événement déclenche la garantie de l’assurance maritime, trois conditions doivent être réunies : il faut un événement garanti, un dommage couvert, et l’absence d’une cause d’exclusion applicable.
Condition 1 : Un événement garanti par le contrat L’assurance ne joue que si le dommage résulte d’un événement prévu par la police. Il peut s’agir d’une « fortune de mer » (naufrage, échouement, abordage, tempête…) ou d’un « événement de force majeure », comme le prévoit l’article L. 172-11 du Code des assurances. La police peut également couvrir d’autres événements spécifiques listés (incendie, vol, piraterie, risques de guerre si la garantie a été souscrite, etc.). L’événement doit être, par nature, accidentel et imprévu.
Condition 2 : Un dommage couvert par la police L’événement doit avoir causé un dommage matériel ou une perte financière entrant dans le champ de la garantie souscrite. L’étendue des dommages couverts dépendra de la formule choisie : une police « tous risques » offrira une couverture plus large qu’une police « Franc d’Avaries Particulières sauf… » (FAP sauf), qui ne couvre les avaries particulières (dommages affectant uniquement le bien assuré) que si elles résultent de certains événements limitativement énumérés ou dépassent une certaine franchise.
Condition 3 : L’absence d’une cause d’exclusion applicable Même si l’événement et le dommage semblent correspondre à la garantie, l’assureur peut refuser d’indemniser si le sinistre trouve son origine dans une cause exclue par la loi ou le contrat. Rappelons les principales exclusions légales :
- La faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré (article L. 172-13) ou la faute intentionnelle du capitaine (article L. 173-5).
- Le vice propre connu du navire ou de la marchandise (article L. 172-18, L. 173-4).
- Les dommages résultant d’amendes, confiscations, contrebande ou commerce prohibé (article L. 172-18). Certaines polices peuvent aussi exclure les dommages dus à un manque de soins raisonnables de l’assuré pour prévenir le sinistre (article L. 172-13). De même, les risques exceptionnels comme la guerre ou la piraterie sont exclus sauf garantie expresse (article L. 172-16).
Ce n’est que si ces trois conditions sont remplies que l’on peut véritablement parler de sinistre engageant la garantie de l’assureur.
La gestion du sinistre : un processus encadré
Lorsqu’un sinistre survient, un processus précis se met en place, impliquant des obligations pour l’assuré et l’intervention d’experts.
Les préalables à l’indemnisation : le rôle actif de l’assuré L’assuré ne peut rester passif après un sinistre. Il a plusieurs obligations importantes :
- Déclarer le sinistre à l’assureur dès qu’il en a connaissance. Les délais sont souvent fixés par la police et leur non-respect peut, dans certains cas, entraîner une déchéance de garantie.
- Fournir toutes les informations et documents nécessaires à l’assureur pour évaluer le sinistre et établir les responsabilités (rapport de mer, factures, titres de propriété, etc.).
- Prendre toutes mesures conservatoires pour limiter l’aggravation des dommages et contribuer au sauvetage des biens assurés (article L. 172-23 du Code des assurances). Les frais engagés à cette fin sont généralement pris en charge par l’assureur, même s’ils sont engagés sans succès.
- Conserver les recours contre les tiers éventuellement responsables du dommage (autre navire en cas d’abordage, transporteur précédent, etc.). L’assureur, après avoir indemnisé, pourra exercer ces recours à sa place (subrogation).
L’assuré doit agir avec diligence et bonne foi. L’article L. 172-28 du Code des assurances, qualifié d’ordre public, sanctionne sévèrement la mauvaise foi : « L’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance ».
La constatation et l’évaluation des dommages : l’intervention des experts Contrairement à certains sinistres terrestres simples, l’évaluation des dommages maritimes requiert souvent une expertise technique pointue. Deux figures clés interviennent :
- Les commissaires d’avaries : Ce sont des experts indépendants, désignés soit par les comités d’assureurs, soit d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur. Leur mission est de constater matériellement les dommages, d’en rechercher les causes et d’estimer leur coût. Leurs rapports (souvent appelés « dispatches » lorsqu’ils calculent la répartition des contributions en avarie commune) constituent la base de l’évaluation du sinistre, même s’ils ne lient pas formellement un juge ou un arbitre en cas de litige.
- Les comités d’assureurs : Organismes professionnels regroupant les assureurs d’une place (portuaire, par exemple). Ils jouent un rôle de coordination, de désignation des commissaires d’avaries, de suivi des expertises et de validation des propositions de règlement.
Les modalités d’indemnisation : comment l’assureur paie-t-il ?
Le but final de l’assurance est de replacer l’assuré, financièrement, dans la situation où il se serait trouvé si le sinistre n’était pas survenu, sans toutefois lui permettre de réaliser un profit. C’est le principe indemnitaire. En assurance maritime, ce principe se décline selon différentes modalités.
Le règlement classique : « en avarie » Le terme « avarie » en droit maritime désigne à la fois les dommages matériels subis par le navire ou la cargaison, et certaines dépenses exceptionnelles engagées au cours de l’expédition. On distingue deux types d’avaries :
- L’avarie particulière : C’est le dommage ou la dépense qui n’affecte que le navire ou la cargaison, et qui n’est pas engagé volontairement dans l’intérêt commun de l’expédition. Par exemple : une coque endommagée par une collision, une marchandise mouillée par une voie d’eau accidentelle. En assurance sur corps, l’assureur rembourse alors le coût des réparations nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l’exclusion des pertes indirectes comme le manque à gagner dû à l’immobilisation (chômage) (article L. 173-11). Pour les marchandises, l’indemnisation correspond à la perte de valeur subie.
- L’avarie commune : C’est l’une des institutions les plus originales et anciennes du droit maritime. Elle vise la situation où le capitaine, pour sauver l’ensemble de l’expédition (navire, fret et cargaison) d’un péril imminent (échouement, incendie…), décide volontairement de sacrifier une partie de la cargaison (en la jetant à la mer – « jet de mer ») ou d’engager des dépenses extraordinaires (frais de remorquage pour se sortir d’un échouement, frais de déchargement/rechargement dans un port de refuge…). Ces sacrifices et dépenses, faits dans l’intérêt commun, sont alors répartis proportionnellement entre tous les intérêts sauvés (valeur du navire, du fret et des marchandises arrivées à bon port). L’assureur maritime couvre la contribution à l’avarie commune qui incombe aux biens qu’il assure (navire ou marchandises) (article L. 172-11, L. 172-26). Les règles complexes de calcul et de répartition sont souvent définies par les Règles d’York et d’Anvers, un ensemble de règles internationales adoptées par la pratique.
Une option radicale en cas de sinistre majeur : le délaissement Dans certaines situations où les dommages sont si importants que la réparation ou la récupération des biens assurés serait économiquement absurde ou techniquement impossible, le droit maritime offre à l’assuré une option particulière : le délaissement.
Il s’agit pour l’assuré de transférer la propriété des biens assurés (ou de ce qu’il en reste) à l’assureur, en échange du paiement par ce dernier de la totalité de la somme assurée, comme s’il y avait eu perte totale (article L. 172-27). C’est une sorte de « vente forcée » du bien sinistré à l’assureur.
Le délaissement n’est possible que dans des cas limitativement énumérés par la loi et les polices :
- Perte totale avérée du navire ou des marchandises.
- Innavigabilité absolue du navire ne pouvant être réparé.
- Pour le navire : impossibilité de réparer au lieu où il se trouve et de le déplacer, ou coût des réparations atteignant les trois quarts de la valeur agréée (article L. 173-13).
- For the marchandises : perte ou détérioration atteignant les trois quarts de la valeur, ou vente en cours de route pour cause d’avaries (article L. 173-21).
- Défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois (articles L. 173-13 et L. 173-20).
La procédure est formelle : l’assuré doit notifier sa décision de délaisser à l’assureur par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, dans un délai précis (souvent fixé par la police), en indiquant toutes les assurances contractées sur le bien (articles R. 172-4, R. 172-5). Le délaissement doit être pur et simple : il ne peut être ni partiel, ni conditionnel (article L. 172-27). L’assureur peut accepter le transfert de propriété, ou le refuser (s’il estime par exemple que la gestion de l’épave serait trop coûteuse), mais même en cas de refus du transfert, il reste tenu de payer l’intégralité de la somme assurée si les conditions du délaissement sont remplies.
Points juridiques spécifiques autour de l’indemnisation
La gestion d’un sinistre maritime soulève souvent des questions juridiques particulières :
- La subrogation de l’assureur : Une fois qu’il a indemnisé l’assuré, l’assureur est « subrogé » dans les droits et actions de ce dernier contre les tiers responsables du sinistre. Il peut donc chercher à récupérer les sommes versées auprès du fautif. Pour exercer ce recours, l’assureur doit pouvoir justifier du paiement effectif de l’indemnité et de l’existence du contrat d’assurance (jurisprudence constante, ex: Aix-en-Provence, 15 mai 2014, DMF 2014. 813).
- L’action directe du tiers lésé : En matière d’assurance de responsabilité, la victime d’un dommage causé par un navire assuré peut, sous certaines conditions, agir directement contre l’assureur du responsable pour obtenir indemnisation, sans avoir à passer par l’assuré responsable (article L. 173-23). La loi applicable à cette action directe est déterminée par les règles de droit international privé (souvent la loi du lieu du dommage ou la loi du contrat d’assurance, voir Civ. 1ère, 18 déc. 2024, n° 21-23.252).
- La limitation de responsabilité de l’armateur : Le droit maritime international et français (Code des transports, article L. 5121-3) permet au propriétaire de navire de limiter sa responsabilité à un certain montant (calculé selon la jauge du navire) pour certains types de créances maritimes. L’assureur de responsabilité peut se prévaloir de cette limitation au même titre que son assuré (Loi 2016 pour l’économie bleue). Cependant, la jurisprudence (Com. 11 déc. 2012, n° 11-24.703 ; Civ. 1ère, 8 nov. 2017, n° 16-24.656) précise que l’assureur ne peut invoquer ce bénéfice que si l’armateur a effectivement constitué un fonds de limitation auprès du tribunal compétent.
- Les droits des créanciers privilégiés : En cas de perte du navire, les créanciers disposant d’une hypothèque maritime voient leur droit reporté sur l’indemnité d’assurance due par l’assureur au propriétaire (subrogation réelle). Ils peuvent donc réclamer directement le paiement à l’assureur (Com. 24 avr. 2007, n° 05-21.857).
- La prescription : Les actions dérivant du contrat d’assurance maritime se prescrivent par deux ans (article L. 172-31). Attention cependant, d’autres délais peuvent s’appliquer : par exemple, l’action en réparation d’un dommage d’abordage se prescrit par deux ans à compter de l’événement, mais ce délai peut être interrompu ou modifié par la reconnaissance de responsabilité, ou soumis aux règles complexes de la réforme de la prescription de 2008 si l’action a été engagée avant (voir Com. 28 mars 2018, n° 16-24.506).
La gestion d’un sinistre maritime est un processus technique qui requiert rigueur et expertise. Comprendre ses rouages permet aux assurés de mieux faire valoir leurs droits et de collaborer efficacement avec les assureurs et les experts.
Si vous êtes confronté à un sinistre maritime ou si vous souhaitez anticiper la gestion d’éventuels incidents, notre cabinet peut vous apporter son expertise pour défendre au mieux vos intérêts. N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour discuter de vos options.
Sources
- Code des assurances (Titre VII Livre Ier, notamment articles L.172-11, L.172-13, L.172-16, L.172-18, L.172-23, L.172-26, L.172-27, L.172-28, L.172-31, L.173-5, L.173-11, L.173-13, L.173-20, L.173-21, L.173-23, R.172-4, R.172-5)
- Code des transports (Article L.5121-3 sur la limitation de responsabilité)
- Jurisprudence citée (Cour d’appel d’Aix-en-Provence 15 mai 2014 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 2007, 11 décembre 2012, 28 mars 2018 ; Cour de cassation, Première chambre civile, 8 novembre 2017, 18 décembre 2024)