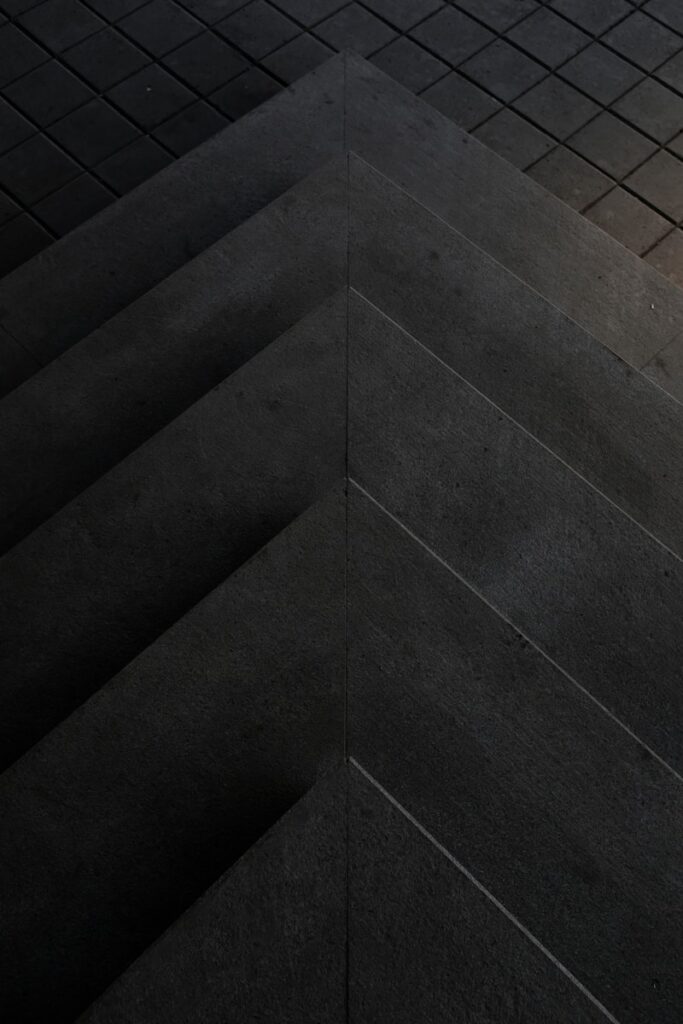La titrisation est un mécanisme de financement sophistiqué, permettant de transformer des actifs peu liquides en titres financiers négociables. Au cœur de cette opération se trouve une entité juridique, l’organisme de titrisation, dont le choix de la forme n’est pas anodin. Le droit français propose une dualité de structures : le fonds commun de titrisation (FCT) et la société de titrisation (ST). Comprendre leurs régimes respectifs est essentiel pour tout acteur économique envisageant de recourir à ce mécanisme clé du droit bancaire et financier. Cette décision initiale conditionne la flexibilité, la gouvernance et la visibilité internationale de l’opération. Notre cabinet, fort de son accompagnement en droit bancaire et financier, vous propose une analyse comparée de ces deux véhicules pour éclairer votre choix stratégique au sein du cadre juridique des organismes de titrisation en France.
Dualité des formes d’organismes de titrisation : un choix stratégique
Le législateur français, par l’ordonnance du 13 juin 2008, a introduit une alternative à la structure historique du fonds commun de créances. L’objectif était de moderniser la place financière de Paris en offrant une option inspirée des pratiques internationales, notamment luxembourgeoises et américaines, où les véhicules de titrisation prennent souvent la forme de sociétés. Ce choix stratégique permet aux initiateurs d’une opération de titrisation d’opter pour la structure la plus adaptée à leurs objectifs, entre la souplesse contractuelle du fonds commun de titrisation et la sécurité juridique offerte par la société de titrisation. La distinction fondamentale repose sur l’existence ou non de la personnalité morale, un critère qui emporte des conséquences pratiques déterminantes sur la gouvernance, la gestion et la perception du véhicule par les investisseurs internationaux.
Le fonds commun de titrisation (fct) : une copropriété sans personnalité morale
Le fonds commun de titrisation (FCT) est la forme historique du véhicule de titrisation en France. Sa nature juridique est singulière : il s’agit d’une copropriété de biens dépourvue de personnalité morale. Cette absence de personnalité juridique signifie que le FCT n’a pas d’existence propre en tant que sujet de droit. Il ne peut donc pas contracter, agir en justice ou posséder des biens en son nom. Pour pallier cette incapacité, la loi impose l’intervention d’une société de gestion, qui agit comme le « bras armé » du fonds, le représentant à l’égard des tiers et assurant tous les actes de gestion. Juridiquement, le FCT s’analyse comme un patrimoine d’affectation, c’est-à-dire une masse de biens (les créances titrisées) et de droits exclusivement dédiée à l’opération de titrisation et isolée du patrimoine de la société de gestion et de celui des porteurs de parts. Cette architecture confère au FCT une quasi-personnalité, lui permettant de disposer d’un nom et d’un patrimoine autonome, sans pour autant être une personne morale.
La copropriété particulière des fct : des porteurs de parts sans pouvoir de gestion
Le législateur qualifie le FCT de copropriété. Cependant, il s’agit d’un régime très dérogatoire au droit commun de l’indivision prévu par le Code civil. Les investisseurs, en souscrivant des parts du fonds, deviennent copropriétaires des actifs titrisés. Néanmoins, cette propriété est vidée de ses prérogatives habituelles. Les porteurs de parts ne disposent d’aucun pouvoir de gestion direct sur les actifs du fonds. Ils ne peuvent ni provoquer le partage des biens, ni participer aux décisions courantes, qui relèvent de la compétence exclusive de la société de gestion. Cette structure protège l’intégrité de l’opération de titrisation en évitant toute immixtion des investisseurs dans la gestion du portefeuille de créances. Leurs droits en tant que porteurs de titres sont essentiellement financiers : ils perçoivent les revenus générés par les actifs et ont droit au remboursement de leur capital selon les modalités définies dans le règlement du fonds.
Constitution et liquidation du fct : un régime flexible
La création et la vie du FCT sont marquées par une grande souplesse, principalement régie par la liberté contractuelle. La constitution est à l’initiative de la société de gestion. C’est elle qui établit le règlement du fonds, véritable charte de l’opération qui en définit toutes les caractéristiques juridiques et financières : nature des risques, stratégie de financement, conditions d’émission des parts, droits des porteurs, etc. L’absence des contraintes liées à la constitution d’une société (pas de capital social à déposer, pas de statuts à enregistrer au Registre du Commerce et des Sociétés) rend sa mise en place rapide et moins formelle. La liquidation du FCT est également définie par son règlement. Elle intervient généralement à l’échéance prévue, lorsque toutes les créances ont été recouvrées et les investisseurs remboursés, mais des clauses de liquidation anticipée peuvent être prévues. La société de gestion procède alors à la réalisation des derniers actifs et à la distribution du boni de liquidation éventuel, conformément aux règles établies.
La société de titrisation (st) : une structure dotée de la personnalité morale
Alternative au FCT, la société de titrisation (ST) est une entité dotée de la pleine personnalité juridique. Elle doit être constituée sous la forme d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS). Ce choix offre une structure reconnaissable et sécurisante, en particulier pour les investisseurs internationaux habitués aux formes sociétaires classiques. La personnalité morale confère à la ST une autonomie complète : elle est titulaire de son propre patrimoine, peut conclure des contrats, agir en justice et interagir directement avec les tiers. Cette stabilité juridique est souvent privilégiée pour des montages complexes ou des programmes d’émission récurrents, comme les véhicules d’émission de papiers commerciaux adossés à des créances (programmes ABCP, ou « conduits »). Bien qu’elle soit également gérée par une société de gestion externe, la ST dispose de ses propres organes de direction (conseil d’administration ou président, assemblée générale), ce qui structure sa gouvernance de manière plus formelle que pour un FCT.
Le régime « très spécial » de la st : dérogations au droit commun des sociétés
Bien que la ST emprunte une forme sociale classique (SA ou SAS), le législateur a instauré un régime juridique « très spécial » qui déroge sur de nombreux points au droit commun des sociétés commerciales, dans un but de souplesse et d’efficacité. Ces assouplissements visent à adapter le fonctionnement de la société aux exigences spécifiques de la titrisation. Par exemple, les règles de quorum pour les assemblées générales sont allégées : pour une assemblée ordinaire ou une assemblée extraordinaire se tenant sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. De même, les règles strictes sur le cumul des mandats de directeur général ou de membre du directoire ne prennent pas en compte les mandats exercés au sein d’une ST. D’autres dérogations importantes concernent la désignation du commissaire aux comptes, qui est nommé par l’organe de direction et non par l’assemblée générale, ou la non-application de dispositions du Code de commerce relatives à la souscription du capital ou à l’évaluation des apports en nature. Enfin, et c’est une protection fondamentale, le livre VI du Code de commerce sur les entreprises en difficulté n’est pas applicable aux sociétés de titrisation.
Statuts de la société de titrisation : des mentions obligatoires précises
Les statuts d’une société de titrisation, à l’instar du règlement pour un FCT, constituent le document central qui organise son fonctionnement. Ils doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires, détaillées par le Code monétaire et financier, qui reflètent son objet spécifique. Ces mentions vont au-delà des clauses statutaires habituelles d’une SA ou d’une SAS. Les statuts doivent ainsi définir avec précision la nature des risques auxquels la société se propose d’être exposée, la stratégie de financement ou de couverture de ces risques, les conditions d’émission de ses actions et de ses titres de créance, ainsi que les types de garanties qu’elle peut recevoir ou consentir. Ils doivent également détailler la stratégie d’investissement de son actif, notamment la gestion de ses liquidités et les conditions de recours à des opérations financières spécifiques. Cette granularité statutaire assure la transparence de l’opération pour les investisseurs et encadre strictement le périmètre d’action de la société.
Comparaison et avantages/inconvénients : quel choix pour quelle opération ?
Le choix entre un fonds commun de titrisation et une société de titrisation dépend entièrement des objectifs de l’opération, du profil des investisseurs ciblés et du type d’actifs à titriser. Le FCT séduit par sa grande souplesse contractuelle. Son fonctionnement est presque entièrement défini par son règlement, ce qui permet une structuration sur mesure. L’absence de capital social et la légèreté de sa constitution en font un véhicule rapide et efficace à mettre en place. Cependant, son absence de personnalité morale peut être un frein pour certains investisseurs internationaux peu familiers de ce concept de copropriété, et peut compliquer l’application de conventions fiscales internationales. La ST, à l’inverse, offre la stabilité et la sécurité d’une personne morale reconnue mondialement. Sa structure sociétaire, bien que soumise à des dérogations, est un gage de gouvernance formelle qui rassure. C’est la forme privilégiée pour les programmes d’émission importants et récurrents qui nécessitent une forte visibilité sur les marchés internationaux. En contrepartie, sa constitution et sa vie sociale sont plus encadrées et potentiellement plus coûteuses que celles d’un FCT. En synthèse, le FCT est souvent l’outil de la flexibilité et de l’opération unique, tandis que la ST est celui de la structuration et de la récurrence à l’échelle internationale.
Solent avocats : votre partenaire pour la structuration de vos véhicules de titrisation
La structuration d’une opération de titrisation et le choix de son véhicule juridique sont des étapes décisives qui engagent des enjeux financiers et juridiques importants. Que vous optiez pour la souplesse d’un fonds commun de titrisation ou la robustesse d’une société de titrisation, chaque détail du règlement ou des statuts doit être méticuleusement étudié pour garantir la sécurité et l’efficacité du montage. Notre cabinet met à votre service son expertise en droit bancaire et financier pour vous guider dans cette décision stratégique et sécuriser l’ensemble de vos opérations.
Sources
- Code monétaire et financier, articles L. 214-168 à L. 214-186 (dispositions relatives aux organismes de titrisation)
- Code monétaire et financier, articles R. 214-217 et suivants (dispositions réglementaires)
- Code de commerce (dispositions relatives aux sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées)