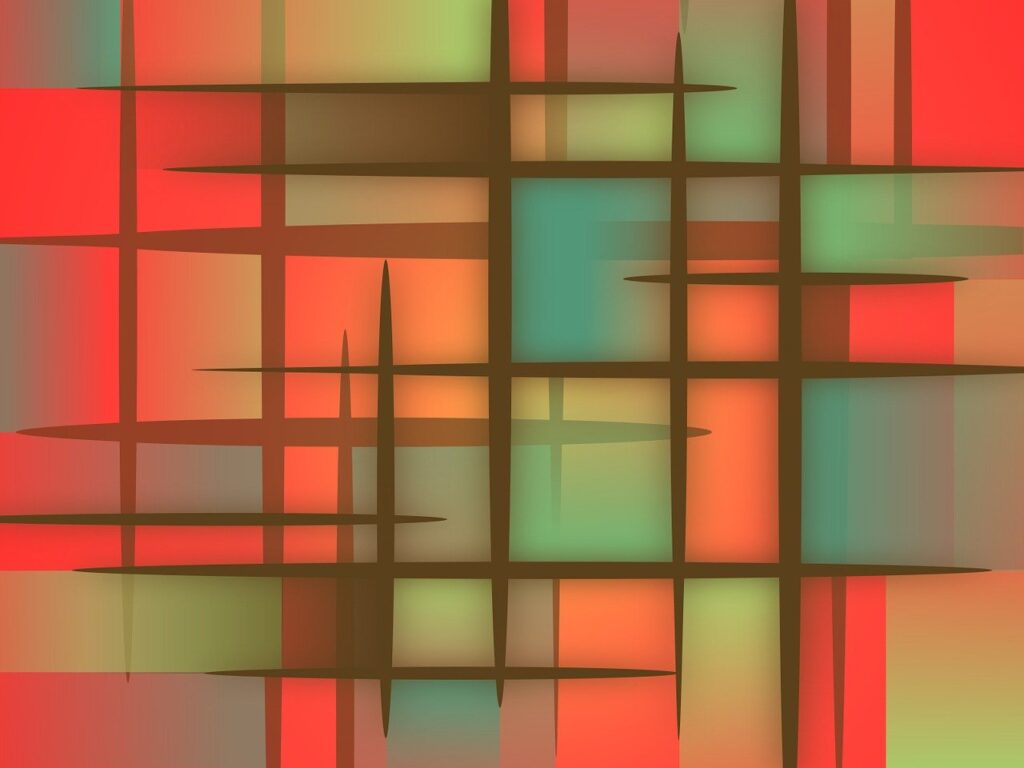En cas de créance menacée, deux voies s’offrent aux créanciers : la saisie conservatoire ou la sûreté judiciaire.
La première bloque les biens du débiteur et les rend indisponibles. La seconde, moins contraignante mais tout aussi efficace, permet d’inscrire un droit préférentiel sur certains biens sans les immobiliser.
Cette protection préventive mérite d’être examinée en détail.
1. Pourquoi préférer une sûreté judiciaire à une saisie conservatoire ?
La sûreté judiciaire présente un avantage majeur : elle n’empêche pas le débiteur de disposer de son bien. L’article L. 531-2 du Code des procédures civiles d’exécution est clair : « Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables ».
À l’inverse, l’article L. 521-1 du même code indique que les saisies conservatoires rendent les biens indisponibles. Cette différence change tout.
Pour un créancier, la sûreté judiciaire offre une protection sans bloquer l’activité économique du débiteur. Elle permet de prendre rang à la date de l’inscription provisoire, avantage considérable en cas de concours avec d’autres créanciers ou d’ouverture d’une procédure collective.
Le mécanisme se déploie en deux temps : d’abord une publicité provisoire, puis sa confirmation par une publicité définitive après obtention d’un titre exécutoire.
2. Les biens concernés par les sûretés judiciaires
L’article L. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution limite strictement le champ d’application des sûretés judiciaires à quatre catégories de biens.
Immeubles
L’hypothèque judiciaire conservatoire peut grever tous les immeubles par nature et leurs accessoires réputés immeubles. Un terrain nu, une maison, un appartement ou un immeuble commercial peuvent ainsi être concernés.
Des restrictions existent cependant, notamment pour :
- Le logement familial : quoique l’inscription d’hypothèque ne soit pas considérée comme un acte de disposition au sens de l’article 215 du Code civil (Civ. 1re, 8 janvier 1985, Bull. civ. I, n° 7)
- Les biens indivis : l’inscription ne porte que sur la part indivise du débiteur
- Les biens communs en régime matrimonial : attention à l’article 1415 du Code civil qui exclut certains engagements
Fonds de commerce
Le nantissement judiciaire conservatoire du fonds de commerce porte sur les éléments incorporels essentiels : nom commercial, enseigne, clientèle, achalandage et droit au bail.
Les éléments matériels (matériel, outillage) peuvent être inclus par une déclaration expresse. Les marchandises, quant à elles, restent exclues car leur immobilisation nuirait à l’activité.
Parts sociales et valeurs mobilières
Innovation majeure de la loi du 9 juillet 1991, ces nantissements permettent d’appréhender des actifs financiers.
Les parts sociales concernent principalement les sociétés de personnes (SNC, SCS, SCI), tandis que les valeurs mobilières englobent les actions de sociétés par actions, mais aussi toute une gamme de titres négociables (obligations, SICAV, certificats d’investissement…).
Cette extension témoigne d’une adaptation aux réalités économiques modernes où les actifs financiers représentent souvent l’essentiel du patrimoine.
3. La publicité provisoire
Les différentes formalités selon la nature du bien
Les formalités varient selon le bien concerné, reflet de l’éclatement du droit français de la publicité.
Pour l’hypothèque judiciaire conservatoire, l’article R. 532-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit le dépôt de deux bordereaux au service de la publicité foncière. Ces bordereaux mentionnent :
- La désignation du créancier
- L’élection de domicile
- La désignation du débiteur
- L’indication de l’autorisation ou du titre
- L’indication de la créance et ses accessoires
- La désignation de l’immeuble
Pour le nantissement du fonds de commerce, l’inscription s’effectue au greffe du tribunal de commerce selon l’article R. 532-2 du même code.
Le nantissement de parts sociales requiert la signification d’un acte à la société et, pour les sociétés civiles immatriculées, une publication au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement de valeurs mobilières s’opère par signification à la personne morale émettrice, à son mandataire ou à un intermédiaire habilité.
Dans tous les cas, l’inscription doit être prise dans les trois mois de l’autorisation judiciaire et conserve la sûreté pendant trois ans, avec possibilité de renouvellement.
L’information du débiteur
La mesure étant prise à l’insu du débiteur, l’article R. 532-5 impose une information obligatoire dans les huit jours suivant la publicité provisoire.
Cette notification, à peine de caducité, doit contenir :
- Une copie de l’ordonnance ou du titre
- L’indication du droit de demander mainlevée
- La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 du Code des procédures civiles d’exécution
La Cour de cassation applique strictement cette obligation (Civ. 2e, 4 janvier 2012, n° 11-12.308).
4. Les droits du débiteur
La demande de mainlevée
Le débiteur peut contester la sûreté judiciaire en demandant sa mainlevée. L’article R. 512-1 alinéa 2 inverse la charge de la preuve : c’est au créancier de prouver que les conditions de la sûreté sont réunies.
Cette action est possible tant que subsiste la publicité provisoire. Si le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire, l’article R. 532-6 lui impose un délai minimal d’un mois avant de pouvoir prendre une inscription définitive, précisément pour permettre cette contestation.
La mainlevée peut être totale ou partielle. Elle entraîne la radiation de l’inscription. Le créancier peut même être condamné à des dommages-intérêts si la mesure s’avère abusive (article L. 512-2).
La réduction de l’assiette
Lorsque la valeur des biens grevés excède manifestement le montant des sommes garanties, l’article R. 532-9 autorise le débiteur à demander une limitation des effets de la sûreté.
Cette réduction n’est accordée que si les biens restant grevés ont une valeur double du montant des sommes garanties. La jurisprudence entend cette valeur comme celle d’immeubles non grevés d’autres sûretés (Civ. 3e, 7 juillet 2004, n° 03-13.533).
La substitution de garantie
L’article L. 512-1 alinéa 2 permet de substituer à la sûreté judiciaire une autre mesure propre à préserver les intérêts des parties.
Son alinéa 3 prévoit même un cas de mainlevée automatique : la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée.
Cette faculté, bien que théoriquement moins utile que pour les saisies conservatoires (puisque le bien reste aliénable), présente un intérêt pratique considérable. Elle permet au débiteur de libérer un bien stratégique en offrant une garantie alternative.
5. La publicité définitive
Les délais et formalités
L’article R. 533-4 impose un délai de deux mois pour réaliser la publicité définitive, à compter :
- Du jour où le titre est passé en force de chose jugée
- De l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de l’inscription provisoire
- Du jour de la décision rejetant la contestation
Le non-respect de ce délai entraîne la caducité de la publicité provisoire (article R. 533-6).
Les formalités de publicité définitive sont similaires à celles des sûretés conventionnelles correspondantes. Pour l’hypothèque, elles suivent l’article 2428 du Code civil. Pour le nantissement du fonds de commerce, elles obéissent aux articles L. 143-16 et R. 143-6 du Code de commerce.
Les effets : le maintien du rang à la date de la publicité provisoire
L’effet majeur de la publicité définitive réside dans l’article R. 533-1 : « La publicité définitive donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière ».
Ce maintien du rang initial constitue un avantage décisif, particulièrement en cas d’ouverture d’une procédure collective.
L’article L. 622-30 du Code de commerce interdit les inscriptions après le jugement d’ouverture. Mais la jurisprudence admet la publicité définitive après l’ouverture si la publicité provisoire est antérieure (Com. 3 mai 2016, n° 14-21.556).
De même, l’article L. 632-1, 7° écarte la nullité de la période suspecte si l’inscription provisoire est antérieure à la date de cessation des paiements.
Cette rétroactivité confère aux sûretés judiciaires une valeur stratégique inestimable dans la course au paiement.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, notamment articles L. 511-1 à L. 531-2 et R. 511-1 à R. 533-6
- Code de commerce, articles L. 622-30, L. 632-1, L. 143-16, R. 143-6
- Code civil, articles 215, 1415, 2428, 2434
- Cour de cassation, Chambre civile 1re, 8 janvier 1985, Bull. civ. I, n° 7
- Cour de cassation, Chambre civile 2e, 4 janvier 2012, n° 11-12.308
- Cour de cassation, Chambre civile 3e, 7 juillet 2004, n° 03-13.533
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2016, n° 14-21.556
- PIÉDELIÈVRE Stéphane, GUERCHOUN Frédéric, « Saisies et mesures conservatoires », Répertoire de procédure civile, juin 2021