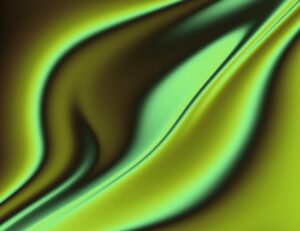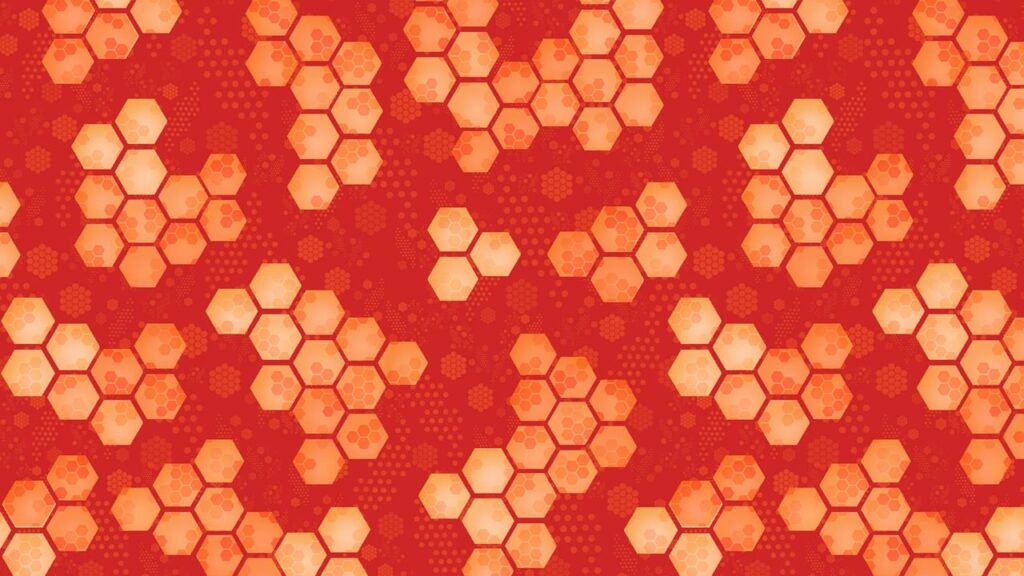Vous avez perdu votre procès. Vous hésitez à faire appel. Entre-temps, vous recevez une invitation à payer les condamnations. Vous vous exécutez sans réserve. Saviez-vous que ce simple paiement pourrait vous priver définitivement de votre droit d’appel ? C’est l’effet redoutable de l’acquiescement implicite. Pour une analyse approfondie des conséquences irréversibles de l’acquiescement, découvrez leurs implications pratiques.
L’acquiescement au jugement ferme les voies de recours. Pour une définition complète et les principes fondamentaux de l’acquiescement en droit civil, découvrez les bases de cette notion juridique. Il exprime la soumission aux chefs du jugement, comme l’indique l’article 409 du Code de procédure civile. Cette renonciation peut être expresse ou implicite, silencieuse mais définitive.
1. L’acquiescement légal
L’acquiescement légal se déduit d’un comportement. Il n’exige pas de prouver l’intention d’acquiescer, ce qui le distingue d’autres formes comme l’acquiescement implicite qui requiert une manifestation non équivoque de volonté. Trois conditions cumulatives doivent être réunies.
Le fait d’exécution
Un fait d’exécution manifeste la volonté d’exécuter le jugement. La jurisprudence retient notamment :
- Le paiement volontaire de la condamnation (Civ. 2e, 28 avril 1986, Bull. civ. II, n°64)
- L’adoption d’un comportement traduisant une soumission aux dispositions du jugement
- L’acceptation formelle des mesures ordonnées par le jugement
La Cour de cassation a ainsi jugé que lorsqu’une partie « accepte le jugement tel qu’il a été rendu et renonce à critiquer la disposition qui n’a pas entièrement satisfait à ses prétentions », elle acquiesce au jugement (Civ. 2e, 3 septembre 2015, n°14-17.766).
Le paiement d’un simple acompte peut parfois suffire, mais attention : l’exécution volontaire d’un seul chef de jugement n’entraîne pas acquiescement aux autres chefs indépendants.
Le caractère non exécutoire du jugement
Condition essentielle : le jugement ne doit pas être exécutoire. L’article 410 du Code de procédure civile l’exige. Un jugement exécutoire impose l’exécution au perdant. Cette contrainte légale exclut l’acquiescement.
Avec la généralisation de l’exécution provisoire depuis la réforme de 2019 (art. 514 CPC), les situations d’acquiescement légal se raréfient.
Toutefois, même face à un jugement exécutoire, une exécution spontanée accompagnée de circonstances particulières peut révéler une volonté d’acquiescer. La Cour de cassation l’a admis lorsque « la partie condamnée par un jugement exécutoire par provision a payé, avant toute démarche aux fins d’encaissement et sans réserve, la totalité des condamnations et des dépens » (Com. 21 novembre 1951).
L’absence de réserve
L’exécution doit être faite sans réserve pour valoir acquiescement (art. 410, al. 2 CPC). Des réserves clairement formulées écartent l’acquiescement.
Une formule précise comme « sous réserve du droit de faire appel » suffit à préserver ce droit (Civ. 2e, 9 mars 1994, n°92-19.583). En revanche, des réserves vagues comme « sous toutes réserves » peuvent être jugées insuffisantes.
2. L’acquiescement volontaire
L’acquiescement volontaire exige une volonté certaine d’acquiescer. Il se déduit de comportements postérieurs au jugement.
Poursuites aux fins de contrainte
La partie qui obtient gain de cause peut acquiescer au jugement en poursuivant son exécution. Cette demande d’exécution, sans réserve, révèle une volonté d’acquiescer.
La jurisprudence considère notamment que le recours à la procédure de paiement direct d’une pension alimentaire traduit l’intention d’acquiescer au jugement l’ayant fixée (Civ. 2e, 22 juin 1977, Bull. civ. II, n°158).
Attention au piège : l’acquiescement ferme les voies de recours, sauf le droit d’appel incident si l’adversaire forme un appel principal. L’article 409 du Code de procédure civile prévoit cette exception.
Réception du montant des condamnations
Accepter sans réserve le paiement d’une condamnation vaut acquiescement (Civ. 2e, 17 juin 1998, n°96-15.211). Mais certaines situations restent équivoques :
- L’acceptation d’une pension alimentaire (nécessité vitale)
- La réception d’un chèque sans l’encaisser
- L’encaissement sans autre manifestation d’intention
En revanche, « donner à son représentant des instructions formelles pour poursuivre le règlement des indemnités allouées et encaisser le montant sans réserve » constitue un acquiescement non équivoque (Civ. 2e, 12 octobre 1966).
Accords transactionnels
Les accords conclus après jugement peuvent valoir acquiescement. Ainsi, « la clause par laquelle des époux divorcés déclarent accepter formellement les attributions préférentielles prescrites par la décision de divorce vaut acquiescement » (Civ. 1re, 16 mars 1971, Bull. civ. I, n°80).
Une convention comportant l’engagement de « se désister de toutes actions judiciaires, de tout recours contre les décisions rendues antérieurement » constitue un acquiescement (Civ. 1re, 19 mars 2015, n°12-24.274).
3. Stratégies et précautions
Pour éviter un acquiescement involontaire :
- Formuler des réserves précises avant toute exécution
- Préciser expressément que l’exécution est contrainte
- Dans le doute, consulter rapidement un conseil
Pour la partie gagnante souhaitant obtenir un acquiescement :
- Demander une exécution volontaire du jugement non exécutoire
- Solliciter un écrit constatant que l’exécution est libre et sans réserve
- Faire constater judiciairement l’acquiescement
À retenir : l’acquiescement ne concerne que les chefs du jugement et n’emporte pas renonciation à demander rectification d’une erreur matérielle (Civ. 2e, 7 juillet 2011, n°10-21.061).
L’acquiescement est un mécanisme juridique aux conséquences lourdes qui peut transformer un acte anodin en renoncement définitif. Un geste apparemment insignifiant – comme payer sans réserve une condamnation – peut verrouiller définitivement les portes du prétoire.
Nos avocats maîtrisent les subtilités procédurales et peuvent vous guider pour préserver vos droits. Pour des conseils d’experts en procédure civile essentiels pour sécuriser vos démarches et éviter les pièges de l’acquiescement involontaire, découvrez nos services en droit processuel. Pour une analyse des effets d’un éventuel acquiescement dans votre situation, prenez rendez-vous avec notre cabinet. Un conseil avisé peut faire toute la différence entre une porte fermée et une voie de recours préservée.
Sources
- Code de procédure civile, articles 408 à 410, 123, 125, 409 et 410
- Civ. 2e, 28 avril 1986, Bull. civ. II, n°64
- Civ. 2e, 3 septembre 2015, n°14-17.766
- Com. 21 novembre 1951, JCP A 1952, IV, 1790
- Civ. 2e, 9 mars 1994, n°92-19.583, Bull. civ. II, n°86
- Civ. 2e, 22 juin 1977, Bull. civ. II, n°158
- Civ. 2e, 17 juin 1998, n°96-15.211, Bull. civ. II, n°191
- Civ. 1re, 16 mars 1971, Bull. civ. I, n°80
- Civ. 1re, 19 mars 2015, n°12-24.274
- Civ. 2e, 7 juillet 2011, n°10-21.061, Bull. civ. II, n°152
- Y. Strickler, « Acquiescement », Répertoire de procédure civile, Dalloz, avril 2021