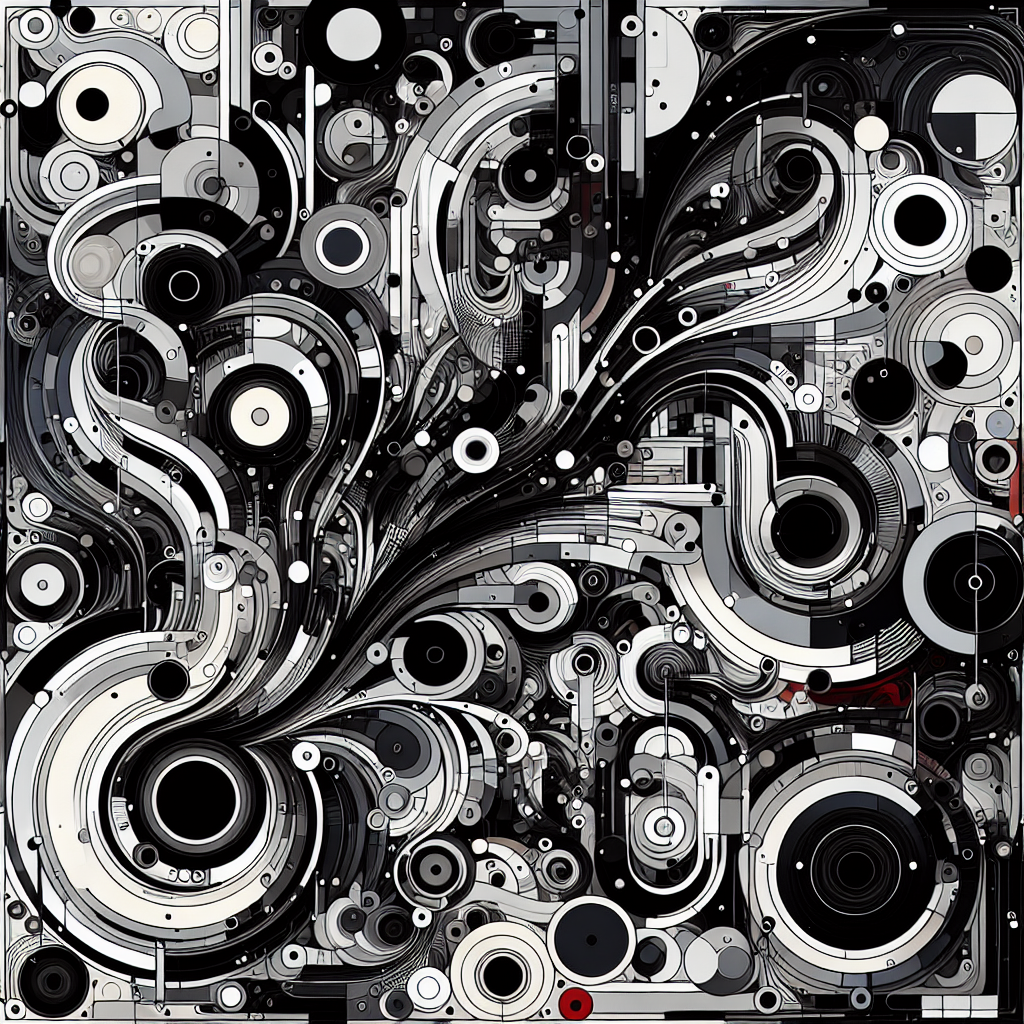En matière de recouvrement transfrontalier de créances, le titre exécutoire européen constitue un instrument juridique particulièrement efficace, mais dont les subtilités restent souvent méconnues des créanciers comme des débiteurs. Instauré par le règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004, ce mécanisme bouleverse la manière dont s’effectue l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne. Pour une compréhension complète de ce qu’est le TEE, de son origine et de son champ d’application, vous pouvez vous référer à notre article d’introduction sur le titre exécutoire européen.
Une révolution silencieuse dans l’exécution des décisions
Le principe central du titre exécutoire européen (TEE) est simple mais radical : une décision certifiée comme titre exécutoire européen dans un État membre est directement exécutoire dans tous les autres États membres (sauf le Danemark), sans procédure d’exequatur préalable.
« Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance » (article 5 du règlement n°805/2004).
La Cour de cassation l’a rappelé clairement dans un arrêt du 22 février 2012 : la décision certifiée comme TEE dans l’État d’origine « est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance » (Civ. 2e, 22 février 2012, n°10-28.379).
Comment fonctionne l’exécution concrète du TEE ?
Une exécution immédiate mais encadrée
Une fois certifiée dans l’État membre d’origine, la décision peut être présentée directement aux autorités d’exécution d’un autre État membre. Le créancier doit simplement fournir :
- Une expédition de la décision
- Une expédition du certificat de titre exécutoire européen
- Si besoin, une traduction du certificat
Cette simplicité opérationnelle ne signifie pas absence de règles. La procédure d’exécution elle-même reste gouvernée par la loi de l’État membre où l’exécution est recherchée (article 20, §1 du règlement). Cette simplicité est rendue possible par une procédure rigoureuse de certification en amont. Pour connaître les aspects pratiques de cette procédure et les garanties minimales à respecter, consultez notre article dédié à la procédure de certification du titre exécutoire européen.
Par exemple, si vous souhaitez exécuter en France un jugement allemand certifié comme TEE, les modalités pratiques de saisie suivront les règles françaises du code des procédures civiles d’exécution.
Des motifs de refus d’exécution extrêmement limités
C’est ici que réside la force redoutable du TEE. À la différence du régime général instauré par le règlement Bruxelles I bis (n°1215/2012), les motifs de refus d’exécution sont drastiquement réduits.
Le seul motif substantiel de refus est prévu à l’article 21 du règlement n°805/2004 : l’incompatibilité avec une décision antérieure rendue entre les mêmes parties, dans un litige ayant la même cause. Encore faut-il que trois conditions cumulatives soient remplies :
- La décision antérieure a été rendue dans l’État d’exécution ou peut y être reconnue
- L’incompatibilité n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée dans l’État d’origine
- La décision antérieure concerne les mêmes parties et le même litige
La Cour fédérale de justice allemande a confirmé cette approche restrictive dans un arrêt du 24 avril 2014, en affirmant qu’aucun contrôle de l’ordre public n’est possible dans l’État d’exécution (BGH, 24 avril 2014, VII ZB 28/13).
La suspension ou limitation de l’exécution : une soupape de sécurité limitée
L’article 23 du règlement autorise la juridiction de l’État d’exécution à suspendre ou limiter l’exécution dans certaines circonstances restrictives, notamment lorsque le débiteur a formé un recours contre la décision ou demandé le retrait du certificat dans l’État d’origine.
La Cour d’appel de Lyon a rappelé (14 octobre 2010, n°09/04873) que « l’appréciation des normes minimales prévues par l’article 18 du règlement relève du recours dans l’État membre d’origine », et que la suspension de l’exécution ne peut être demandée devant la juridiction de l’État d’exécution que si un recours a déjà été formé dans l’État d’origine.
Un instrument avantageux mais contesté
Les avantages concrets pour le créancier
Comparé au régime général du règlement Bruxelles I bis, le TEE présente un avantage majeur : l’impossibilité d’invoquer la violation de l’ordre public comme motif de refus d’exécution. Cette restriction avantage considérablement le créancier.
Pour les entreprises engagées dans des transactions transfrontalières, cet instrument peut considérablement réduire les délais et coûts de recouvrement. Imaginez une PME française ayant obtenu un jugement contre un client allemand : avec un TEE, elle peut directement saisir un huissier allemand sans passer par les fourches caudines d’une procédure supplémentaire.
Critiques et inquiétudes
Plusieurs juristes ont émis des réserves sur ce mécanisme. L. D’Avout souligne que le TEE « aboutit à un véritable dérèglement du droit de l’exécution forcée transfrontière » et appelle à « rétablir la traditionnelle réserve de l’atteinte manifeste à l’ordre public local et aux droits fondamentaux individuels » (L. D’Avout, Rev. crit. DIP 2006, p. 1).
La question est d’autant plus pertinente que le TEE peut s’appliquer à des jugements rendus par défaut, où le silence du débiteur est assimilé à une reconnaissance tacite de la créance. Dans ces situations, les garanties procédurales peuvent sembler insuffisantes.
La place du TEE dans le paysage juridique européen
Avec l’adoption du règlement n°1896/2006 instaurant une procédure européenne d’injonction de payer et la suppression générale de l’exequatur par le règlement Bruxelles I bis, l’attrait initial du TEE s’est atténué.
Un rapport d’évaluation européen de 2017 constate que « dans de plus en plus d’États membres, le règlement relatif au titre exécutoire européen tend à perdre de l’importance » et que « la combinaison de ces instruments pourrait rendre obsolète le règlement TEE » (Rapport JUSR/2014/RCON/PR/CIVI/0082, p. 334).
Vers une harmonisation des procédures civiles européennes
Le TEE s’inscrit dans un mouvement plus large d’harmonisation des procédures civiles au sein de l’Union européenne. Le Parlement européen a adopté en 2017 une recommandation relative à des normes minimales communes pour les procédures civiles, qui contient une proposition de directive.
L’objectif est de renforcer la confiance mutuelle entre États membres, qui jusqu’à présent a été « davantage décrétée qu’avérée » comme le note R. Tinière (in Mélanges Oberdorff, 2015, p. 71).
Pour votre entreprise, comprendre ces évolutions permet d’optimiser votre stratégie de recouvrement transfrontalier. Un conseil juridique spécialisé peut vous aider à déterminer si le TEE représente l’option la plus adaptée à votre situation ou si d’autres instruments européens seraient plus efficaces. Le cabinet reste à votre disposition pour analyser vos créances transfrontalières et déterminer la stratégie la plus pertinente pour chaque situation. N’attendez pas que vos créances deviennent irrécouvrables : plus tôt vous agissez, plus grandes sont vos chances de recouvrement.
Sources
- Règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Civ. 2e, 22 février 2012, n°10-28.379, Bull. civ. II, n°36
- Cour d’appel de Lyon, 14 octobre 2010, n°09/04873, D. 2011. 1509, obs. A. Leborgne
- Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande), 24 avril 2014, VII ZB 28/13
- L. D’AVOUT, « La circulation automatique des titres exécutoires imposée par le règlement 805/2004 du 21 avril 2004 », Rev. crit. DIP 2006, p. 1
- « An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments », Rapport JUSR/2014/RCON/PR/CIVI/0082, 2017
- Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis)