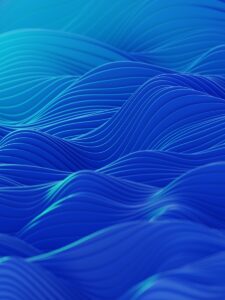Dans l’arsenal juridique français, l’injonction de faire reste méconnue des non-juristes. Pourtant, cette procédure simplifiée peut contraindre un cocontractant à s’exécuter quand il rechigne à remplir ses obligations. Mais comment la distinguer d’autres procédures similaires ? Quand l’utiliser plutôt qu’une injonction de payer, un référé ou d’autres alternatives ?
Injonction de faire vs injonction de payer
Points communs structurels
Les deux procédures partagent une architecture similaire, comme le souligne le Professeur Laher : elles combinent une phase non contradictoire suivie d’une phase contradictoire (art. 1425-1 et suivants du Code de procédure civile). Cette structure crée ce que la doctrine nomme une « inversion du contentieux » – le juge ordonne d’abord, puis les parties débattent ensuite si nécessaire.
Les deux procédures visent à accélérer le règlement de litiges simples. Elles permettent d’obtenir rapidement une décision sans passer par une procédure classique plus longue.
Différences fondamentales
La différence essentielle tient à l’objet de la demande :
- L’injonction de payer concerne uniquement les créances pécuniaires
- L’injonction de faire vise l’exécution en nature d’une obligation contractuelle de faire
Un fossé sépare aussi leur efficacité. L’ordonnance d’injonction de payer non contestée acquiert force exécutoire. À l’inverse, l’ordonnance d’injonction de faire n’a jamais « les effets d’un jugement contradictoire », même exécutée volontairement (art. 1425-4 du CPC).
La compétence territoriale diffère également. Alors que l’injonction de payer relève exclusivement du tribunal « du lieu où demeure le débiteur » (art. 1406 CPC), l’injonction de faire offre une option au demandeur, qui peut saisir le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation (art. 1425-2 CPC).
Impact de la dématérialisation
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a creusé davantage le fossé entre ces deux procédures en créant une procédure nationale dématérialisée pour les injonctions de payer. L’injonction de faire, elle, reste ancrée dans un formalisme papier traditionnel.
Injonction de faire vs injonction de délivrer ou de restituer
Cadres d’application distincts
Ces procédures ciblent des obligations différentes. L’injonction de délivrer ou de restituer (art. R. 222-11 du Code des procédures civiles d’exécution) concerne uniquement la remise d’un bien meuble déterminé. L’injonction de faire couvre un spectre plus large d’obligations contractuelles.
Divergences procédurales majeures
La plus grande différence réside dans leurs effets. L’injonction de délivrer/restituer permet d’obtenir un titre exécutoire si le débiteur ne forme pas opposition, autorisant la saisie-appréhension sans commandement préalable si entreprise moins de deux mois après l’exécutoire (art. R. 222-16 CPCE). L’injonction de faire n’offre jamais cette possibilité.
L’injonction de délivrer relève du juge de l’exécution, tandis que l’injonction de faire appartient au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire selon les cas (art. 1425-1 CPC).
Injonction de faire vs référé
Le référé, alternative historique
Avant la création de l’injonction de faire en 1988, le législateur avait d’abord privilégié la voie du référé pour les obligations de faire. Le décret n°85-1330 du 17 décembre 1985 avait adapté les textes pour permettre ce qu’on appelle parfois le « référé injonction de faire ».
Zones de recoupement
Les deux procédures visent l’exécution rapide d’obligations. Le référé peut, comme l’injonction de faire, ordonner l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Il s’avère particulièrement utile quand l’obligation n’est « pas sérieusement contestable » (art. 835 CPC).
Choix tactique entre les procédures
En pratique, de nombreux praticiens préfèrent recourir au référé malgré l’existence de l’injonction de faire. Pourquoi ? Le référé offre une procédure contradictoire dès le départ, ce qui évite les aléas de l’injonction de faire où le juge peut rejeter la requête initiale sans débat.
Le référé bénéficie d’une jurisprudence abondante et d’une pratique bien établie. L’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit, contrairement à l’injonction de faire qui manque de force exécutoire.
Quand choisir l’injonction de faire plutôt qu’un référé ? Elle peut s’avérer plus simple et moins coûteuse pour des obligations contractuelles simples où la valeur n’excède pas 10 000 euros.
Autres formes d’injonctions dans le paysage juridique
Les injonctions en droit des sociétés
Le droit des sociétés connaît ses propres mécanismes d’injonctions (art. L. 238-1 et suivants du Code de commerce). Mais attention à ne pas confondre : ces injonctions ne prévoient aucun mécanisme d’inversion du contentieux comparable à celui de l’injonction de faire du Code de procédure civile.
Les injonctions administratives
Dans le contentieux administratif, l’injonction a connu un développement significatif. La décision CE 1er mars 2012, Société assistance conseil informatique professionnelle, a même été saluée comme offrant « un moyen pertinent et efficace […] pour contraindre le cocontractant de l’Administration à s’exécuter. »
Un renouveau des injonctions ?
Certains auteurs, comme S. Zeindenberg, évoquent un « renouveau des injonctions de faire » depuis une vingtaine d’années. La reconnaissance explicite par l’ordonnance du 10 février 2016 du droit du créancier de poursuivre l’exécution en nature (art. 1221 du Code civil) a renforcé la légitimité de ces procédures.
Malgré ce regain d’intérêt théorique, l’injonction de faire reste peu utilisée en pratique comparée à l’injonction de payer ou au référé. Son maintien dans la réforme de 2019 montre cependant que le législateur continue d’y voir un outil utile du dispositif procédural français.
Une réalité s’impose : chaque procédure a son terrain de prédilection. Pour l’obligation de faire face à un débiteur récalcitrant, l’expertise d’un avocat permet d’identifier la voie procédurale la plus adaptée à votre situation spécifique.
Sources
- Code de procédure civile, articles 1425-1 à 1425-9 (injonction de faire)
- Code de procédure civile, articles 1405 à 1425 (injonction de payer)
- Code des procédures civiles d’exécution, articles R. 222-11 et suivants (injonction de délivrer ou de restituer)
- Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- LAHER R., « Injonction de faire », Répertoire de procédure civile, Décembre 2020, Dalloz
- ZEINDENBERG S., « Le renouveau des injonctions de faire », Dr. et patr., novembre 2001, p. 74
- CE, 1er mars 2012, Société assistance conseil informatique professionnelle, req. n°354628
- PERROT R., « L’inversion du contentieux », in Justice et droits fondamentaux, Études offertes à Jacques Normand, 2003, Litec, p. 387