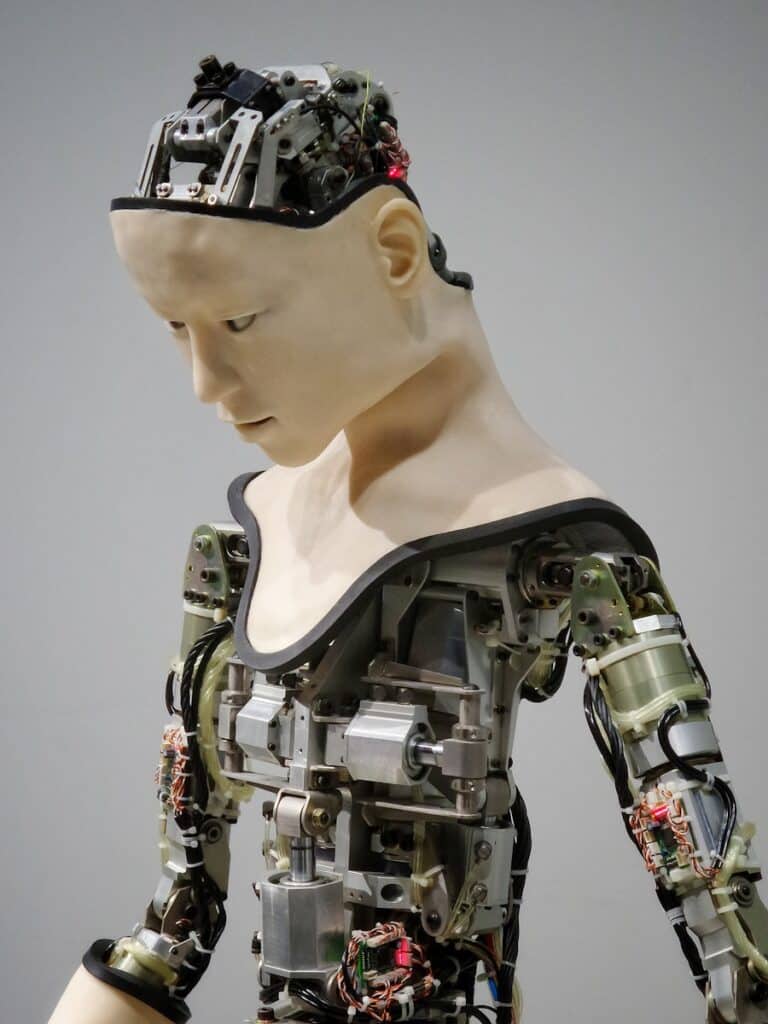« `html
L’injonction de payer constitue un outil précieux pour le recouvrement des créances. Mais saviez-vous qu’il existe des procédures spécifiques adaptées à certaines situations particulières? Ces variantes méritent notre attention car elles offrent des avantages stratégiques substantiels.
1. L’injonction pour le recouvrement des charges de copropriété
Un régime dédié aux syndicats de copropriétaires
Le législateur a créé une procédure spécifique pour les syndicats de copropriétaires. L’article 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 autorise explicitement le recours à l’injonction de payer pour récupérer les charges impayées. Cette disposition est née d’un besoin pratique : mettre fin aux débats sur la nature « contractuelle » ou non des charges de copropriété.
En pratique, le syndic peut déposer directement la requête sans avocat obligatoire. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 5 novembre 1975.
Une compétence territoriale spécifique
Particularité notable : contrairement à la procédure classique, l’injonction doit être portée devant la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Point de dérogation possible, même par convention contraire.
Le tribunal d’instance de Paris l’a rappelé sans ambiguïté dans sa décision du 30 juin 1981. Cette règle l’emporte sur les critères habituels de compétence territoriale.
2. Le recouvrement des cotisations par les caisses spécifiques
Un régime adapté aux organisations professionnelles
Les organisations interprofessionnelles agricoles et laitières bénéficient d’un régime d’injonction simplifié pour recouvrer leurs cotisations.
Les textes applicable sont :
- Pour les organisations laitières : l’article D. 632-10 du Code rural et de la pêche maritime
- Pour les organisations agricoles : l’article D. 632-8 du même code
Avantage majeur : pas besoin de prouver le caractère contractuel de la créance. Les cotisations sont recouvrables même si leur fondement n’est pas strictement contractuel.
Une mise en demeure préalable obligatoire
Contrairement à l’injonction classique, ces procédures imposent une mise en demeure formelle. Celle-ci doit être envoyée par lettre recommandée avec AR et rester infructueuse pendant quinze jours.
Un mécanisme de blocage des produits
Autre spécificité puissante : si l’injonction reste impayée et dépasse un seuil fixé par arrêté, l’organisation peut demander au directeur régional des douanes le blocage des produits en entrepôt. Cette mesure opère une pression considérable sur le débiteur.
Le débiteur se voit alors notifier cette saisine et dispose de 30 jours pour régler sa dette. À défaut, l’immobilisation des stocks est ordonnée. Une procédure similaire existe quand le débiteur a déjà fait l’objet d’une telle mesure dans les trois années précédentes.
3. La procédure de remboursement des allocations chômage
Un mécanisme de recouvrement automatique
Quand un tribunal condamne un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-4 du Code du travail prévoit le remboursement des allocations chômage versées au salarié. Le recouvrement s’effectue via une injonction spéciale définie aux articles R. 1235-1 et suivants.
Depuis le 1er janvier 2024, c’est France Travail (anciennement Pôle Emploi) qui porte l’action pour l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
Une compétence exclusive et centralisée
Seul le tribunal d’instance du domicile de l’employeur peut être saisi. Cette compétence est d’ordre public : tout autre juge doit se déclarer incompétent d’office.
Une procédure d’opposition avec particularités
Si l’employeur conteste, il dispose d’un mois pour former opposition. Mais la particularité notable se situe dans les motifs : s’il prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas exclu par la loi, le tribunal renvoie l’affaire à la juridiction qui a statué initialement.
Cette procédure permet de préserver l’autorité de la chose jugée entre l’employeur et le salarié, tout en garantissant les droits de la défense de l’employeur. Une opposition abusive ou dilatoire peut être sanctionnée par une amende civile de 15 à 1 500 euros.
4. Le recouvrement des dommages alloués dans une composition pénale
Une extension aux créances délictuelles
La procédure d’injonction, traditionnellement limitée aux créances contractuelles, a été étendue aux dommages et intérêts d’origine délictuelle dans deux cas précis :
- Suite à un procès-verbal constatant l’accord issu d’une médiation pénale (article 41-1, 5° du Code de procédure pénale)
- Après validation d’une composition pénale par le président du tribunal (article 41-2, alinéa 9 du même code)
Cette évolution permet aux victimes d’infractions de bénéficier du mécanisme rapide de l’injonction de payer, sans passer par un procès classique.
Un pont entre procédure pénale et civile
Dans ces deux cas, il suffit à la victime de présenter au juge civil soit le procès-verbal de médiation, soit l’ordonnance de validation de la composition pénale. Le code de procédure pénale renvoie expressément aux règles du code de procédure civile pour le déroulement de l’injonction.
Ce mécanisme illustre la porosité entre les deux ordres juridictionnels. Il offre des perspectives intéressantes pour des victimes souvent démunies devant la complexité habituelle des procédures.
Ces procédures spécifiques d’injonction de payer constituent des atouts stratégiques précieux. Bien que la procédure générale ait connu des réformes récentes, leur méconnaissance des spécificités de ces variantes peut conduire à des erreurs procédurales coûteuses. Pour sécuriser vos démarches et optimiser vos chances de recouvrement, n’hésitez pas à contacter notre cabinet. Nos avocats vous accompagneront dans l’identification de la procédure la plus adaptée à votre situation.
Sources
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967, article 60 (charges de copropriété)
- Code rural et de la pêche maritime, articles D. 632-8 et D. 632-10 (organisations interprofessionnelles)
- Code du travail, articles L. 1235-4 et R. 1235-1 à R. 1235-16 (allocations chômage)
- Code de procédure pénale, articles 41-1, 5° et 41-2, alinéa 9 (composition pénale)
- Loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 (création de France Travail)
- Cass. 2e civ., 5 novembre 1975 (rôle du syndic)
- TI Paris, 30 juin 1981, JCP 1982. II. 19846 (compétence territoriale en copropriété)
« `