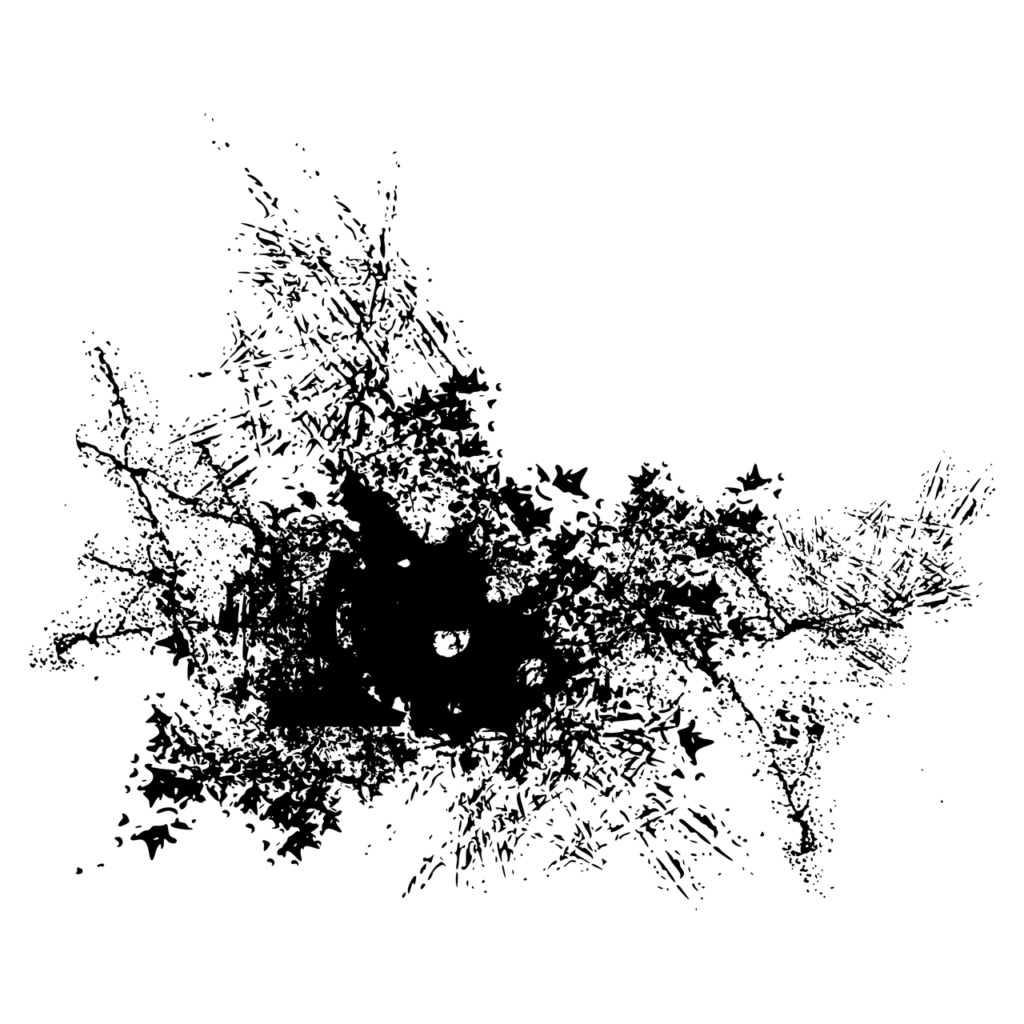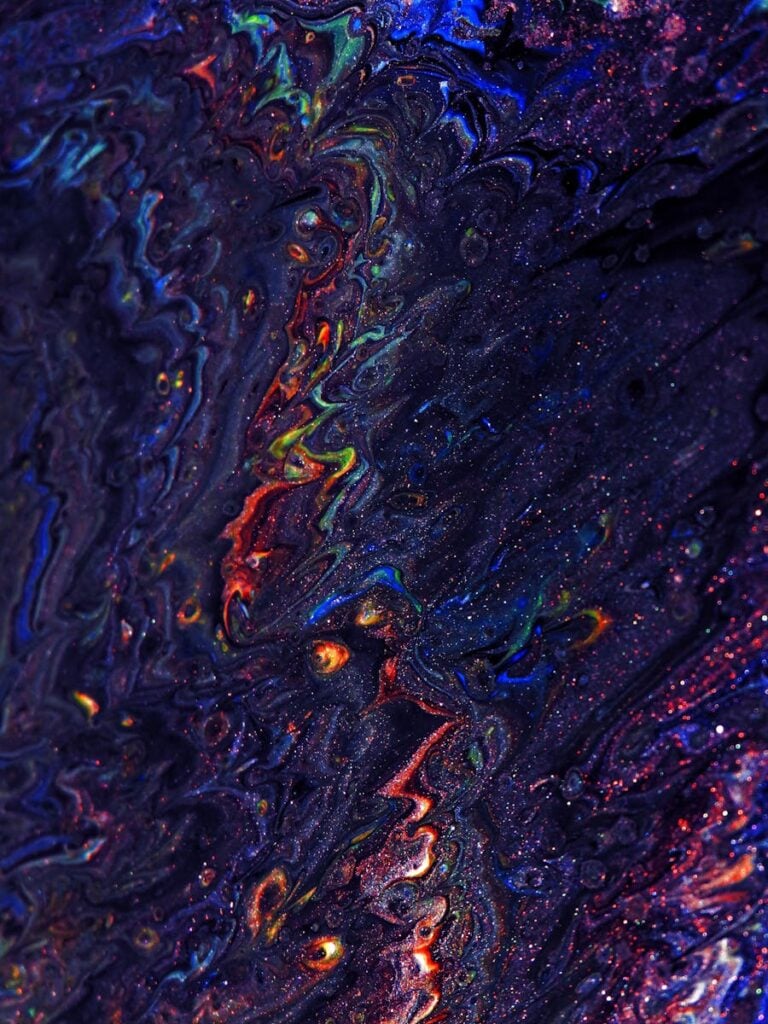Malgré les avancées législatives et les prises de conscience sociétales, la discrimination reste une réalité prégnante dans de nombreux aspects de la vie quotidienne : à l’embauche, dans l’évolution de carrière, pour l’accès à un logement, à un crédit ou même à certains services. Pour la personne qui en est victime, la discrimination est non seulement une injustice blessante, mais aussi un obstacle difficile à surmonter. Prouver une discrimination peut s’avérer ardu, et engager une action individuelle, souvent long et coûteux, peut sembler disproportionné ou intimidant.
Pourtant, lorsque des actes discriminatoires se répètent et touchent plusieurs personnes de manière similaire du fait d’un même auteur, le droit français offre un outil spécifique : l’action de groupe. Introduite plus largement par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (dite « loi J21 ») de 2016, elle vise à permettre une action collective pour faire cesser ces manquements et obtenir réparation des préjudices subis.
Cet article se penche sur les deux principales actions de groupe possibles en matière de discrimination : l’action de groupe « générale » et celle, plus spécifique, concernant les discriminations dans le cadre du travail. Nous examinerons qui peut agir, quels actes précis sont visés, quels types de préjudices peuvent être réparés et quelles sont les particularités de leur mise en œuvre.
L’action de groupe générale contre les discriminations (Loi de 2008 & J21)
Cette première action, prévue par l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et dont le cadre procédural est défini par la loi J21, vise les discriminations qui ne relèvent pas spécifiquement du droit du travail.
Qui est concerné ?
- Les victimes : L’action est ouverte lorsque « plusieurs personnes physiques » font l’objet d’une discrimination. Point important : seules les personnes physiques peuvent être membres du groupe. Les personnes morales (entreprises, associations…) victimes de discrimination ne peuvent pas bénéficier de cette action de groupe spécifique, même si le Code pénal reconnaît et sanctionne la discrimination à leur encontre (article 225-1, alinéa 2). C’est une limitation notable.
- Le responsable : L’action doit être dirigée contre « une même personne » (article 10 de la loi de 2008, repris par l’article 62 de la loi J21). Cette personne peut être physique ou morale (entreprise, administration, association…). Contrairement à l’action de groupe consommation, il n’est pas nécessaire que le responsable soit un « professionnel ». Cependant, le texte utilise le singulier (« une même personne »), ce qui semble exclure la possibilité d’agir contre plusieurs responsables conjointement dans une seule action de groupe, même s’ils ont participé ensemble à la discrimination. C’est une autre restriction potentiellement problématique.
- Les demandeurs : Qui peut lancer l’action ? La loi du 18 novembre 2016 (article 63) et la loi de 2008 (article 10) désignent certaines associations. Il faut distinguer :
- Les associations « régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause ». Le lien entre l’objet social de l’association et la discrimination visée doit être clair.
- Les associations « régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ». Ici, la loi semble se référer à l’activité concrète de l’association plutôt qu’à son seul objet statutaire. Cela soulève des questions : une association luttant contre le racisme peut-elle agir pour une discrimination liée à l’orientation sexuelle ? Le texte n’est pas explicite sur la nécessité d’une adéquation entre l’activité habituelle et l’action engagée.
- L’article 63 de la loi J21 mentionne aussi les associations « agréées ». Faut-il un agrément spécifique en plus de l’ancienneté et de l’objet statutaire ? L’articulation entre les textes n’est pas limpide sur ce point.
Quels actes discriminatoires sont visés ?
L’action de groupe peut être engagée lorsque les victimes font l’objet d’une « discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi [loi de 2008] ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne ».
- Discrimination directe ou indirecte : La loi n° 2008-496 définit précisément ces notions :
- Directe : Une personne est traitée moins favorablement qu’une autre dans une situation comparable, sur la base d’un critère interdit (origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, vulnérabilité économique, patronyme, lieu de résidence, état de santé, handicap, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, opinions politiques, activités syndicales, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, nation, race ou religion…). La liste est longue et vise à couvrir un large spectre de situations.
- Indirecte : Une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantage particulièrement des personnes partageant un même critère interdit, sauf si cette disposition est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens sont nécessaires et appropriés.
- La loi inclut aussi le harcèlement discriminatoire (agissement lié à un motif interdit portant atteinte à la dignité ou créant un environnement hostile) et le fait d’enjoindre à discriminer.
- Fondée sur d’autres « dispositions législatives en vigueur » ? Cette mention ouvre potentiellement la porte à des actions fondées sur des discriminations définies ailleurs, par exemple dans le Code pénal (bizutage, harcèlement sexuel ?). L’interprétation reste toutefois incertaine.
- Fondée sur un « même motif » : Cette exigence soulève un débat. Faut-il que toutes les victimes aient été discriminées exactement pour la même raison (ex: toutes refusées à cause de leur âge) ? Ou peut-on regrouper des victimes discriminées pour des motifs différents (âge, origine, sexe…) si ces discriminations découlent d’un même comportement ou d’une même politique globale du responsable (ex: politique de recrutement biaisée) ? La seconde interprétation semble plus logique au regard de l’esprit de l’action de groupe, mais la lettre du texte pourrait conduire à une approche plus restrictive.
Quels préjudices peuvent être réparés ?
Un point positif notable : contrairement à l’action de groupe consommation, l’action en matière de discrimination n’est pas limitée quant à la nature des préjudices réparables. Les textes (loi J21 et loi de 2008) visent la réparation des « préjudices subis » sans autre précision.
Cela signifie que peuvent être indemnisés :
- Les préjudices matériels (perte de revenus, frais engagés…).
- Les préjudices moraux (souffrance psychologique, atteinte à la dignité, préjudice d’anxiété…). Cette inclusion du préjudice moral est essentielle en matière de discrimination, où l’atteinte est souvent avant tout psychologique.
Même si les textes ne le mentionnent pas aussi explicitement que pour l’action consommation, il est admis que l’action vise bien la réparation des préjudices individuels de chaque membre du groupe, et non un « préjudice collectif » abstrait.
Action en cessation possible
En plus de la réparation, l’action de groupe discrimination peut aussi viser à « la cessation du manquement » (article 10 loi 2008 et article 62 loi J21). L’objectif est alors d’obtenir du juge qu’il ordonne au responsable de mettre fin à la pratique discriminatoire pour l’avenir.
L’action de groupe spécifique aux discriminations au travail (Code du travail & J21)
La loi J21 a créé un régime spécifique, distinct de l’action générale, pour les discriminations survenant dans le cadre des relations de travail. Ce régime est défini aux articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du Code du travail.
Qui est concerné ?
- Les victimes : L’action est ouverte lorsque plusieurs « candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés » sont victimes de discrimination (article L. 1134-7 C. trav.).
- Le responsable : Il s’agit nécessairement d’un seul employeur (article L. 1134-7 C. trav.). Comme pour l’action générale, il semble impossible d’agir contre plusieurs employeurs conjointement, même au sein d’un même groupe de sociétés, ce qui peut limiter la portée de l’action.
- Les demandeurs : Deux catégories d’acteurs peuvent lancer l’action :
- Les organisations syndicales de salariés représentatives (au niveau de l’entreprise, de la branche ou national interprofessionnel). Elles peuvent agir pour défendre les intérêts des candidats et des salariés.
- Les associations régulièrement déclarées depuis 5 ans « intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ». Attention : la loi limite explicitement la capacité d’action de ces associations à la défense des intérêts des candidats à un emploi ou à un stage uniquement. Elles ne peuvent donc pas lancer d’action de groupe pour des salariés déjà en poste victimes de discrimination. C’est une restriction importante par rapport aux syndicats.
Quels actes discriminatoires sont visés ?
L’article L. 1134-7 vise une « discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 [du Code du travail] et imputable à un même employeur ».
- Motifs de discrimination : L’article L. 1132-1 du Code du travail liste les motifs interdits (origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance ethnique/nationale/raciale, opinions politiques, activités syndicales, convictions religieuses, apparence physique, nom, lieu de résidence, état de santé, handicap…). Cette liste est très proche de celle de la loi de 2008, mais présente quelques différences (elle mentionne les « activités mutualistes », absentes de la loi 2008, par exemple). L’articulation entre les deux textes en cas de divergence n’est pas parfaitement claire. L’article L. 1132-1 renvoie à la loi de 2008 pour la définition de la discrimination directe/indirecte, ce qui devrait permettre d’inclure le harcèlement discriminatoire.
- Fondée sur un « même motif » : L’interrogation est la même que pour l’action générale : faut-il une identité stricte du motif pour toutes les victimes ou un comportement discriminatoire global de l’employeur suffit-il ?
Quels préjudices peuvent être réparés ?
Comme pour l’action générale, tous les types de préjudices (matériels et moraux) subis individuellement par les candidats ou salariés peuvent en principe être réparés (article L. 1134-8 C. trav.).
Cependant, une restriction majeure et très critiquée a été introduite par l’article L. 1134-8, alinéa 2 : « sauf en ce qui concerne les candidats […], sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9 » (cette demande étant la mise en demeure préalable, voir ci-dessous).
Conséquence : Pour les salariés (et non les candidats), l’action de groupe ne permet pas d’obtenir réparation pour des discriminations passées (licenciement discriminatoire ancien, blocage de carrière sur plusieurs années, écarts de salaires historiques…). Seuls les préjudices apparus après que l’employeur ait été formellement mis en demeure de cesser la discrimination peuvent être indemnisés via cette action. Cela vide largement l’action de groupe de son intérêt pour réparer les discriminations subies par les salariés en poste, la reléguant principalement à un rôle préventif ou à la réparation de discriminations très récentes et persistantes après la mise en demeure. Les salariés victimes de discriminations anciennes devront toujours privilégier l’action individuelle.
Action en cessation possible
L’action de groupe discrimination au travail peut aussi, comme l’action générale, viser la cessation du manquement (article L. 1134-8 C. trav.).
Procédure : points communs et différences notables
Si les deux actions de groupe (générale et travail) partagent un cadre procédural commun issu de la loi J21, des différences importantes existent, notamment au démarrage :
- Mise en demeure préalable OBLIGATOIRE : C’est une étape incontournable pour ces deux actions (contrairement à l’action consommation ou santé).
- Pour l’action générale, une mise en demeure classique doit être envoyée au responsable présumé, et l’action en justice ne peut être introduite qu’après un délai de 4 mois suivant sa réception (article 64 loi J21).
- Pour l’action travail, une procédure spécifique est prévue à l’article L. 1134-9 du Code du travail. Le syndicat ou l’association doit demander à l’employeur de faire cesser la discrimination alléguée. L’employeur a 1 mois pour informer le CSE et les syndicats représentatifs, et doit engager une discussion si demandée. L’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après cette demande (sauf si l’employeur rejette la demande avant). Le non-respect de cette mise en demeure entraîne l’irrecevabilité de l’action.
- Compétence judiciaire : C’est le Tribunal Judiciaire qui est compétent pour connaître de ces actions de groupe, y compris pour les discriminations au travail (et non le Conseil de Prud’hommes, sauf peut-être pour l’action en cessation seule ? L’articulation reste incertaine).
- Régime de réparation : Les deux actions suivent globalement le régime « droit commun J21 » pour la phase de réparation. Cependant :
- Pour l’action générale, le juge peut choisir entre une procédure collective de liquidation (si les conditions sont réunies) ou une procédure individuelle.
- Pour l’action travail, le Code du travail (L. 1134-10) semble imposer la procédure individuelle de réparation uniquement.
- Application dans le temps : Un point commun important et restrictif : ces actions de groupe (générale et travail) ne sont applicables qu’aux faits générateurs de responsabilité (la discrimination elle-même) postérieurs au 20 novembre 2016 (date d’entrée en vigueur de la partie de la loi J21 les concernant). Les discriminations antérieures ne peuvent pas faire l’objet de ces actions de groupe.
Les actions de groupe en matière de discrimination offrent une voie de recours collectif, mais leurs conditions et limites sont strictes, en particulier pour les discriminations au travail concernant les salariés. Si vous êtes confronté à une situation discriminatoire répétée touchant plusieurs personnes, notre cabinet peut vous aider à déterminer si une action de groupe est envisageable et pertinente.
Sources
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (Articles 60, 62, 63, 64, 66 et s.)
- Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (Article 1er, 10)
- Code du travail (Articles L1132-1, L1134-6 à L1134-10)
- Code de procédure civile (Articles 849 et s.)