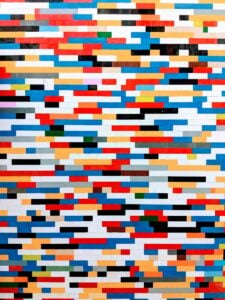Si l’assurance maritime offre un filet de sécurité indispensable aux activités en mer, c’est bien le contrat qui en tisse les mailles. Ce document, ou ensemble de documents, formalise l’accord entre l’assureur et l’assuré, définissant l’étendue des garanties, les obligations de chacun et les conditions d’indemnisation. Pour les professionnels du secteur maritime, même non juristes, comprendre les mécanismes de formation, les éléments essentiels et la vie de ce contrat est fondamental pour naviguer sereinement dans leurs activités. Dans ce contexte, il est essentiel d’anticiper les risques et de s’assurer que toutes les couvertures nécessaires sont en place. Une connaissance approfondie des clauses contractuelles peut également éviter des malentendus qui pourraient coûter cher en cas de sinistre. Ainsi, maîtriser ces aspects permet aux professionnels de protéger efficacement leurs intérêts et ceux de leurs clients. Une préparation adéquate inclut également une veille sur l’évolution des législations et des pratiques du secteur. En effet, être proactif face aux modifications réglementaires permet de mieux ajuster les couvertures d’assurance et de réagir rapidement en cas de sinistre en assurance maritime. Ainsi, une vigilance constante assure non seulement la sécurité des opérations, mais également la pérennité des activités professionnelles. L’assurance maritime implique également une évaluation précise des risques liés à chaque opération, ce qui peut varier considérablement en fonction du type de navire, de la cargaison et des itinéraires empruntés. En outre, les fluctuations du marché et les conditions climatiques peuvent influencer la nature de l’assurance maritime, rendant d’autant plus crucial le recours à des experts pour une analyse approfondie. Ainsi, intégrer ces éléments stratégiques dans leur démarche permet aux professionnels de mieux anticiper les imprévus et d’optimiser leurs couvertures.
Quelles sont les règles qui gouvernent la naissance de cet accord ? Quels en sont les points névralgiques à surveiller ? Comment se déroule son exécution au quotidien et que se passe-t-il lorsque les circonstances initiales évoluent ? Cet article vous guide à travers les étapes clés de la vie du contrat d’assurance maritime, de sa conclusion à ses éventuelles modifications.
La formation du contrat : entre liberté et garde-fous
Contrairement aux assurances destinées aux particuliers (comme l’assurance habitation ou auto), où la loi impose un formalisme protecteur important, l’assurance maritime est traditionnellement placée sous le signe de la liberté contractuelle. Ce principe s’explique par la nature de ses acteurs : des professionnels considérés comme avertis, capables de négocier et de défendre leurs intérêts face aux assureurs. Moins de règles impératives signifient plus de souplesse pour adapter les garanties aux besoins spécifiques d’une expédition ou d’une flotte.
Cette liberté n’est cependant pas absolue. Le législateur a prévu des garde-fous relevant de l’ordre public, c’est-à-dire des règles auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, même d’un commun accord. L’article L. 171-2 du Code des assurances liste ces dispositions impératives. Elles visent moins à protéger une partie faible qu’à préserver les fondements mêmes de l’opération d’assurance. On y trouve par exemple :
- L’interdiction pour une personne n’ayant subi aucun préjudice de réclamer le bénéfice de l’assurance (article L. 171-3), rappelant le principe indemnitaire.
- Les sanctions applicables en cas de fausse déclaration intentionnelle du risque par l’assuré (nullité du contrat, article L. 172-2).
- L’impossibilité de garantir les conséquences de la faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré (article L. 172-13).
Au-delà de ces limites légales, la réalité de la formation du contrat est fortement influencée par la pratique des polices types. Élaborées par les organisations professionnelles d’assureurs, ces documents standardisés constituent la base de la très grande majorité des contrats d’assurance maritime. Si elles offrent l’avantage d’une certaine harmonisation et sécurité juridique, elles confèrent souvent au contrat les caractéristiques d’un contrat d’adhésion, où la marge de négociation de l’assuré peut être limitée, sauf pour les acteurs économiques les plus puissants. Cette prédominance des polices types a une conséquence importante : leur interprétation en cas de litige se fonde moins sur la recherche d’une hypothétique « commune intention des parties » que sur l’analyse objective du sens des clauses standardisées.
Au cœur du contrat : les éléments indispensables
Qu’il soit basé sur une police type ou négocié spécifiquement, tout contrat d’assurance maritime repose sur des éléments fondamentaux qui en déterminent l’équilibre. Deux d’entre eux méritent une attention particulière : la valeur assurée et l’aléa.
La valeur d’assurance : déterminer le montant de la garantie
Fixer une valeur aux biens assurés (navire, cargaison) dans le contrat est essentiel. Cette valeur sert de base au calcul de la prime et constitue la référence pour l’indemnisation en cas de sinistre. Elle permet aussi d’identifier d’éventuelles situations de sous-assurance ou de surassurance.
- Sous-assurance : Si la somme assurée est inférieure à la valeur réelle du bien au moment du sinistre, l’assuré reste son propre assureur pour la différence et ne sera indemnisé qu’au prorata (sauf clause contraire ou « valeur agréée »). C’est l’application de la règle proportionnelle de capitaux (article L. 172-10 du Code des assurances).
- Surassurance : Si la somme assurée dépasse la valeur réelle, et que cela résulte d’une intention frauduleuse de l’assuré, le contrat est nul. L’assureur peut alors conserver les primes déjà versées à titre de dédommagement (article L. 172-6, alinéa 1).
La manière dont cette valeur est déterminée varie :
- En assurance sur corps (le navire lui-même), on utilise fréquemment une valeur agréée. Les parties s’accordent forfaitairement sur une valeur au début du contrat, qui s’impose ensuite sauf en cas de fraude prouvée. Elle englobe généralement la coque, les moteurs, les équipements et dépendances.
- En assurance sur marchandises transportées (anciennement « facultés »), c’est au souscripteur de déclarer la valeur. Les polices types précisent souvent les bases acceptables : prix de revient majoré d’un profit espéré, valeur à destination selon les cours, prix de vente contractuel, ou valeur de remplacement pour les biens manufacturés (sous réserve de justifier du remplacement effectif).
L’aléa : une condition vitale
L’essence même de l’assurance est de couvrir un risque incertain, un événement futur dont la survenance ou la date de survenance est inconnue. Sans aléa, pas d’assurance valide. Cette condition est particulièrement scrutée en assurance maritime.
Imaginez assurer une cargaison qui a déjà été perdue en mer, ou un navire arrivé sain et sauf à destination. Cela n’aurait aucun sens. La loi est claire : une assurance conclue après la survenance du sinistre ou après l’arrivée à bon port de la chose assurée est sans effet si l’événement était connu au moment de la conclusion du contrat (article L. 173-3 du Code des assurances). La connaissance s’apprécie de manière assez large : il suffit que la nouvelle soit parvenue au lieu de souscription ou au lieu où se trouvait l’assuré, même sans preuve qu’il en ait eu personnellement connaissance.
Historiquement, une clause dite « sur bonnes ou mauvaises nouvelles » permettait de valider une assurance même si le bien était déjà perdu ou arrivé, à condition que personne (ni l’assuré, ni l’assureur) n’en ait eu connaissance. L’article L. 172-5 précise cependant que cette assurance est nulle si l’assuré connaissait le sinistre ou si l’assureur connaissait l’arrivée. En pratique, cette clause est devenue largement désuète avec les moyens de communication modernes.
Concrétiser l’accord : obligations et paperasse
La conclusion effective du contrat implique des obligations pour chaque partie et se matérialise par différents documents.
Les obligations lors de la conclusion
- Côté assureur : Contrairement au droit commun des assurances terrestres (article L. 112-2 du Code des assurances), la loi n’impose pas à l’assureur maritime une obligation formelle d’information précontractuelle (remise de fiche d’information, etc.). La présomption de professionnalisme de l’assuré dispense l’assureur de ce formalisme. Cela ne signifie pas pour autant qu’il peut induire son client en erreur ; un devoir général de loyauté et d’exactitude dans les informations fournies demeure.
- Côté souscripteur (qui peut être l’assuré lui-même, ou agir pour le compte d’un tiers déterminé ou « pour le compte de qui il appartiendra », article L. 171-4) : L’obligation principale est celle de déclarer spontanément et exactement toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge (article L. 172-19, 3°). C’est une obligation fondamentale. Le souscripteur doit aussi déclarer s’il a souscrit d’autres assurances pour le même intérêt et contre les mêmes risques (assurances cumulatives, article L. 172-8).
Les sanctions en cas de manquement à l’obligation de déclaration des risques par le souscripteur sont sévères :
- Omission ou déclaration inexacte intentionnelle (mauvaise foi) : L’assureur peut demander la nullité du contrat si cette déclaration erronée a pu diminuer sensiblement son opinion sur le risque (article L. 172-2). La prime reste acquise à l’assureur.
- Omission ou déclaration inexacte non intentionnelle (« bonne foi ») : La sanction est, en principe, la réduction de l’indemnité en cas de sinistre, selon la règle proportionnelle de prime (l’indemnité est réduite dans la proportion entre la prime payée et celle qui aurait dû l’être si le risque avait été correctement déclaré, article L. 172-3). Attention, particularité notable : contrairement à l’assurance terrestre où l’assureur doit prouver la mauvaise foi pour obtenir la nullité, en assurance maritime, c’est à l’assuré de prouver sa bonne foi pour échapper à la nullité et ne subir « que » la règle proportionnelle. Une inversion de la charge de la preuve qui souligne la rigueur du système envers le professionnel assuré.
Les documents matérialisant l’engagement
Si le contrat d’assurance est consensuel (il existe par le seul accord des volontés), la preuve de cet accord et de son contenu passe obligatoirement par un écrit (article R. 172-1 du Code des assurances). Plusieurs documents peuvent jouer ce rôle :
- La note de couverture : Document provisoire remis par l’assureur ou le courtier, attestant la garantie en attendant l’émission de la police définitive.
- L’arrêté d’assurance : Document souvent émis par le courtier et visé par l’assureur, valant contrat et engageant immédiatement au paiement de la prime.
- Le certificat d’assurance : Utilisé surtout en assurance marchandises, il permet au détenteur (souvent le réceptionnaire de la marchandise) de faire valoir ses droits directement auprès de l’assureur.
- Les avenants : Documents modifiant le contrat initial (extension de garantie, changement de conditions, résiliation…).
- La police d’assurance : C’est le document contractuel principal, rédigé par l’assureur. Il doit contenir des mentions obligatoires (identité des parties, risques garantis, somme assurée, prime, lieu et date de souscription, etc., article R. 172-3). Elle se compose souvent de « conditions générales » (le socle commun) et de « conditions particulières » (les adaptations spécifiques à l’assuré, qui priment sur les générales en cas de contradiction).
Le formalisme de ces documents est plus souple qu’en assurance terrestre : pas d’obligation légale d’utiliser des caractères très apparents pour les clauses de nullité ou d’exclusion, et l’usage de l’anglais (langue du commerce maritime international) est fréquent et admis.
Une nouveauté importante issue de la loi « Attractivité » de juin 2024 (article L. 112-5 du Code des assurances) : les polices d’assurance maritime (ainsi que aérienne, fluviale, etc.) peuvent désormais être établies, signées, conservées et surtout transférées sous forme électronique lorsqu’elles sont stipulées « à ordre » ou « au porteur », facilitant leur circulation comme de véritables titres négociables.
La vie du contrat : exécution et imprévus
Une fois conclu, le contrat produit ses effets et régit la relation entre l’assureur et l’assuré. Son exécution implique des obligations continues et doit pouvoir s’adapter aux changements.
Le début de la garantie : la « mise en risque »
- Pour les marchandises transportées, l’assurance prend effet au début des opérations de chargement et cesse à la fin du déchargement (avec des limites temporelles précises). L’article L. 173-17-1 prévoit aussi que si les risques n’ont pas commencé dans les deux mois suivant l’engagement, l’assurance est sans effet (sauf pour les polices « flottantes » ou « d’abonnement »).
- Pour le corps du navire, les règles dépendent du type de contrat (article L. 173-1 et suivants) : pour un voyage unique, la garantie court du début du chargement à la fin du déchargement (ou du démarrage à l’amarrage si voyage sur lest) ; pour une assurance « à temps » (pour une durée déterminée), les risques du premier et du dernier jour sont couverts. Les polices précisent souvent que la garantie s’applique en tout lieu (dans les limites géographiques prévues), que le navire soit en exploitation, en réparation, à flot ou à sec.
Les obligations en cours de contrat
L’exécution du contrat implique des devoirs pour l’assuré :
- Payer la prime : C’est l’obligation fondamentale. En cas de défaut de paiement, l’assureur peut suspendre la garantie ou demander la résiliation du contrat après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée. Le délai pour agir après mise en demeure est court : huit jours (article L. 172-20), contre quarante jours en assurance terrestre. Des règles spécifiques s’appliquent en cas de procédure collective de l’assuré (article L. 172-22). À noter : le droit de l’assureur de compenser les primes impayées avec l’indemnité due à un tiers bénéficiaire est désormais limité aux seules assurances sur marchandises transportées (article L. 172-21).
- Apporter des « soins raisonnables » : L’assuré doit veiller à la bonne conservation des biens assurés et prendre les mesures nécessaires pour prévenir les sinistres (article L. 172-19, 2°). Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Cependant, si l’assureur prouve que le dommage est dû à un « manque de soins raisonnables » de l’assuré pour mettre les objets à l’abri des risques, il peut être déchargé de sa garantie, même en l’absence de faute intentionnelle ou inexcusable (article L. 172-13).
Les modifications en cours de route
- Aggravation du risque : Si des circonstances nouvelles augmentent le risque (changement de zone de navigation vers une zone plus dangereuse, modification de la nature des marchandises transportées…), l’assuré doit les déclarer à l’assureur dans les trois jours où il en a connaissance, si cette aggravation est « sensible » (article L. 172-19, 4° et L. 172-3). Les conséquences sont complexes et dépendent de l’imputabilité de l’aggravation à l’assuré et de sa bonne ou mauvaise foi dans la déclaration (articles L. 172-2 et L. 172-3, dont la rédaction est notoirement confuse) : cela peut aller du maintien du contrat avec surprime, à la résiliation, voire à la nullité ou à l’application de la règle proportionnelle.
- Changements liés aux biens :
- L’aliénation (vente) ou l’affrètement coque nue du navire assuré transfère en principe l’assurance à l’acquéreur ou à l’affréteur (article L. 173-14). Cependant, ce dernier doit en informer l’assureur et remplir les obligations du contrat. L’assureur conserve la faculté de résilier le contrat dans le mois suivant la notification. En pratique, de nombreuses polices sur corps prévoient plus simplement la cessation automatique de l’assurance en cas de vente ou d’affrètement coque nue, sauf accord préalable.
- La constitution d’une hypothèque sur le navire doit souvent être déclarée à l’assureur selon les termes de la police.
- D’autres changements (pavillon, société de classification du navire) peuvent également nécessiter une déclaration selon le contrat.
- Changements liés aux parties : Le redressement ou la liquidation judiciaire de l’assuré (ou de l’assureur) entraîne des règles spécifiques, notamment la possibilité pour l’assureur de résilier le contrat en cas de primes impayées (article L. 172-22), mais cette résiliation ne peut nuire aux droits acquis par des tiers de bonne foi avant la notification.
Le contrat d’assurance maritime est donc un instrument vivant, dont la bonne exécution repose sur une compréhension claire de ses termes et un dialogue constant entre l’assuré et l’assureur, souvent facilité par l’intervention d’un courtier compétent.
Naviguer dans les clauses d’une police d’assurance maritime ou gérer les conséquences d’un changement de situation en cours de contrat peut s’avérer complexe. Pour sécuriser vos opérations et vous assurer que votre couverture est adéquate et correctement gérée, notre équipe se tient à votre disposition pour un accompagnement personnalisé.
Sources
- Code des assurances (Titre VII Livre Ier, notamment articles L.171-2, L.171-4, L.172-2, L.172-3, L.172-5, L.172-6, L.172-8, L.172-10, L.172-13, L.172-19 à L.172-22, L.173-1 à L.173-4, L.173-14, L.173-17-1, R.172-1, R.172-3, L.112-5)
- Code de commerce
- Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (pour les polices électroniques transférables)