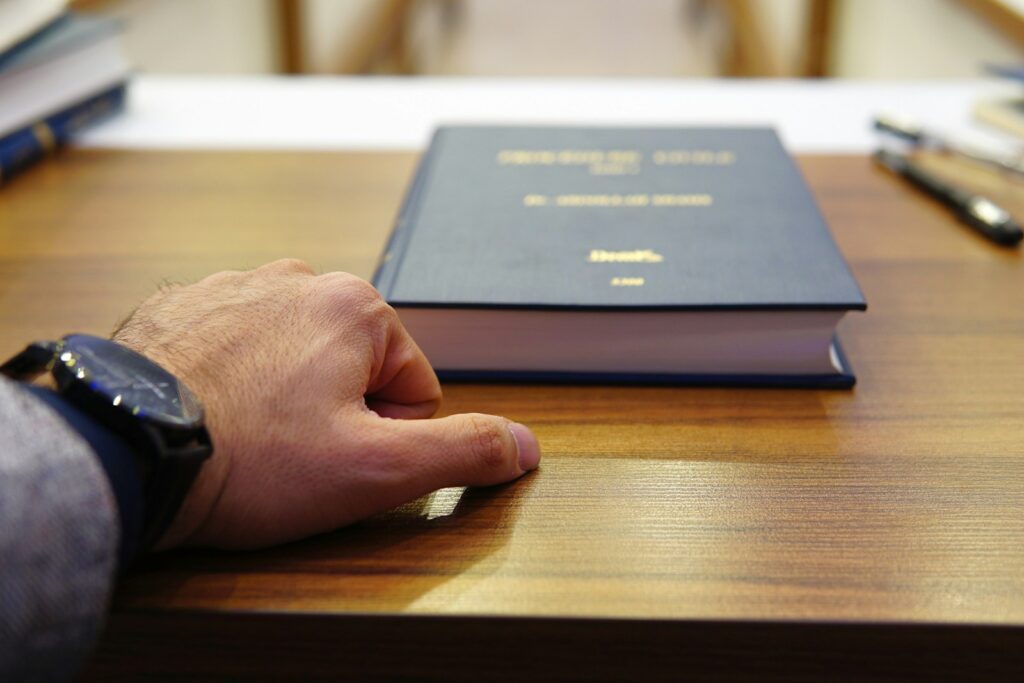Les ventes maritimes à l’arrivée représentent une catégorie particulière de contrats dans le commerce international. Contrairement aux ventes au départ plus courantes, elles se caractérisent par un transfert des risques reporté à l’arrivée des marchandises à destination. Cette particularité offre une sécurité accrue pour l’acheteur, mais implique des obligations spécifiques pour le vendeur. Deux formes principales existent en droit français: la vente sur navire désigné et la vente à l’embarquement, chacune répondant à des besoins commerciaux différents.
Caractéristiques communes des ventes à l’arrivée
Les ventes à l’arrivée se distinguent fondamentalement des autres ventes maritimes par leur logique de transfert des risques.
Le transport aux risques du vendeur
L’article L. 5424-6 du code des transports pose le principe essentiel: dans les ventes à l’arrivée, « la marchandise voyage aux risques et à la charge du vendeur ». Cette disposition constitue une différence majeure avec les ventes au départ comme les ventes FAS, FOB ou CIF, où les risques sont transférés à l’acheteur dès l’embarquement.
Cette répartition des risques correspond aux besoins de certains marchés spécifiques, notamment lorsque l’acheteur souhaite se prémunir contre les aléas du transport maritime ou lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer efficacement la marchandise. Elle peut aussi être préférée pour des marchandises particulièrement sensibles ou de grande valeur.
La conséquence directe de ce mécanisme est que si les marchandises périssent pendant le voyage, le vendeur en supporte les conséquences financières. Il ne pourra pas exiger de l’acheteur le paiement du prix pour des marchandises qui n’arriveront jamais à destination.
Les obligations générales du vendeur
Dans toute vente à l’arrivée, le vendeur doit naturellement organiser et financer le transport maritime, puisqu’il en supporte les risques. Contrairement aux ventes FOB ou FAS, il lui appartient de conclure le contrat de transport ou d’affrètement.
Le vendeur reste libre de souscrire ou non une assurance maritime. Toutefois, compte tenu des risques qu’il assume, une couverture d’assurance adéquate est fortement recommandée. Dans la pratique, les vendeurs optent presque systématiquement pour une assurance, dont ils répercutent généralement le coût dans le prix de vente.
La livraison effective des marchandises à l’arrivée constitue l’obligation fondamentale du vendeur. Cette livraison doit intervenir dans un délai raisonnable après l’arrivée du navire au port de destination.
Les obligations générales de l’acheteur
Les obligations de l’acheteur dans une vente à l’arrivée sont relativement simples. Il doit principalement:
- Payer le prix convenu, généralement après vérification de la conformité des marchandises
- Réceptionner les marchandises au port de destination
- Accomplir les formalités douanières à l’importation
L’acheteur n’a pas à s’occuper du transport ni de l’assurance, ce qui représente un avantage certain par rapport aux ventes au départ. En contrepartie, le prix de vente est généralement plus élevé pour tenir compte des risques et coûts supportés par le vendeur.
La vente sur navire désigné
Parmi les ventes à l’arrivée, la vente sur navire désigné présente des caractéristiques particulières qui lui confèrent un statut intermédiaire entre vente au départ et vente à l’arrivée.
Définition et caractéristiques juridiques
Selon l’article L. 5424-7 du code des transports, la vente sur navire désigné est une « vente à livrer de marchandises embarquées sur un navire déterminé pour le cas où elles arriveront à destination ». Le texte ajoute que le vendeur « doit aviser l’acheteur du nom du navire sur lequel les marchandises sont embarquées ».
Cette formule se caractérise par trois éléments essentiels:
- Il s’agit bien d’une vente à l’arrivée, car la livraison n’est due qu’à l’arrivée des marchandises à destination
- La marchandise est individualisée par son embarquement sur un navire spécifique, désigné à l’acheteur
- La vente porte sur un corps certain, identifié par la désignation du navire
La vente sur navire désigné est historiquement adaptée au transport par navires « tramps », c’est-à-dire des navires qui n’effectuent pas de lignes régulières mais sont affrétés pour des voyages spécifiques.
Obligations spécifiques du vendeur
Le vendeur dans une vente sur navire désigné doit:
- Conclure le contrat de transport maritime
- Embarquer la marchandise sur le navire désigné dans le contrat ou communiqué ultérieurement à l’acheteur
- Informer l’acheteur du nom du navire sur lequel la marchandise a été chargée
- Livrer la marchandise au port de destination
La désignation du navire est une obligation essentielle. Elle doit être précise et sans ambiguïté, permettant à l’acheteur d’identifier clairement le navire transportant sa marchandise. Cette désignation peut figurer dans le contrat initial ou être communiquée ultérieurement par le vendeur.
Une fois le navire désigné, le vendeur ne peut plus revenir sur cette désignation sans l’accord de l’acheteur. La désignation est irrévocable, car elle participe à l’individualisation de la marchandise.
Conséquences en cas de perte de la marchandise
La particularité la plus notable de la vente sur navire désigné réside dans les conséquences d’une perte de la marchandise pendant le transport. L’article L. 5424-7 du code des transports prévoit que « en cas de perte des marchandises, le vendeur n’est pas tenu de les remplacer si le sinistre est postérieur à la désignation du navire sur lequel elles ont été embarquées ».
Cette règle s’explique par le fait que la désignation du navire individualise la marchandise, qui devient un corps certain. Or, en droit commun de la vente, la perte fortuite d’un corps certain entraîne la résolution du contrat: le vendeur est libéré de son obligation de livraison, et l’acheteur de son obligation de paiement.
Le mécanisme est donc le suivant: si la marchandise périt après la désignation du navire, la vente est résolue. L’acheteur ne paie pas le prix, et le vendeur n’a pas à remplacer la marchandise. Cette solution diffère de celle applicable à la vente à l’embarquement, que nous allons maintenant examiner.
La vente à l’embarquement
La vente à l’embarquement constitue une variante plus souple de la vente à l’arrivée, offrant davantage de flexibilité au vendeur mais également une protection accrue pour l’acheteur en cas de perte des marchandises.
Définition et particularités
L’article L. 5424-8 du code des transports définit la vente à l’embarquement de manière assez succincte: « le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l’acheteur du nom de ce transporteur ». Contrairement à la vente sur navire désigné, le vendeur n’a pas à indiquer le nom du navire précis transportant la marchandise.
Cette formule est particulièrement adaptée au transport par lignes régulières (liners), où les marchandises peuvent être transbordées d’un navire à un autre pendant le voyage. Elle offre au vendeur une plus grande souplesse dans l’organisation logistique du transport.
Dans la vente à l’embarquement, la marchandise n’est pas individualisée lors de la remise au transporteur. Elle demeure une chose de genre jusqu’à son arrivée à destination, ce qui emporte d’importantes conséquences juridiques.
Distinction avec la vente sur navire désigné
La principale différence entre ces deux types de ventes à l’arrivée concerne l’individualisation de la marchandise:
- Dans la vente sur navire désigné, la marchandise est individualisée par son embarquement sur un navire spécifique désigné à l’acheteur
- Dans la vente à l’embarquement, la marchandise reste une chose de genre, puisque l’acheteur ne connaît que l’identité du transporteur, sans savoir sur quel navire précis elle voyage
Cette distinction peut sembler technique, mais ses conséquences pratiques sont considérables, notamment en cas de perte de la marchandise.
Obligation de réexpédition en cas de perte
L’article L. 5424-8, alinéa 2 du code des transports prévoit que « si la marchandise périt en cours de route, le vendeur doit réexpédier à l’acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat ».
Cette règle découle directement de la qualification de chose de genre: en droit commun, la perte d’une chose de genre n’éteint pas l’obligation du débiteur, car « les genres ne périssent pas » (genera non pereunt). Le vendeur reste donc tenu de livrer la quantité prévue au contrat, ce qui l’oblige à expédier une nouvelle marchandise en remplacement de celle qui a péri.
Il convient toutefois de noter que cette obligation de réexpédition ne s’applique pas si la vente porte sur des corps certains, comme le précise l’article L. 5424-8. Dans ce cas, on revient à la solution applicable à la vente sur navire désigné: la perte fortuite libère le vendeur de son obligation de livraison.
La vente à l’embarquement offre ainsi une protection renforcée à l’acheteur, qui a l’assurance de recevoir la marchandise commandée, même en cas de sinistre maritime. Cette sécurité explique en partie la popularité de cette formule dans certains secteurs du commerce international.
Les points d’attention et risques juridiques
La mise en œuvre des ventes à l’arrivée exige une attention particulière à certains aspects, source potentielle de litiges.
Désignation du navire/transporteur
Dans la vente sur navire désigné, la désignation précise et sans ambiguïté du navire est cruciale. Une désignation imprécise peut rendre incertaine l’individualisation de la marchandise et compromettre la qualification même du contrat.
Le moment de cette désignation revêt également une importance pratique considérable: plus le vendeur tarde à désigner le navire, plus il s’expose au risque de devoir remplacer la marchandise en cas de perte.
Dans la vente à l’embarquement, bien que les exigences soient moindres, le vendeur doit néanmoins veiller à informer correctement l’acheteur de l’identité du transporteur. Cette information est en effet indispensable pour permettre à l’acheteur de prendre livraison de la marchandise à l’arrivée.
Conformité des marchandises
Comme dans toute vente, la conformité des marchandises aux spécifications contractuelles constitue une obligation essentielle du vendeur. Dans les ventes à l’arrivée, la vérification de cette conformité s’effectue au port de destination, lors de la livraison effective.
Un point d’attention particulier concerne les clauses définissant les critères de conformité et les modalités de vérification. Ces clauses doivent être rédigées avec soin pour éviter les interprétations divergentes qui pourraient donner lieu à des contestations.
En pratique, il est souvent recommandé de prévoir l’intervention d’un expert indépendant pour constater l’état des marchandises à l’arrivée, notamment pour les produits sensibles ou de grande valeur.
Litiges fréquents et leur résolution
Les principaux litiges rencontrés dans les ventes à l’arrivée concernent:
- Le retard dans la livraison des marchandises
- La non-conformité des marchandises aux spécifications contractuelles
- Les contestations sur l’obligation de réexpédition en cas de perte
- Les désaccords sur la détermination du prix, notamment lorsqu’il est calculé en fonction de la quantité livrée
Pour prévenir ces litiges, une rédaction claire et précise des contrats est indispensable. Les parties doivent notamment définir sans ambiguïté:
- Les délais de livraison
- Les critères de conformité des marchandises
- Les procédures de vérification et d’agrément
- Les conséquences exactes d’un éventuel sinistre maritime
En cas de litige, les parties peuvent recourir aux différents modes de résolution des différends disponibles en matière de commerce international: négociation, médiation, arbitrage ou contentieux judiciaire. L’arbitrage maritime, qui permet de faire trancher le litige par des spécialistes du domaine, constitue souvent une solution adaptée aux spécificités des ventes maritimes.
Les ventes maritimes à l’arrivée constituent des outils contractuels précieux, offrant un équilibre différent des droits et obligations des parties par rapport aux ventes au départ. Leur mise en œuvre efficace suppose toutefois une connaissance approfondie de leurs mécanismes spécifiques et une attention particulière à la rédaction des clauses contractuelles.
La complexité de ces contrats et leurs enjeux financiers souvent considérables justifient pleinement le recours à un conseil juridique spécialisé, tant au stade de la négociation qu’en cas de difficultés d’exécution. Le financement de ces opérations, généralement assuré par crédit documentaire, ajoute une dimension supplémentaire qui doit être maîtrisée pour sécuriser l’ensemble de la transaction.
Si vous êtes confronté à des questions relatives aux ventes maritimes à l’arrivée ou si vous souhaitez sécuriser vos opérations commerciales internationales, notre cabinet spécialisé en droit maritime commercial peut vous accompagner dans l’élaboration de vos contrats et la défense de vos intérêts.
Sources
- Code des transports, articles L. 5424-6 à L. 5424-8
- Chambre de Commerce Internationale, Incoterms 2020
- Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM)