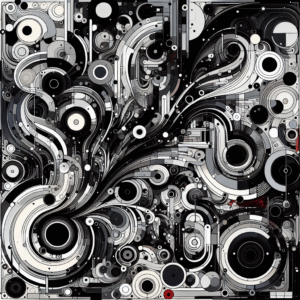La saisie conservatoire d’un navire est une procédure redoutable pour le créancier qui cherche à sécuriser sa créance. Elle entraîne l’immobilisation d’un actif de grande valeur, souvent au cœur de l’activité économique de son propriétaire. Toutefois, le caractère international du transport maritime engendre une complexité juridique singulière. Déterminer le droit applicable à une telle mesure est une étape fondamentale qui conditionne la validité et l’efficacité de toute la procédure. Cet article se propose d’approfondir les règles de conflit de lois et de juridictions qui régissent cette matière, en s’appuyant notamment sur les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1952. Une bonne compréhension de ces mécanismes est indispensable pour tout acteur économique confronté à un litige maritime. Pour une présentation générale, vous pouvez consulter notre guide complet sur la saisie conservatoire des navires. Notre cabinet d’avocats, fort de son expérience en voies d’exécution et en saisie de navire, accompagne ses clients dans la mise en œuvre de ces procédures complexes.
Introduction au droit applicable à la saisie conservatoire de navire
L’immobilisation d’un navire dans un port français en garantie d’une créance soulève immédiatement la question du droit applicable. Le navire est un bien meuble d’une nature particulière, un point de contact entre des ordres juridiques potentiellement différents : celui de son pavillon, celui de son port de saisie, celui de la résidence des parties ou encore celui du contrat à l’origine de la dette. Cette situation a conduit à l’élaboration de règles spécifiques pour organiser la matière.
Cadre légal et international (Convention de Bruxelles de 1952, droit français)
En France, la saisie conservatoire de navire est encadrée par une dualité de sources. D’une part, le droit interne, principalement codifié aux articles L. 5114-21 et L. 5114-22 du Code des transports, offre un cadre général. Il permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe d’obtenir l’autorisation de saisir un navire. D’autre part, la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, et ratifiée par la France, joue un rôle central. En vertu de la hiérarchie des normes, cette convention prime sur le droit interne lorsque ses conditions d’application sont réunies. Elle instaure un régime spécifique, notamment en limitant la saisie aux seules « créances maritimes » qu’elle énumère limitativement.
Distinction entre saisie conservatoire et saisie-exécution
Il est essentiel de ne pas confondre la saisie conservatoire et la saisie-exécution. La saisie conservatoire est une mesure provisoire. Son objectif est de garantir le paiement d’une créance dont l’existence n’est pas encore établie par un titre exécutoire. Elle vise à immobiliser le navire pour faire pression sur le débiteur et le contraindre à payer ou à fournir une garantie. La saisie-exécution, quant à elle, est une véritable voie d’exécution. Elle ne peut être engagée que sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Son but n’est plus l’immobilisation temporaire mais bien la vente forcée du navire pour désintéresser le créancier sur le prix obtenu. Cette dernière procédure est beaucoup plus rare en pratique, la saisie conservatoire étant l’outil privilégié des créanciers maritimes. Ces deux procédures obéissent à des régimes juridiques distincts qu’il convient de maîtriser.
Champ d’application de la Convention de Bruxelles de 1952
L’application de la Convention de Bruxelles de 1952 dépend principalement du pavillon du navire saisi. Le texte opère une distinction selon que le navire bat pavillon d’un État partie à la convention ou non, chaque situation ouvrant des droits différents pour le créancier saisissant.
Navires battant pavillon d’un état contractant et exceptions
Le principe posé par l’article 8, paragraphe 1, de la convention est clair : la convention s’applique à toute saisie pratiquée dans un État contractant (comme la France) sur un navire battant pavillon d’un autre État contractant. Dans ce cas, les dispositions de la convention, notamment celles relatives aux créances maritimes, sont impératives et écartent le droit interne français. La résidence du créancier ou du débiteur est indifférente. Ce principe connaît toutefois une exception notable, dictée par la logique : si la situation est purement interne, c’est-à-dire si la saisie a lieu en France, sur un navire battant pavillon français, et à la demande d’un créancier résidant en France, la convention s’efface au profit de la loi française. La convention prévoit également une faculté pour un État contractant de refuser l’application de ses dispositions à un ressortissant d’un État non contractant, mais la France n’a jamais fait usage de cette possibilité, le juge ne pouvant donc l’invoquer de sa propre initiative.
Navires battant pavillon d’un état non contractant
Lorsque la saisie est pratiquée en France sur un navire battant pavillon d’un État non partie à la Convention (par exemple, les États-Unis ou le Japon), l’article 8, paragraphe 2, offre une option stratégique au créancier. Il peut choisir de fonder sa demande soit sur le droit international, soit sur le droit interne. S’il choisit la première voie, il devra alléguer l’une des 17 créances maritimes limitativement énumérées par l’article 1er de la Convention. S’il opte pour la seconde, il pourra se prévaloir de n’importe quelle créance, même non maritime, à la seule condition que celle-ci paraisse « fondée en son principe » au sens de l’article L. 5114-22 du Code des transports. Cette flexibilité représente un avantage considérable pour le créancier dont la créance n’entrerait pas dans la liste restrictive des créances maritimes.
Interprétations jurisprudentielles et portée de la Convention
La portée exacte de l’article 8, paragraphe 2, a donné lieu à des débats jurisprudentiels nourris. La question était de savoir si ce texte se contentait d’élargir la liste des créances pouvant justifier une saisie (en y ajoutant celles du droit interne) ou s’il étendait l’application de l’ensemble des règles de fond de la Convention (notamment sur les navires saisissables) à la saisie d’un navire d’un État non contractant. La Cour de cassation a eu des interprétations fluctuantes. Dans un arrêt *Mediterranea* de 1999, elle a semblé retenir une interprétation restrictive, limitant l’application de la convention. Cependant, dans un arrêt *Sargasso* de 2000, elle a adopté une vision plus large, privilégiant l’application de l’ensemble de la convention. Cette dernière position semble aujourd’hui l’emporter, car elle évite de créer un régime plus favorable aux navires battant pavillon d’États non contractants, qui pourraient ainsi plus facilement échapper à la saisie. Cette interprétation est d’ailleurs confortée par l’esprit de la nouvelle Convention de Genève de 1999 (non encore largement ratifiée) qui prévoit son application à tout navire, qu’il batte ou non pavillon d’un État partie.
Conflits de lois et de juridictions en matière de saisie conservatoire de navire
L’internationalité inhérente aux activités maritimes place la saisie conservatoire au carrefour de multiples conflits de lois et de juridictions. La Convention de Bruxelles de 1952, bien que posant des règles de fond, ne règle pas tout et opère plusieurs renvois aux lois nationales, complexifiant la détermination du droit applicable à chaque étape de la procédure. Ces questions sont au cœur de la problématique des aspects internationaux des mesures conservatoires.
Droit applicable à la procédure (lex fori)
La règle est ici simple et clairement énoncée par l’article 6 de la Convention : les règles de procédure relatives à la saisie, à l’obtention de l’autorisation judiciaire et à tous les incidents qui peuvent en découler, sont régies par la loi du lieu où la saisie est pratiquée ou demandée. C’est le principe de la *lex fori* (la loi du for, c’est-à-dire du tribunal saisi). Ainsi, une saisie conservatoire pratiquée dans un port français sera soumise, pour sa mise en œuvre procédurale, au droit français, et plus spécifiquement aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et du Code des transports.
Responsabilité du saisissant (lex loci / lex fori)
Pratiquer une saisie conservatoire n’est pas un acte anodin. Si la saisie se révèle infondée ou abusive, elle peut causer un préjudice considérable au propriétaire du navire. La question de la loi applicable à la responsabilité du créancier saisissant est donc primordiale. La Convention de Bruxelles y répond en désignant, là encore, la loi du lieu où la saisie a été pratiquée ou demandée (*lex loci*). C’est donc le droit français qui déterminera les conditions dans lesquelles la responsabilité du créancier pourra être engagée pour une saisie jugée abusive dans un port français, notamment sur le fondement de la légèreté blâmable ou de la faute quasi-délictuelle.
Compétence du tribunal pour l’action au fond (forum arresti)
La saisie conservatoire n’est qu’une mesure provisoire. Le créancier doit ensuite engager une action sur le fond pour obtenir un titre exécutoire. Devant quel tribunal cette action doit-elle être portée ? La Convention de 1952 admet la compétence des juridictions de l’État où la saisie a eu lieu (principe du *forum arresti*), mais seulement si la loi interne de cet État leur attribue une telle compétence. Si ce n’est pas le cas, l’article 7 de la Convention énumère six cas limitatifs où le tribunal du lieu de la saisie sera malgré tout compétent. Ces cas incluent notamment la résidence du demandeur dans l’État de la saisie, le lieu de naissance de la créance, un abordage, une assistance, ou une créance garantie par une hypothèque. En dehors de ces hypothèses, la jurisprudence française a tendance à rejeter la compétence générale du *forum arresti*, exigeant que la compétence internationale des tribunaux français soit fondée sur d’autres critères de rattachement.
Inapplicabilité de la Convention de Bruxelles de 1952 et lois nationales
Lorsque la Convention de Bruxelles de 1952 n’a pas vocation à s’appliquer, par exemple dans le cadre d’une situation purement nationale, le juge doit se tourner vers les règles de conflit de lois pour identifier le droit applicable. La complexité demeure, car plusieurs systèmes juridiques peuvent potentiellement régir la saisie.
Rôle de la lex fori et de la lex navis
En l’absence de convention internationale applicable, deux principaux corps de règles entrent en compétition pour régir les conditions de fond de la saisie conservatoire : la *lex fori* (loi du tribunal saisi) et la *lex navis* (loi du pavillon du navire). La *lex causae*, c’est-à-dire la loi applicable à la créance elle-même (par exemple, la loi du contrat), n’est généralement pas retenue pour gouverner la saisie. La jurisprudence française, en la matière, ne dégage pas de principe absolu. Si la procédure de saisie reste soumise à la *lex fori*, le juge français peut, pour les conditions de fond, tenir compte de la *lex navis*, notamment en raison du lien étroit entre le droit de la saisie et celui des privilèges maritimes, souvent régis par la loi du pavillon. L’analyse au cas par cas par un avocat expert est donc déterminante pour élaborer la stratégie la plus adaptée.
La détermination du droit applicable à une saisie conservatoire de navire est un exercice technique qui requiert une analyse pointue des faits et une connaissance approfondie des conventions internationales et des règles de conflit de lois. Notre cabinet est à votre disposition pour analyser votre situation et défendre vos intérêts. N’hésitez pas à prendre contact avec nos avocats compétents en saisie de navire pour un accompagnement sur mesure.
Sources
- Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer
- Code des transports (notamment les articles L. 5114-21, L. 5114-22, R. 5114-15 et suivants)
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code civil