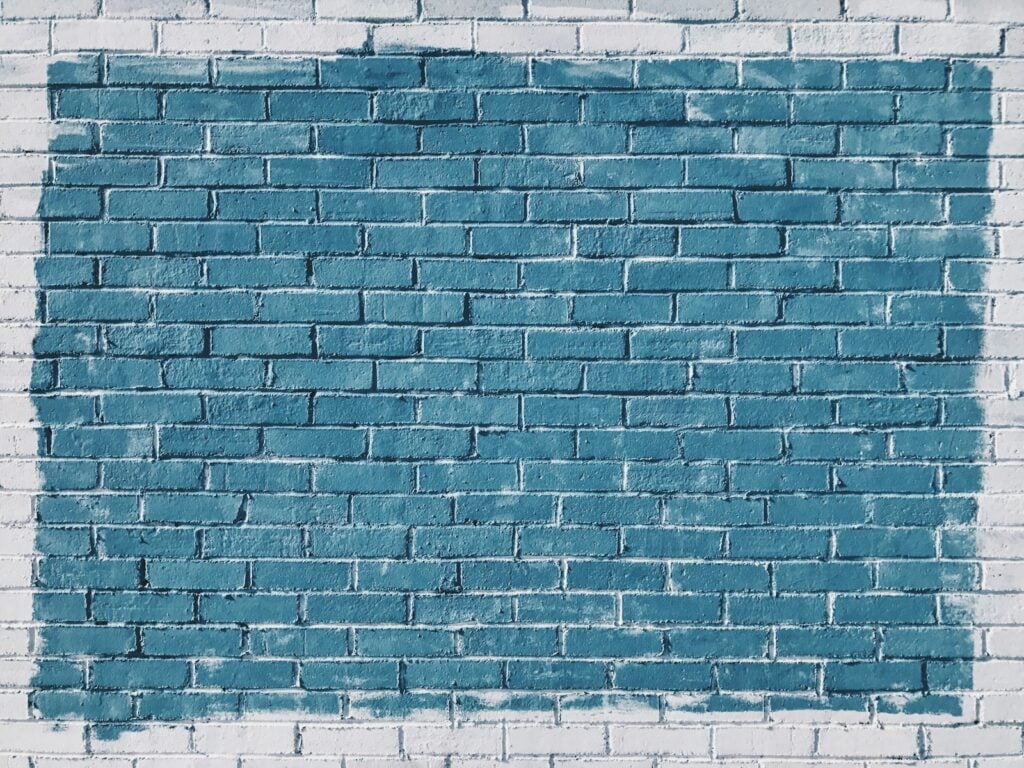La saisie-attribution est une procédure civile d’exécution incontournable pour tout créancier muni d’un titre exécutoire cherchant à obtenir le paiement d’une créance. Particulièrement efficace lorsqu’elle vise des sommes d’argent détenues par un tiers sur un compte, comme une banque, elle représente aujourd’hui la voie d’exécution la plus courante. Cependant, sa simplicité apparente masque une transformation juridique profonde, opérée par la grande réforme des procédures civiles d’exécution (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). Cet article se propose de revenir sur la genèse de ce mécanisme d’exécution, en analysant la rupture avec l’ancienne procédure de saisie-arrêt et en explorant la nature juridique de la saisie-attribution, véritable cession de créance forcée au profit du créancier.
De la saisie-arrêt à la saisie-attribution : les différences clés et l’évolution historique (loi de 1991)
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 (JORF 14 juillet 1991), la saisie des créances de sommes d’argent était régie par la procédure de saisie-arrêt, un mécanisme hérité de l’ancien Code de procédure civile (CPC) de 1806. Cette procédure d’exécution se caractérisait par sa complexité et sa lenteur. Elle présentait une nature hybride, se déroulant en deux temps distincts : une première phase, mesure purement conservatoire, initiée par l’acte de saisie qui rendait la créance indisponible, suivie d’une phase judiciaire obligatoire devant le juge. Le créancier devait impérativement obtenir une décision, un jugement de validité, pour que le tiers saisi reçoive l’ordre de lui verser les fonds sur son compte.
Le principal inconvénient de ce système, souvent dénoncé par la doctrine (notamment R. Perrot et P. Théry), résidait dans l’absence de droit propre du créancier sur la créance saisie durant toute la phase conservatoire. La créance demeurait dans le patrimoine du débiteur saisi, simplement frappée d’indisponibilité. En conséquence, le premier créancier saisissant n’était aucunement protégé contre un éventuel concours avec d’autres créanciers de son débiteur. Ces derniers pouvaient se joindre à la procédure et réclamer leur part sur les sommes saisies tant que le jugement de validité n’était pas rendu, créant une insécurité juridique et affaiblissant l’efficacité de l’exécution.
Face à ces lourdeurs, la loi du 9 juillet 1991, complétée par son décret d’application (Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), a opéré une rupture radicale en venant substituer la saisie-attribution à la saisie-arrêt. L’objectif du législateur était clair : simplifier la procédure d’exécution et en renforcer l’énergie. La réforme a abandonné le caractère hybride et la phase judiciaire systématique pour consacrer une mesure purement exécutoire, fondée sur un principe novateur : l’attribution immédiate de la créance au créancier saisissant. Si cette réforme a profondément modernisé la saisie de créances, il est essentiel de la situer au sein d’un panorama comparatif des différentes procédures de saisie pour en apprécier pleinement la portée et les spécificités en droit de l’exécution.
Le principe de l’attribution immédiate et de plein droit de la créance : une transformation juridique
Le cœur de la réforme de 1991 réside dans le principe de l’attribution immédiate et de plein droit, posé par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Ce texte, pierre angulaire de la nouvelle procédure, dispose que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ». Cette disposition transforme fondamentalement la nature et les effets de la saisie.
L’attribution est qualifiée d' »immédiate » car elle se produit dès la signification de l’acte de saisie par le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) au tiers saisi. À cet instant précis, la créance sort du patrimoine du débiteur pour intégrer celui du créancier saisissant, sans qu’il soit nécessaire d’attendre un quelconque jugement de validation du juge de l’exécution. Elle est également « de plein droit », ce qui signifie que cette opération s’opère automatiquement par le seul effet de la loi, sans qu’aucune autre formalité ou décision de justice ne soit requise.
Les conséquences directes de ce principe sont majeures. Premièrement, le tiers saisi, par exemple un établissement bancaire, devient personnellement débiteur du créancier saisissant (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-20.898). Il ne peut plus valablement se libérer de sa dette en payant son créancier originel, le débiteur saisi. S’il payait au mépris de la saisie, il s’exposerait à la sanction de payer une seconde fois. Deuxièmement, la créance ayant quitté le patrimoine du débiteur, elle ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle saisie par un autre créancier. Le premier saisissant est donc protégé de tout concours ultérieur, une avancée majeure en matière d’exécution forcée.
La saisie-attribution comme cession forcée de créance : implications et portée juridique
D’un point de vue doctrinal, et comme l’analysent de nombreux auteurs (dont Perrot et Théry), l’effet attributif immédiat confère à la saisie-attribution la nature d’une cession de créance forcée. Le créancier saisissant n’obtient pas un simple droit de préférence sur la créance de son débiteur ; il en devient le nouveau titulaire, comme si cette créance lui avait été cédée de force par l’autorité de justice. Cette qualification de cession forcée de créance ouvre des débats complexes sur la nature juridique des fonds saisis sur un compte bancaire, notamment pour la monnaie scripturale.
Cette analyse emporte des implications pratiques déterminantes. En tant que nouveau titulaire de la créance, qualifié d’ayant cause, le créancier saisissant acquiert tous les droits et actions qui y sont attachés. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que l’attribution porte sur la créance « ainsi que de tous ses accessoires », ce qui inclut notamment les sûretés qui la garantissaient. Cependant, dans une décision qui a surpris la doctrine, la Cour de cassation a jugé que seuls les accessoires « exprimés en argent » étaient transmis, excluant un privilège de prêteur de deniers (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-15.969), une interprétation critiquée par Roger Perrot pour sa formulation ambiguë.
En contrepartie de cette transmission, le créancier saisissant est également exposé aux mêmes défenses que le débiteur initial. Le tiers saisi peut lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre son créancier d’origine avant la saisie, comme la compensation d’une autre dette ou la nullité du contrat initial. C’est l’application directe du principe selon lequel nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a lui-même (Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet), un point fondamental en droit de l’exécution.
Conséquences de l’attribution immédiate face au concours des créanciers et aux procédures collectives
L’un des avantages les plus tangibles de la réforme de 1991 est la suppression du concours entre les créanciers chirographaires. En abandonnant le principe d’égalité qui prévalait dans la saisie-arrêt, l’attribution immédiate instaure un véritable « privilège du premier saisissant ». La règle est simple : le premier qui engage la mesure d’exécution est le premier servi, et ce, intégralement, dans la double limite de sa créance et des fonds disponibles sur le compte. La diligence du créancier est ainsi récompensée, une logique au cœur de l’efficacité de l’exécution.
Cette protection est particulièrement robuste, y compris face au risque de procédure collective. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution le stipule sans ambiguïté : « La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution ». Par conséquent, un créancier ayant pratiqué une saisie-attribution, même la veille du jugement d’ouverture, conserve le bénéfice de son action. La créance saisie ayant déjà quitté le patrimoine du débiteur, elle n’est pas intégrée dans l’actif de la procédure collective et échappe ainsi à la discipline commune.
L’efficacité de ce mécanisme d’exécution est également visible dans le contexte bancaire, où des conventions d’unité de compte ou de compensation peuvent lier plusieurs comptes d’un même client. En figeant les soldes au jour de la saisie, la saisie-attribution permet de clarifier une situation comptable parfois complexe et de garantir le paiement du créancier saisissant sur l’ensemble des avoirs disponibles, consolidant ainsi sa position, sous le contrôle du juge de l’exécution en cas de contestation sur le montant saisi.
Les racines de l’attribution immédiate : avis à tiers détenteur et paiement direct des pensions
Le principe de l’attribution immédiate, bien que révolutionnaire en 1991 pour la saisie de droit commun, n’est pas une création ex nihilo. Le législateur, s’appuyant sur le rapport du Garde des Sceaux de l’époque, Pierre Arpaillange, s’est inspiré de plusieurs procédures spéciales qui avaient déjà démontré leur efficacité en matière d’exécution.
La première source d’inspiration est l’avis à tiers détenteur (aujourd’hui la saisie administrative à tiers détenteur ou SATD), une procédure d’exécution pour le recouvrement des créances publiques. Cet outil permet à un comptable public d’obtenir directement le paiement de l’impôt en s’adressant aux tiers détenant des fonds pour le compte du redevable, avec un effet attributif immédiat. Sa simplicité et son efficacité ont logiquement servi de modèle.
La seconde source est la procédure de paiement direct des pensions alimentaires (loi du 2 janvier 1973). Instaurée pour garantir le versement rapide des pensions impayées, elle permet au créancier d’aliments de s’adresser directement à l’employeur du débiteur ou à sa banque pour obtenir le paiement mensuel de la pension. Là encore, le mécanisme repose sur un transfert direct de la créance. Enfin, le droit local d’Alsace-Moselle, qui disposait déjà de procédures d’exécution plus directes, a également influencé la réflexion ayant mené à cette réforme majeure du droit de l’exécution.
La réforme de 1991 a donc constitué une étape décisive dans la modernisation des voies d’exécution. En remplaçant la saisie-arrêt par la saisie-attribution, le législateur a doté les créanciers d’un outil simple, rapide et particulièrement protecteur. Le principe de l’attribution immédiate, analysé par la doctrine comme une cession de créance forcée, a non seulement résolu les problèmes de concours entre créanciers mais a aussi renforcé la sécurité juridique du recouvrement. La maîtrise de ces évolutions et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ.) est déterminante pour le succès d’une procédure ; face à ces enjeux, l’assistance d’un avocat expert en voies d’exécution est indispensable pour sécuriser le recouvrement de vos créances.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code civil
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution
- Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution