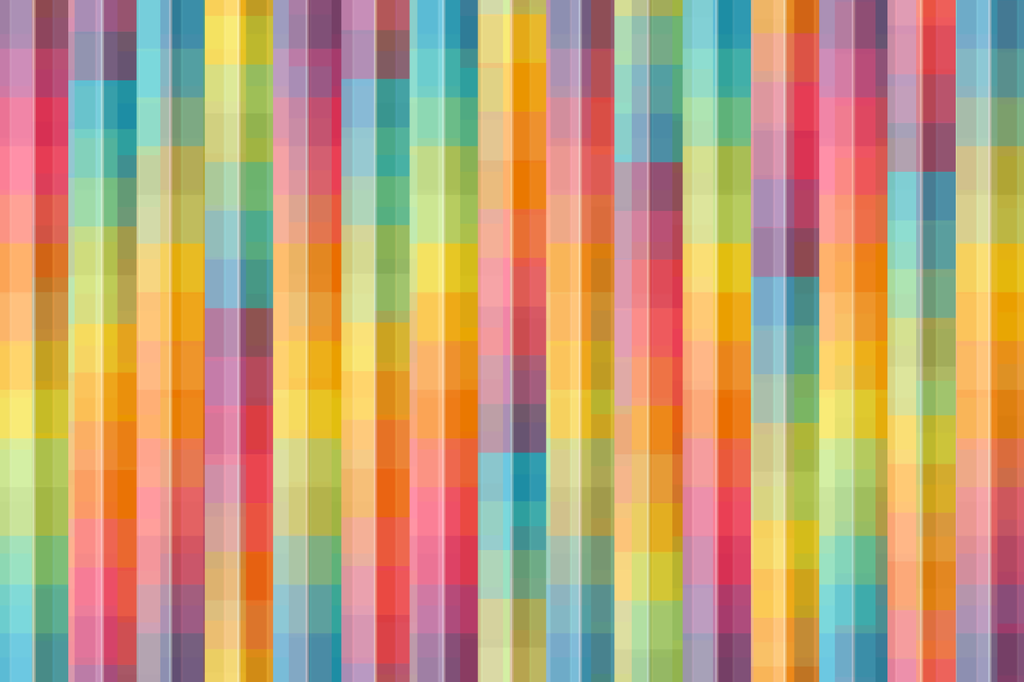Détenir une part de marché importante, voire une position dominante sur un marché numérique, n’est pas en soi une infraction au droit de la concurrence. C’est souvent la récompense du succès commercial, de l’innovation ou d’investissements judicieux. Ce qui est interdit, en revanche, c’est d’abuser de cette position pour restreindre la concurrence ou exploiter ses partenaires commerciaux et ses clients, des pratiques qui touchent aux principes de la concurrence déloyale. L’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et l’article L. 420-2 du Code de commerce veillent au grain.
Mais quand une entreprise est-elle considérée comme dominante ? Et quelles pratiques, banales pour une entreprise ordinaire, deviennent-elles abusives lorsqu’elles émanent d’un acteur dominant ? Dans l’économie numérique, caractérisée par les effets de réseau, les économies d’échelle et l’importance des données, des facteurs qui engendrent de nombreux défis pour le droit de la concurrence sur internet, certaines entreprises peuvent acquérir très rapidement une puissance de marché considérable. Comprendre les risques liés à l’abus de position dominante est donc essentiel pour ces acteurs, mais aussi pour leurs concurrents et partenaires. Cet article décrypte les principales formes d’abus observées dans l’univers d’internet et du commerce électronique.
Abus liés aux infrastructures et à l’accès au réseau
Historiquement, de nombreuses affaires d’abus de position dominante liées à internet ont concerné les opérateurs de télécommunications historiques, qui détenaient un quasi-monopole sur les infrastructures physiques (la « boucle locale » cuivre). Leur position dominante sur ce marché amont leur donnait la capacité d’influencer la concurrence sur les marchés aval de l’accès à internet pour les entreprises et les particuliers.
Discriminations dans l’accès
L’un des abus les plus fréquents a été la discrimination. Un opérateur historique pouvait favoriser sa propre filiale fournisseur d’accès à internet (FAI) par rapport aux FAI concurrents. Cela pouvait se manifester de diverses manières :
- Tarifs différenciés : Proposer aux concurrents des tarifs d’accès au réseau (interconnexion, dégroupage) trop élevés pour leur permettre de rivaliser avec les offres de détail de sa filiale (effet de « ciseau tarifaire »).
- Informations techniques : Fournir à sa filiale des informations techniques sur l’éligibilité des lignes à l’ADSL ou sur les équipements nécessaires, de manière anticipée ou plus complète qu’aux concurrents.
- Délais et processus : Mettre en place des processus de commande ou de mise en service des lignes plus rapides et fiables pour sa filiale que pour les opérateurs tiers.
L’Autorité de la concurrence française est intervenue à de multiples reprises pour sanctionner de telles pratiques de la part de France Télécom (devenu Orange), lui enjoignant de proposer des offres d’accès non discriminatoires et techniquement équivalentes à tous les acteurs.
Refus d’accès aux « installations essentielles »
Dans certains cas, l’abus peut aller jusqu’au refus pur et simple de donner accès à une infrastructure ou une ressource indispensable pour pouvoir concurrencer l’entreprise dominante. C’est la théorie des « installations essentielles ». Pour qu’un refus d’accès soit abusif, plusieurs conditions doivent être réunies : l’accès doit être indispensable (il n’existe pas d’alternative réelle ou potentielle), le refus doit être susceptible d’éliminer la concurrence sur un marché aval, et il ne doit pas être objectivement justifié. L’Autorité de la concurrence a par exemple examiné (mais rejeté au stade des mesures conservatoires) une plainte de 9 Télécom contre France Télécom concernant l’accès au « circuit virtuel » nécessaire pour proposer des offres ADSL concurrentes. Le concept peut aussi s’appliquer à des ressources immatérielles, comme nous le verrons plus loin.
Ventes liées et subventions croisées
Une entreprise dominante peut également être tentée de lier la vente d’un produit ou service où elle est en position de force (ex: l’abonnement téléphonique sur le réseau historique) à un autre produit ou service offert en concurrence (ex: un accès internet, des services complémentaires). Si ce couplage force la main du consommateur et évince les concurrents sur le second marché, il peut être abusif. De même, utiliser les profits tirés d’une activité monopolistique pour subventionner massivement une activité concurrentielle et y pratiquer des prix très bas (voire prédateurs) peut constituer un abus de subvention croisée, faussant la concurrence sur le marché ouvert.
Verrouillage technique
Imposer des contraintes techniques qui limitent l’interopérabilité ou le choix du consommateur peut aussi être abusif. L’affaire https://www.google.com/search?q=Wappup.com illustre ce risque : le verrouillage par défaut des premiers téléphones WAP sur le portail de l’opérateur mobile rendait difficile l’accès aux portails concurrents. Bien que les mesures conservatoires aient été refusées en l’espèce en raison d’une évolution rapide du marché et d’une décision de justice antérieure, le principe demeure : un acteur dominant ne peut utiliser des barrières techniques artificielles pour évincer la concurrence.
Abus liés aux plateformes et services en ligne
Avec le déplacement du centre de gravité économique vers les grandes plateformes numériques, de nouvelles formes d’abus de position dominante sont apparues, liées au contrôle de l’accès aux utilisateurs, aux données ou aux services essentiels.
Contrôle de l’accès et du référencement
Les plateformes qui jouent un rôle d’intermédiaire incontournable (moteurs de recherche, grandes marketplaces, systèmes d’exploitation, app stores…) peuvent abuser de leur pouvoir en matière de référencement ou d’accès. Cela peut inclure :
- Le refus d’enregistrer un nom de domaine, dont la pertinence est étroitement liée à la définition du marché pertinent (affaire AFNIC ).
- Des règles de référencement opaques, arbitraires ou discriminatoires sur un moteur de recherche dominant, favorisant ses propres services ou pénalisant certains concurrents (comme reproché à Google dans plusieurs affaires concernant son service AdWords ).
- L’imposition de conditions d’accès inéquitables aux vendeurs tiers sur une marketplace dominante (abus de dépendance économique pouvant relever de l’article L. 420-2 ).
Refus d’accès aux contenus ou d’interopérabilité
Un acteur dominant contrôlant un contenu ou une technologie clé peut abuser de sa position en refusant de le rendre accessible ou interopérable, si cela bloque l’émergence de produits ou services nouveaux et innovants. La Commission européenne s’est ainsi interrogée sur le refus systématique de certains détenteurs de droits sportifs de les céder pour une exploitation sur internet, afin de protéger leurs revenus télévisuels traditionnels. De même, le refus par Apple de licencier sa technologie de gestion des droits numériques (DRM) « FairPlay » a fait l’objet d’une plainte (rejetée par l’Autorité de la concurrence pour défaut de preuve du caractère indispensable et du risque d’élimination de la concurrence) de la part de VirginMega, qui ne pouvait rendre sa musique compatible avec les iPods.
Conditions de transaction inéquitables
Imposer des conditions déséquilibrées à ses partenaires peut aussi constituer un abus, une problématique qui, à l’instar des restrictions verticales et ententes, contribue à la régulation des marchés. L’affaire emblématique est celle opposant les éditeurs de presse français à Google concernant l’application de la loi sur les droits voisins. L’Autorité de la concurrence a considéré que Google avait pu abuser de sa position dominante en imposant unilatéralement un principe de non-rémunération pour l’affichage des contenus protégés et en ne négociant pas de bonne foi avec les éditeurs, leur imposant ainsi des conditions de transaction inéquitables.
Verrouillage de la clientèle
Les stratégies visant à rendre excessivement difficile ou coûteux pour un client de changer de fournisseur ou d’utiliser plusieurs fournisseurs (« multi-homing ») peuvent être abusives si elles sont mises en œuvre par un acteur dominant. L’Autorité de la concurrence a exprimé des préoccupations concernant les « frais de sortie » (egress fees) pratiqués par certains fournisseurs de services cloud, qui pourraient constituer des barrières à la migration et verrouiller la clientèle.
Les stratégies tarifaires abusives
Le prix est un outil essentiel de la concurrence, mais il peut aussi être utilisé de manière abusive par une entreprise dominante.
La prédation
La pratique la plus grave est la prédation : fixer des prix inférieurs à ses coûts dans le but délibéré d’éliminer un concurrent, avec l’espoir de remonter ensuite les prix et de récupérer ses pertes une fois la concurrence évincée. Prouver l’intention prédatrice est souvent difficile. Les autorités analysent généralement les coûts de l’entreprise (coûts variables moyens, coûts complets moyens). Des prix inférieurs aux coûts variables moyens sont présumés prédateurs. Des prix supérieurs aux coûts variables moyens mais inférieurs aux coûts complets moyens peuvent être abusifs s’ils s’inscrivent dans un plan d’élimination d’un concurrent. La Commission européenne a condamné Wanadoo pour prédation sur le marché de l’ADSL en France. L’Autorité de la concurrence française avait également examiné ce grief mais l’avait écarté au stade des mesures conservatoires, relevant la forte croissance du marché et la capacité des concurrents à s’aligner et gagner des parts de marché malgré les prix bas de Wanadoo.
Les prix excessivement élevés
À l’inverse, une entreprise dominante peut être tentée d’imposer des prix sans rapport avec la valeur économique du produit ou service. Cependant, les condamnations pour prix excessifs sont rares, car les autorités considèrent qu’un prix n’est abusif que s’il est « manifestement excessif », ce qui est difficile à établir. La concurrence est généralement vue comme le meilleur régulateur des prix élevés.
Prix minimum imposés et discriminations
Comme vu dans l’article précédent, imposer des prix de revente minimums est généralement une entente. Mais si c’est le fait unilatéral d’une entreprise dominante sur ses distributeurs, cela peut aussi être qualifié d’abus de position dominante. De même, appliquer des conditions tarifaires différentes à des partenaires placés dans des situations équivalentes, sans justification objective, peut constituer une discrimination abusive.
En conclusion, la puissance acquise sur les marchés numériques confère une responsabilité particulière. Les entreprises dominantes doivent veiller à ce que leurs pratiques commerciales, qu’il s’agisse de l’accès à leurs services, de leurs conditions contractuelles ou de leurs stratégies tarifaires, ne servent pas à étouffer la concurrence par des moyens autres que la simple compétition par les mérites.
Évaluer si vos pratiques en ligne pourraient être considérées comme abusives nécessite une analyse fine de votre position sur le marché et de vos comportements. Contactez notre cabinet pour un audit personnalisé de vos risques.
Sources
- Article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)
- Article L. 420-2 du Code de commerce