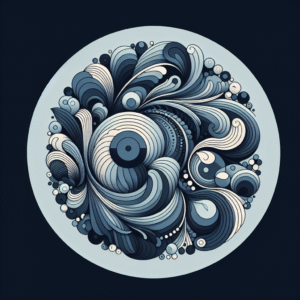Lorsqu’une entreprise déploie ses activités sur le marché français, elle entre dans un environnement normatif dense où plusieurs strates de règles coexistent. En matière de droit de la concurrence, cette réalité est particulièrement tangible. Les entreprises sont soumises à la fois au droit national, principalement inscrit dans le Code de commerce, et au droit de l’Union européenne, dont les dispositions visent à garantir une concurrence saine et non faussée à l’échelle du marché unique. Cette double application soulève des questions complexes d’articulation et de hiérarchie des normes. Comprendre comment ces deux corpus juridiques interagissent n’est pas un simple exercice théorique ; c’est une nécessité impérieuse pour sécuriser ses pratiques commerciales et éviter des sanctions potentiellement lourdes. Naviguer dans ce paysage réglementaire exige une connaissance approfondie que seul un avocat expert en droit de la concurrence peut pleinement apporter.
Les principes fondamentaux de l’articulation
L’interaction entre le droit européen et le droit français de la concurrence repose sur des principes clairs, établis de longue date par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Ces fondations déterminent quelle norme doit s’appliquer et dans quelles circonstances, créant un cadre où les deux systèmes, loin de s’opposer, sont conçus pour se compléter.
La primauté du droit de l’Union européenne
Le socle de l’édifice est le principe de primauté du droit de l’Union. Ce principe signifie que les règles européennes, notamment les articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), l’emportent sur toute disposition nationale contraire. Concrètement, une pratique commerciale (un accord de distribution, une politique tarifaire) peut être jugée parfaitement légale au regard du droit français, mais si elle est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et qu’elle contrevient aux règles européennes, c’est l’interdiction européenne qui prévaudra. Cette suprématie est renforcée par l’effet direct des articles 101 et 102 du TFUE, qui permet à toute entreprise ou particulier de les invoquer directement devant les juridictions nationales pour faire valoir ses droits. La bonne compréhension du cadre réglementaire européen du droit de la concurrence est donc un prérequis indispensable.
La jurisprudence Walt Wilhelm et ses implications
Dès 1969, dans l’arrêt fondateur Walt Wilhelm (CJCE, 13 fév. 1969, aff. 14/68), la Cour de justice a posé les bases de la coexistence des systèmes. Elle a admis la possibilité d’une double procédure : une même entente peut faire l’objet de poursuites parallèles, l’une menée par la Commission européenne au titre du droit de l’Union, l’autre par une autorité nationale au titre de son droit interne. Cependant, cette possibilité n’est pas sans limites. La Cour a immédiatement précisé que l’application du droit national ne devait jamais porter préjudice à l’application uniforme du droit de l’Union sur tout le territoire du marché intérieur. En cas de conflit, la décision prise en application du droit européen prime. Ce principe vise à éviter que l’efficacité des règles européennes ne soit affaiblie par des décisions nationales divergentes. L’arrêt a aussi abordé la règle non bis in idem (nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits). Si une entreprise est sanctionnée par la Commission, l’autorité nationale qui la sanctionnerait ensuite pour les mêmes faits au titre de son droit interne doit impérativement tenir compte de la première sanction dans la détermination du montant de sa propre amende.
Le système de compétences partagées
L’architecture de la mise en œuvre du droit de la concurrence a été profondément remaniée par le Règlement (CE) n°1/2003. Ce texte a instauré un système de compétences parallèles décentralisées, où la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence (les « ANC ») sont toutes deux chargées d’appliquer directement les articles 101 et 102 du TFUE. Ce réseau d’autorités forme le Réseau Européen de la Concurrence (REC ou ECN en anglais), conçu pour assurer une coopération étroite et une application cohérente des règles.
Rôle de la Commission européenne
Au sein de ce réseau, la Commission européenne conserve un rôle central. Elle agit comme le chef d’orchestre, veillant à la cohérence de la politique de concurrence à travers l’Union. Elle se saisit généralement des affaires les plus importantes, celles qui ont un impact transfrontalier significatif ou qui soulèvent une question de droit nouvelle. Elle peut à tout moment dessaisir une autorité nationale d’un cas si elle estime qu’une action à l’échelle de l’Union est plus appropriée. La Commission conserve également le monopole de l’adoption des règlements d’exemption par catégorie, qui sont des textes essentiels définissant des « zones de sécurité » pour certaines pratiques commerciales.
Rôle des autorités nationales de concurrence (ex: Autorité de la concurrence)
Les autorités nationales, comme l’Autorité de la concurrence en France, sont devenues les juges de droit commun de l’application des règles européennes. Elles ont désormais non seulement le pouvoir mais aussi l’obligation d’appliquer les articles 101 et 102 du TFUE chaque fois qu’une pratique est susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Elles traitent la grande majorité des cas, ce qui permet de rapprocher la décision du terrain et des acteurs économiques concernés. Leur compétence est toutefois encadrée : une autorité nationale ne peut pas rendre une décision qui irait à l’encontre d’une décision déjà adoptée par la Commission sur la même affaire. Si la Commission ouvre une procédure, les ANC sont dessaisies de leur compétence à appliquer le droit de l’Union.
Le recours préjudiciel et le sursis à statuer (CJUE Delimitis, Masterfoods)
Les juridictions nationales jouent également un rôle clé. Lorsqu’un litige commercial porté devant un tribunal français (par exemple, une action en nullité de contrat pour violation des règles sur les ententes) soulève une question d’interprétation du droit de l’Union, le juge national a la possibilité, et parfois l’obligation, de poser une question préjudicielle à la CJUE. Ce mécanisme garantit une interprétation uniforme du droit de l’Union. La jurisprudence a précisé les devoirs du juge national. Dans l’affaire Delimitis (CJCE, 28 fév. 1991, C-234/89), la Cour a indiqué qu’un juge national, pour apprécier la validité d’un contrat au regard de l’article 101 TFUE, doit vérifier si celui-ci affecte le commerce entre États membres et s’il bénéficie d’une exemption. En cas de doute ou si une décision de la Commission est probable, il peut surseoir à statuer, c’est-à-dire suspendre le procès en attendant que la situation s’éclaircisse. L’arrêt Masterfoods (CJCE, 14 déc. 2000, C-344/98) a renforcé cette obligation de coopération en affirmant qu’un juge national ne peut pas prendre une décision qui entrerait en conflit avec une décision envisagée par la Commission.
L’impact de la modernisation du droit de la concurrence (Règlement 1/2003)
L’entrée en vigueur du Règlement 1/2003 a marqué un tournant majeur, en remplaçant un système centralisé de notification préalable par un régime d’exception légale directement applicable. Cette « modernisation » a eu des conséquences profondes sur la manière dont les entreprises doivent évaluer la légalité de leurs accords et sur l’articulation entre les normes.
Consécration de la primauté des exemptions européennes
Avant 2003, une entreprise souhaitant bénéficier d’une exemption individuelle pour une entente potentiellement restrictive devait la notifier à la Commission européenne, seule habilitée à l’accorder. Le Règlement 1/2003 a aboli ce système. Désormais, un accord qui remplit les quatre conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (gains d’efficacité, bénéfice pour les consommateurs, etc.) est automatiquement et de plein droit valide, sans aucune décision préalable. Il appartient à l’entreprise qui se prévaut de l’exemption de prouver que les conditions sont remplies. Cette logique s’applique aussi aux règlements d’exemption par catégorie, qui créent une présomption de légalité pour certains types d’accords. Par exemple, le Règlement (UE) 2022/720 sur les restrictions verticales valide, sous conditions, de nombreux accords de distribution. Lorsqu’un accord bénéficie d’une telle exemption européenne, il est à l’abri non seulement d’une interdiction au titre de l’article 101 TFUE, mais aussi d’une interdiction fondée sur le droit national. Cela assure que les principaux types d’ententes interdites sont traités de manière homogène dans toute l’Union.
Incidences sur l’application du droit national (L.464-6-1 C. com.)
Le Règlement 1/2003 a formalisé le principe de convergence entre les droits de la concurrence. Son article 3 établit une règle claire : lorsque les autorités de concurrence ou les juridictions d’un État membre appliquent leur droit national des ententes à un accord qui affecte le commerce entre États membres, elles doivent également lui appliquer l’article 101 du TFUE. Plus important encore, elles ne peuvent pas utiliser leur droit national pour interdire un accord qui ne contrevient pas à l’article 101 du TFUE. En d’autres termes, si un accord est jugé licite au regard du droit européen (parce qu’il ne restreint pas la concurrence de manière sensible ou parce qu’il bénéficie d’une exemption), le droit français ne peut pas le déclarer illicite. Le droit français de la concurrence, notamment l’article L. 420-1 du Code de commerce, ne peut donc être plus sévère que le droit de l’Union à l’encontre des ententes. Le législateur a tiré les conséquences de cette primauté, notamment à travers des dispositions comme l’ancien article L. 464-6-1 du Code de commerce qui organisait les modalités de cette application coordonnée et assurait la pleine efficacité du droit européen dans l’ordre juridique interne.
Les conséquences pratiques pour les entreprises et les contentieux
Cette architecture juridique à double niveau a des répercussions très concrètes pour les entreprises, qui doivent élaborer leurs stratégies commerciales et judiciaires en tenant compte de cette complexité. L’analyse des risques ne peut se limiter à un seul ordre juridique.
Risques de divergences d’appréciation entre États membres
Malgré les efforts d’harmonisation et la coordination au sein du Réseau Européen de la Concurrence, le risque de divergences d’appréciation entre les 27 autorités nationales n’est pas nul. La définition du marché pertinent, l’évaluation d’une position dominante ou l’analyse des effets d’une pratique peuvent varier d’un État membre à l’autre. Une autorité peut se montrer plus stricte qu’une autre sur un type de clause particulier. Cette situation crée une insécurité juridique pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs pays de l’Union. Une pratique validée ou tolérée dans un pays pourrait être remise en cause dans un pays voisin, obligeant l’entreprise à adapter sa stratégie ou à faire face à des contentieux multiples.
Stratégies judiciaires et administratives
La coexistence de plusieurs forums compétents (Commission, autorités nationales, juridictions nationales) ouvre la voie à des stratégies de « forum shopping ». Une entreprise qui s’estime victime d’une pratique anticoncurrentielle peut choisir de déposer sa plainte devant l’autorité qu’elle juge la plus réceptive à ses arguments ou la plus prompte à agir. Inversement, une entreprise mise en cause doit développer une stratégie de défense cohérente sur tous les fronts. Un argument ou une pièce communiquée dans le cadre d’une procédure dans un État membre pourrait être utilisé contre elle dans une autre procédure. La cohérence est donc fondamentale. Il est impératif d’anticiper comment une décision rendue par une autorité nationale pourrait être perçue par une autre ou par la Commission.
L’articulation des droits de la concurrence européen et national est un mécanisme juridique subtil dont la maîtrise est une condition de la sécurité juridique des opérations commerciales. Pour une entreprise, ignorer cette dualité des règles, c’est s’exposer au risque de voir un accord commercial anéanti ou de subir des sanctions financières de plusieurs autorités. Naviguer entre les exigences du droit français et celles du droit européen de la concurrence demande une expertise fine et une vision stratégique. Pour une analyse approfondie de votre situation et un conseil adapté, prenez contact avec notre équipe d’avocats.
Sources
- Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), notamment les articles 101 et 102.
- Code de commerce, notamment les articles L. 420-1 et suivants.
- Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.
- Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).