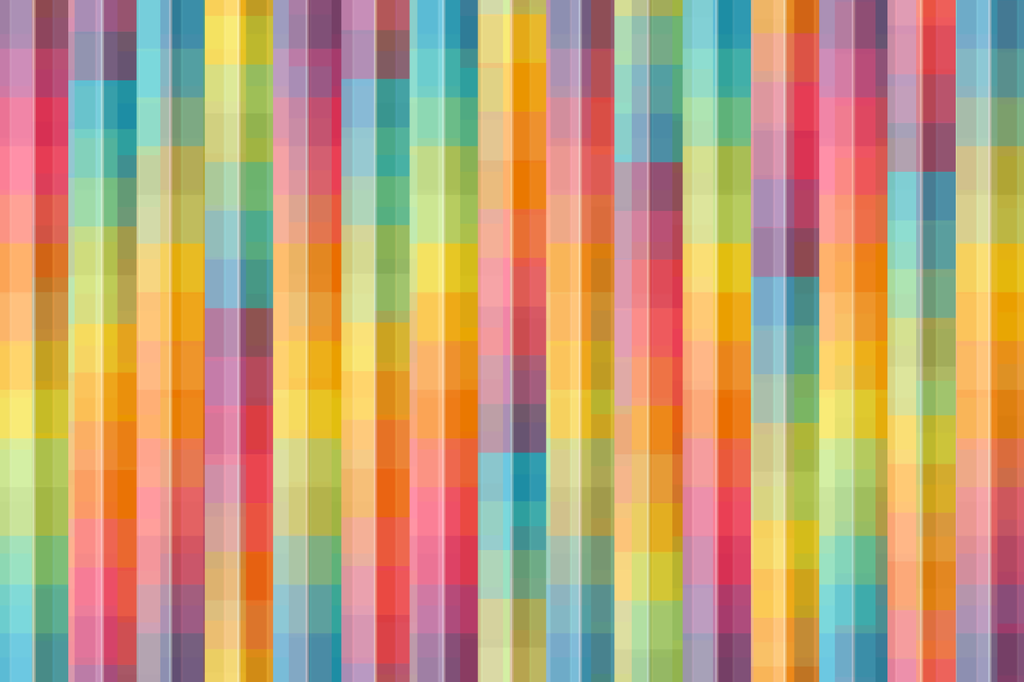La conclusion d’un contrat bancaire à l’international soulève une question fondamentale : quelle loi s’appliquera en cas de litige ? La réponse conditionne l’interprétation des clauses, l’étendue des obligations et l’issue d’un éventuel contentieux. Dans ce domaine, le droit européen consacre un principe cardinal qui donne un pouvoir considérable aux parties : l’autonomie de la volonté. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour tout dirigeant ou particulier engageant des relations financières transfrontalières. Cet article s’attache à décortiquer ce principe et ses limites, qui dessinent le rôle central de l’autonomie de la volonté dans le paysage plus large des conflits de lois bancaires internationaux.
Le principe de l’autonomie de la volonté en droit bancaire international
Au cœur du droit des contrats internationaux, et particulièrement en matière bancaire, se trouve la liberté pour les contractants de choisir la loi qui gouvernera leur accord. Ce principe, connu sous le nom de « loi d’autonomie », est consacré par les textes européens, notamment le règlement (CE) n° 593/2008, dit « Rome I », qui a succédé à la convention de Rome de 1980 pour les contrats conclus après le 17 décembre 2009. L’article 3 de ce règlement est sans équivoque : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. »
Cette liberté de choix est une pierre angulaire de la sécurité juridique dans les échanges internationaux. Elle permet aux entreprises et aux banques de sélectionner un cadre légal qu’elles maîtrisent, jugé neutre ou particulièrement adapté à la nature de leur opération (crédit, swap, garantie, etc.). Le choix peut se porter sur la loi d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État tiers, comme le droit suisse ou le droit de l’État de New York, très prisés dans les financements internationaux. Cette règle a un caractère « universel », ce qui signifie qu’un juge français appliquera la loi désignée par les parties, même si cette dernière n’est pas celle d’un État membre.
Le choix exprès ou implicite de la loi
La désignation de la loi applicable peut se manifester de deux manières. La plus simple et la plus sûre est le choix exprès. Il se matérialise par une « clause de loi applicable » (ou governing law clause) clairement insérée dans le contrat. Par exemple : « Le présent contrat est régi et interprété conformément au droit français. » Une telle clause lève toute ambiguïté.
Toutefois, le règlement Rome I admet aussi un choix implicite, ou tacite. Dans ce cas, l’intention des parties doit résulter « de façon certaine » des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Comment se manifeste cette intention ? La jurisprudence, notamment anglaise, a identifié plusieurs indices. La référence répétée à des articles de loi spécifiques d’un pays, l’utilisation d’un contrat-type connu pour être régi par une loi particulière (comme les contrats-cadres ISDA souvent soumis au droit anglais) ou une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux d’un État peuvent constituer des faisceaux d’indices. Attention cependant, ces éléments doivent démontrer une volonté commune et non équivoque. Une simple référence isolée ne suffit généralement pas à caractériser un choix tacite.
La ‘clause de dépeçage’ : choisir plusieurs lois
La liberté des parties va encore plus loin. Le règlement Rome I leur permet de « dépecer » le contrat. Concrètement, cela signifie qu’elles peuvent soumettre différentes parties de leur accord à des lois distinctes. Par exemple, dans un financement de projet complexe, les clauses relatives au remboursement du prêt pourraient être soumises au droit anglais, tandis que les garanties réelles immobilières attachées seraient régies par la loi du lieu de situation de l’immeuble (la lex rei sitae).
Ce mécanisme offre une grande souplesse mais doit être manié avec prudence. Le « dépeçage » ne doit pas aboutir à des contradictions ou ruiner la cohérence globale du contrat. Si les parties choisissent de soumettre la définition d’un défaut de paiement au droit français et les conséquences de ce même défaut au droit allemand, elles doivent s’assurer que les deux systèmes peuvent s’articuler de manière logique. L’objectif est de construire un édifice juridique fonctionnel, et non un assemblage de règles incompatibles qui créerait plus d’incertitude qu’il n’en résout.
Les contrats ‘internes’ soumis à une loi étrangère
Une situation particulière mérite attention : celle où un contrat, dont tous les éléments sont localisés dans un seul pays, est soumis par les parties à une loi étrangère. Imaginons une PME française contractant un prêt auprès d’une banque française pour financer un actif en France, mais les deux parties décident de soumettre leur contrat au droit luxembourgeois. Cette situation est-elle possible ? Oui, le principe d’autonomie de la volonté le permet. Cependant, cette liberté n’est pas absolue.
L’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I prévoit une limite de taille. Le choix d’une loi étrangère ne peut pas priver l’une des parties, généralement la plus faible, de la protection que lui assurent les « dispositions impératives » de la loi du pays avec lequel le contrat présente tous ses liens. Autrement dit, dans notre exemple, les dispositions impératives du droit français, auxquelles on ne peut déroger par contrat, continueront de s’appliquer. Cela vise à éviter que le choix d’une loi étrangère ne devienne une stratégie d’évitement des protections fondamentales prévues par l’ordre juridique naturel du contrat. Ces dispositions incluent de nombreuses règles protectrices, comme celles sur la protection des consommateurs ou les lois de police, qui incarnent les exigences jugées essentielles par un État pour la sauvegarde de ses intérêts publics.
Le cas des contrats ‘intracommunautaires’
Le règlement Rome I a introduit une autre protection spécifique pour les contrats conclus au sein de l’Union européenne. Lorsque tous les éléments de la situation sont localisés dans un ou plusieurs États membres, mais que les parties choisissent la loi d’un pays tiers (par exemple, le droit suisse), ce choix ne doit pas porter atteinte aux règles impératives du droit de l’Union européenne.
Cette disposition, issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment l’arrêt Ingmar), vise à préserver l’intégrité du marché intérieur. Les parties ne peuvent utiliser le choix d’une loi extérieure à l’UE comme un moyen de contourner les directives européennes harmonisées qui établissent un socle de règles communes, notamment en matière de protection des consommateurs. Par exemple, les dispositions d’une directive sur le crédit à la consommation, telles que transposées dans l’État membre du for, s’appliqueront même si le contrat est régi par une loi non-européenne. Cela garantit un niveau de protection minimal et uniforme au sein de l’Union, renforçant la confiance dans les transactions transfrontalières.
L’exclusion et la prise en compte des règles non étatiques
L’autonomie de la volonté permet-elle de choisir un système de règles non-étatiques, comme la lex mercatoria (usages du commerce international) ou les principes de la Charia pour régir un contrat de financement islamique ? La réponse apportée par le règlement Rome I est négative. Le choix doit se porter sur la « loi d’un pays ». Un ensemble de règles religieuses ou de principes transnationaux, aussi structuré soit-il, ne constitue pas un système juridique étatique au sens du règlement.
La jurisprudence, notamment anglaise dans la célèbre affaire Shamil Bank of Bahrain, a confirmé cette position. Un contrat ne peut être directement soumis à la Charia. Cela ne signifie pas pour autant que ces principes sont ignorés. Le considérant 13 du règlement précise que les parties peuvent « intégrer par référence » dans leur contrat un droit non étatique. La nuance est de taille : le contrat reste régi par une loi étatique (par exemple, le droit anglais), mais il incorpore des clauses qui reflètent les principes de la Charia. La validité et l’interprétation de ces clauses seront alors appréciées au regard de la loi étatique choisie. Cette loi étatique, par le biais de ses propres règles d’ordre public, peut d’ailleurs limiter l’effet de certains principes ainsi incorporés, agissant comme un filtre de compatibilité.
Naviguer entre la liberté de choix de la loi applicable et les multiples limites imposées par le droit international et européen requiert une expertise précise. Une clause de choix de loi mal rédigée ou un choix inadapté peut avoir des conséquences financières et juridiques importantes. Pour sécuriser vos contrats bancaires internationaux et bénéficier d’un conseil stratégique sur la loi la plus appropriée à votre situation, notre cabinet d’avocats vous accompagne dans la rédaction et la négociation de vos accords.
Sources
- Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
- Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
- Code monétaire et financier.
- Code de la consommation.