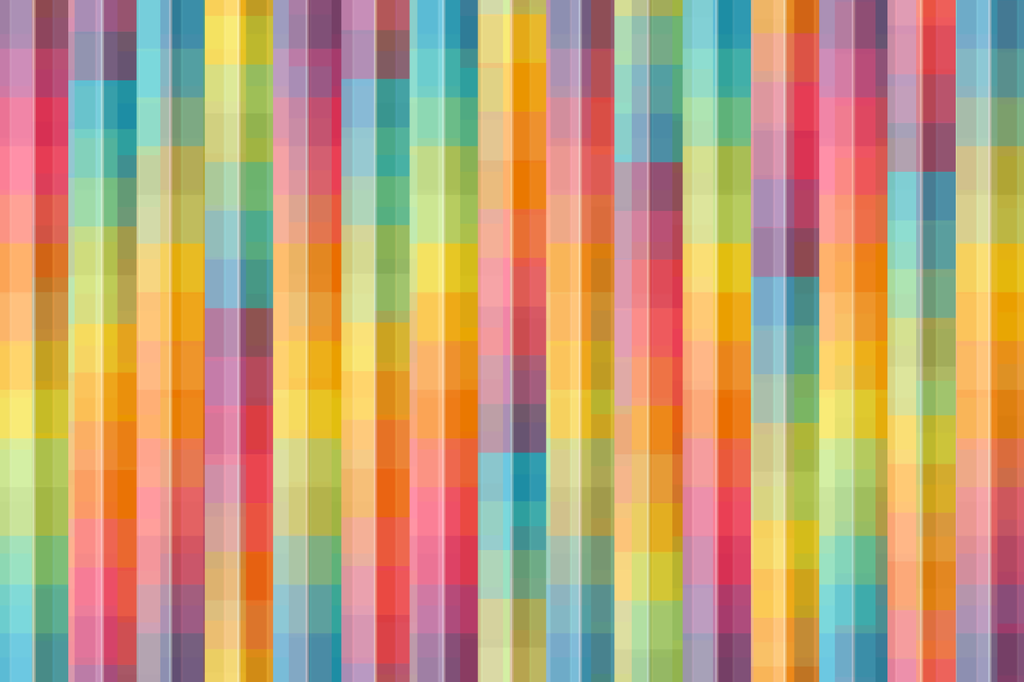L’acquisition de produits ou de services bancaires à l’étranger, qu’il s’agisse d’un crédit, d’un placement ou d’une simple ouverture de compte, soulève une interrogation fondamentale pour tout particulier ou dirigeant d’entreprise : quelle loi protège vos intérêts en cas de litige ? La réponse est loin d’être simple et dépend de la situation. Dans l’espace européen, des mécanismes ont été mis en place pour garantir une protection minimale au consommateur, partie jugée la plus faible au contrat. La protection des consommateurs constitue une exception majeure aux principes généraux de détermination de la loi applicable, notamment via la Convention de Rome et, plus récemment, le Règlement Rome I. Cet article décrypte pour vous les règles qui encadrent cette protection et les conditions précises de leur application.
Le cadre général de la protection des consommateurs en droit bancaire transfrontalier
En principe, le droit des contrats internationaux est gouverné par l’autonomie de la volonté. Cela signifie que les parties sont libres de choisir la loi qui régira leur contrat. Cependant, cette liberté n’est pas absolue, surtout lorsqu’un déséquilibre existe entre les contractants. Le droit européen a donc instauré des règles spécifiques pour protéger les consommateurs lorsqu’ils contractent avec un professionnel établi dans un autre pays. Pour explorer plus en détail comment la protection du consommateur peut déroger au principe d’autonomie de la volonté des parties, il est essentiel de comprendre le socle législatif.
Deux textes majeurs organisent cette protection : la Convention de Rome de 1980 pour les contrats conclus avant le 17 décembre 2009, et le Règlement (CE) n° 593/2008, dit « Rome I », pour les contrats conclus après cette date. Ces instruments juridiques visent à assurer qu’un consommateur ne soit pas privé de la protection offerte par les dispositions impératives de la loi de son pays de résidence habituelle, même si le contrat désigne la loi d’un autre État. Concrètement, si la loi du professionnel étranger est moins protectrice que la loi française sur des points essentiels, les dispositions impératives françaises peuvent tout de même s’appliquer.
Champ d’application des articles protecteurs (Convention de Rome et Règlement Rome I)
La Convention de Rome (article 5) et le Règlement Rome I (article 6) ne couvrent pas toutes les opérations bancaires sans distinction. Initialement, la Convention de Rome visait les contrats de fourniture de services ou de biens mobiliers, ainsi que les contrats destinés à financer une telle fourniture. Cette rédaction a longtemps alimenté des débats sur son application aux crédits non affectés, c’est-à-dire les prêts dont l’usage n’est pas prédéfini, ou encore aux crédits immobiliers. La jurisprudence a fluctué, certaines décisions acceptant d’y inclure les prêts en les qualifiant de « fourniture de service », tandis que d’autres les excluaient.
Le Règlement Rome I a mis fin à ces incertitudes en adoptant une approche plus large. Son article 6 s’applique à la plupart des contrats de consommation, en procédant par exclusion. Sont notamment exclus les contrats de services fournis exclusivement dans un pays autre que celui du consommateur, ou encore certains contrats relatifs à des instruments financiers. Fait notable, les crédits immobiliers, qui étaient une zone grise sous l’empire de la Convention, entrent désormais clairement dans le champ de la protection offerte par le Règlement Rome I, à condition que les autres critères d’application soient réunis. Cette évolution a considérablement renforcé la sécurité juridique pour les emprunteurs transfrontaliers.
Qui est le ‘consommateur’ au sens du droit international privé ?
La notion de « consommateur » est au cœur du dispositif de protection. Il ne suffit pas d’être un particulier pour en bénéficier. La définition retenue est fonctionnelle : est considéré comme consommateur une personne physique qui conclut un contrat pour un usage pouvant être regardé comme étranger à son activité professionnelle. La question n’est donc pas tant qui vous êtes (dirigeant, salarié, retraité), mais pourquoi vous contractez.
L’analyse se fait au cas par cas. Un prêt souscrit par un dirigeant de PME pour financer l’achat de sa résidence principale est un acte de consommation. En revanche, un crédit souscrit par ce même dirigeant pour injecter des fonds dans sa société est un acte professionnel qui l’exclut du bénéfice de cette protection spécifique. La distinction peut être plus délicate pour des contrats à usage mixte (mi-privé, mi-professionnel). Dans ce cas, les juges recherchent la finalité prédominante de l’opération. Si l’aspect professionnel n’est que marginal, la qualification de consommateur peut être retenue. Il est important de noter que cette protection est réservée aux personnes physiques. Une société, même une TPE, ne peut pas se prévaloir du statut de consommateur au sens de ces règlements.
Les conditions de mise en œuvre de la protection
Pour qu’un consommateur puisse bénéficier de la protection de la loi de son pays de résidence, il ne suffit pas que le contrat entre dans le champ d’application matériel et personnel des textes. Des conditions supplémentaires, liées au comportement du professionnel, doivent être remplies. Ces conditions ont évolué entre la Convention de Rome et le Règlement Rome I, reflétant l’évolution des pratiques commerciales, notamment en ligne.
Sous l’empire de la Convention de Rome, la protection était déclenchée si la conclusion du contrat avait été précédée dans le pays du consommateur d’une « proposition spécialement faite » ou d’une « publicité », et si le consommateur y avait accompli « les actes nécessaires à la conclusion du contrat ». Cela visait principalement les situations de démarchage actif, comme une offre de prêt envoyée par courrier au domicile du consommateur en France, qu’il signait et retournait. En revanche, un consommateur qui se déplaçait spontanément à l’étranger pour signer un contrat ne pouvait généralement pas invoquer cette protection.
Le Règlement Rome I a modernisé cette approche. La protection s’applique désormais si le professionnel « exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle » ou si, « par tout moyen, il dirige cette activité vers ce pays ». Cette notion d' »activité dirigée » est plus adaptée à l’ère numérique et vise à couvrir les situations où un professionnel, sans être physiquement présent, cible activement un marché étranger, par exemple via un site internet.
L’interprétation de la notion d »activité dirigée’ par le professionnel (Règlement Rome I)
La notion d' »activité dirigée » est la clé de voûte de la protection du consommateur dans le commerce transfrontalier moderne. Comment un juge détermine-t-il si un professionnel étranger a bien « dirigé » son activité vers la France ? La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a clarifié que le simple fait qu’un site internet soit accessible depuis la France est insuffisant. Il faut démontrer une volonté claire du professionnel de viser le marché français.
Pour ce faire, le juge s’appuie sur un faisceau d’indices non-exhaustifs. Parmi les éléments pertinents, on trouve :
- La mention de la France parmi les pays vers lesquels le professionnel propose ses services.
- L’utilisation de la langue française ou de l’euro sur le site internet (bien que ces éléments seuls ne soient pas décisifs).
- La fourniture de coordonnées téléphoniques avec un indicatif international vers la France.
- La mention d’une clientèle française ou de témoignages de clients français.
- L’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau lié à la France (comme « .fr »).
- Des dépenses en référencement payant auprès d’un moteur de recherche pour cibler les internautes français.
Si un ensemble de ces indices démontre que le professionnel a intentionnellement cherché à attirer une clientèle en France, le critère de l’activité dirigée sera rempli. Le consommateur pourra alors bénéficier des dispositions impératives de la loi française, même si le contrat est soumis au droit du pays du professionnel.
Articulation avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
En France, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) contient également des dispositions sur la loi applicable au commerce électronique. Son article 17 prévoit que l’activité de commerce électronique est en principe soumise à la loi de l’État membre où le prestataire est établi. Cela semble correspondre à la règle de base de la loi du professionnel.
Cependant, ce même article précise que ce principe ne peut « priver un consommateur […] de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ». Plus important encore, il ajoute que cette protection s’applique « conformément aux engagements internationaux souscrits par la France ». Cette référence a pour effet de faire prévaloir les règles de conflit de lois contenues dans les instruments européens comme le Règlement Rome I. Ainsi, la LCEN ne crée pas un régime parallèle mais renvoie aux conditions précises fixées par le droit européen, notamment celle de l' »activité dirigée » pour déterminer si la protection impérative française doit s’appliquer.
L’articulation entre la protection des consommateurs et les lois de police
Une question complexe se pose lorsque les conditions spécifiques de protection du consommateur (par exemple, l’absence d’activité dirigée vers la France) ne sont pas remplies. Le consommateur est-il alors totalement démuni et soumis à la loi étrangère choisie dans le contrat ? Pas nécessairement. Il peut, dans certaines circonstances, invoquer un autre mécanisme : les lois de police.
Une loi de police est une disposition nationale jugée si essentielle pour la sauvegarde des intérêts publics d’un pays (organisation économique, sociale, politique) qu’elle doit s’appliquer à toute situation relevant de son champ, quelle que soit la loi normalement applicable au contrat. La controverse a longtemps existé pour savoir si les règles de protection du consommateur et les lois de police étaient deux mécanismes exclusifs l’un de l’autre. La Cour de cassation a clarifié que ce n’était pas le cas. Un consommateur qui ne peut bénéficier de la protection de l’article 6 du Règlement Rome I peut tenter d’invoquer le caractère de loi de police de certaines dispositions du droit français.
Toutefois, toutes les règles du Code de la consommation ne sont pas qualifiées de lois de police. La jurisprudence est restrictive. Par exemple, le formalisme du cautionnement ou les règles de prescription biennale ont été écartés de cette qualification. En revanche, des dispositions relatives à la compétence exclusive du tribunal d’instance pour les crédits à la consommation ou certaines règles sur le taux d’intérêt ont pu être considérées comme telles. Cette voie reste donc technique et soumise à l’appréciation des juges, illustrant la complexité de l’articulation entre les règles protectrices classiques et le recours aux lois de police en droit bancaire international.
L’analyse de la loi applicable à un contrat bancaire international et l’identification des protections disponibles exigent une expertise pointue des règlements européens et de leur interprétation jurisprudentielle. Une appréciation erronée des critères, comme celui de l' »activité dirigée », peut vous priver de protections fondamentales. Pour une analyse de votre situation et pour sécuriser vos démarches, notre cabinet d’avocats compétents en droit bancaire vous accompagne.
Sources
- Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
- Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et de la Cour de cassation française