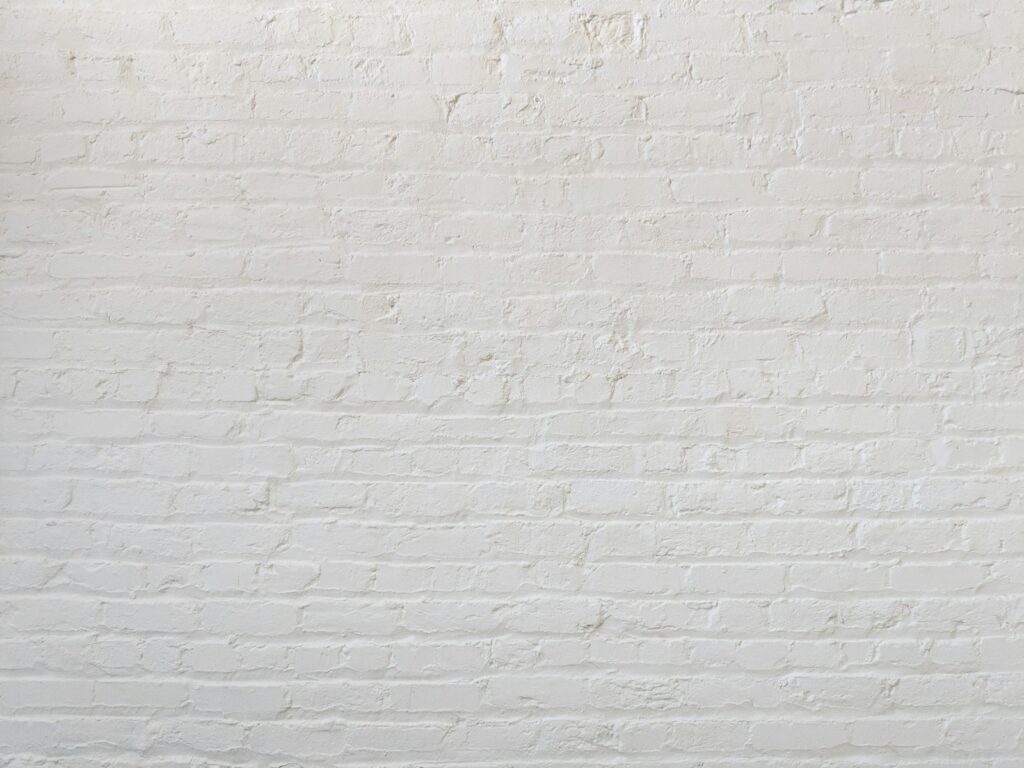Le retrait litigieux, mécanisme prévu par l’article 1699 du Code civil, est un droit puissant mais souvent méconnu. Il permet à un débiteur de racheter sa propre dette pour une fraction de sa valeur nominale lorsque celle-ci a été cédée par son créancier initial à une autre société. Par exemple : vous devez 30 000 euros à une banque ; celle-ci cède sa créance à une société de recouvrement pour 1 000 euros. Le retrait litigieux vous autorise, sous conditions, à vous libérer en ne payant que ces 1 000 euros. Pour découvrir si vous pouvez mobiliser cet argument et obtenir des réponses claires à vos interrogations, consultez notre FAQ complète sur le retrait litigieux. Voici un tour d’horizon des conditions à maîtriser.
Le retrait litigieux : définition et mécanisme fondamental (articles 1699 et 1700 du code civil)
Le retrait litigieux est la faculté offerte à la personne dont la dette a été cédée (le débiteur cédé) de se substituer à l’acquéreur de la créance (le cessionnaire) en lui remboursant le prix réel que ce dernier a payé pour l’acquérir. Le mot d’ordre de ce mécanisme est de décourager la spéculation sur les créances faisant l’objet d’un procès.
Le principe est posé par l’art. 1699 du Code civil : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. » L’application de ce texte de loi est directe : si votre dette de 100 000 euros est rachetée pour 5 000 euros par une société de recouvrement, vous pouvez éteindre votre obligation en payant ces 5 000 euros, augmentés des frais et intérêts légaux. L’intérêt financier est évident, mais l’exercice de ce droit est encadré par des conditions strictes et cumulatives.
Les 3 conditions cumulatives pour exercer votre droit au retrait litigieux
Pour que le retrait litigieux soit valablement exercé, trois conditions impératives doivent être remplies simultanément. L’absence d’une seule d’entre elles suffit à faire échouer la démarche. Il est donc essentiel de les analyser avec attention avant d’engager toute action.
Condition 1 : L’absence de reconnaissance de la dette avant la cession
Le droit de retrait ne peut être invoqué que si la créance est « litigieuse », c’est-à-dire contestée. Si le débiteur a, d’une manière ou d’une autre, reconnu le bien-fondé de la dette avant sa cession, le droit n’est plus considéré comme litigieux. Tout accord passé avec le créancier initial, comme un échéancier de paiement, une reconnaissance de dette ou un protocole d’accord, anéantit la possibilité de mettre en œuvre le retrait. La signature d’un procès-verbal de conciliation lors d’une procédure de saisie des rémunérations, par lequel vous acceptez de régler la dette, constitue également une reconnaissance qui vous ferme cette voie de droit.
Condition 2 : Une contestation sur le fond du droit, engagée avant la cession
L’article 1700 du Code civil précise que la chose est litigieuse « dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Cela implique deux exigences. Premièrement, une action en justice doit avoir été engagée avant la date de la cession de la créance. Deuxièmement, dans le cadre de ce procès, vous devez avoir soulevé une contestation qui porte sur l’existence ou la validité de la créance cédée. Il peut s’agir, par exemple, de la nullité d’une clause du contrat de prêt, de la forclusion de l’action du créancier, ou d’un désaccord sur le montant dû. Une simple demande de délais de paiement ne constitue pas une contestation suffisante. De même, soulever la prescription comme simple fin de non-recevoir sans formuler de demande au fond peut être jugé insuffisant par une décision de justice. Pour maîtriser tous les pièges procéduraux du retrait litigieux et assurer la validité de votre action, consultez notre article détaillé sur les exigences spécifiques, notamment sur la formulation des demandes principales et subsidiaires. Il est primordial que votre contestation se traduise par une demande claire dans le « dispositif » de vos conclusions, c’est-à-dire dans la partie finale qui énumère ce que vous demandez au juge. Pour aller plus loin sur l’application de ce mécanisme spécifique, notamment si vous êtes une caution confrontée à un retrait litigieux, explorez notre guide dédié.
Condition 3 : Un prix de cession de créance déterminable
L’exercice du retrait litigieux suppose, selon l’article 1699, de rembourser au cessionnaire le « prix réel » de la cession. Cette condition devient un enjeu majeur lorsque votre créance a été vendue au sein d’un portefeuille contenant des milliers d’autres créances, une pratique courante des banques qui se délestent de leurs créances douteuses. Dans ce cas, le prix est global et forfaitaire, ce qui rend la détermination du prix de votre créance individuelle complexe, mais pas impossible.
Décrypter le prix de cession : la clé du retrait face aux portefeuilles titrisés
Les banques cèdent régulièrement des portefeuilles entiers de créances à des sociétés de recouvrement via un fonds commun de titrisation. Ces dernières achètent en bloc des centaines ou milliers de créances pour un prix unique, souvent très inférieur à leur valeur nominale. Cette pratique, qui transfère le risque de non-recouvrement, a pour effet d’opacifier le prix de cession individuel de chaque dette, créant un obstacle majeur à l’exercice du retrait litigieux. Pour comprendre en détail comment le prix de cession des portefeuilles titrisés peut être décrypté et servir votre droit, nous avons un guide approfondi sur ce mécanisme complexe.
La méthode du calcul de proportion : une solution validée par la jurisprudence
Face à un prix de cession global, la jurisprudence a admis qu’il était possible de déterminer le prix d’une créance individuelle par un simple calcul de proportionnalité. Cette méthode, validée notamment par la Cour d’appel de Rennes et la Cour d’appel de Paris, consiste à appliquer au montant nominal de votre créance le pourcentage que représente le prix de cession global par rapport au montant nominal total du portefeuille. La formule est la suivante : (Prix global du portefeuille / Valeur nominale totale du portefeuille) x Valeur nominale de votre créance. Par exemple, si un portefeuille de créances d’une valeur totale de 250 millions d’euros est cédé pour 70 millions d’euros (soit 28% de la valeur), une créance de 100 000 euros comprise dans ce portefeuille aura un prix de retrait déterminable de 28 000 euros.
Comment contrer les arguments du cessionnaire sur le prix indéterminable ?
Les sociétés de recouvrement, comme par exemple la société EOS France, opposent systématiquement que le prix est « global et forfaitaire », qu’il intègre un « aléa » sur le recouvrement et qu’il est donc impossible de valoriser chaque créance individuellement. Pour contrer ces arguments, votre avocat doit exiger en justice, au besoin via une sommation de communiquer fondée sur le Code de procédure civile, la production du bordereau de cession de créances et de ses annexes. En l’espèce, ce document est la clé, car il liste l’ensemble des créances cédées. Il permet de connaître la valeur nominale totale du portefeuille. L’argument de fond consiste à soutenir que le cessionnaire a nécessairement procédé à une analyse, même statistique, de la valeur du portefeuille pour formuler son offre d’achat. Il n’achète pas à l’aveugle. Cette analyse, qui fonde le prix global, justifie le recours au calcul proportionnel pour individualiser le prix de votre dette.
Le rôle de la caution : une voie d’action stratégique et souvent ignorée
La caution, souvent considérée comme une simple garante, est en réalité un acteur qui peut se saisir du retrait litigieux pour défendre ses propres intérêts. En tant que personne légalement tenue de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal, elle a la qualité et l’intérêt à agir pour voir le montant de son engagement réduit. Le droit français lui permet d’exercer ce droit de manière autonome.
Conditions d’exercice du retrait par la caution
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point (par ex. Cass. Civ. 1ère) : les conditions de fond pour l’exercice du droit (caractère litigieux de la créance avant la cession) s’apprécient au niveau de la situation du débiteur principal. Si le procès a été engagé et la dette contestée par ce dernier avant la cession, la caution peut se saisir de ce contexte pour exercer le retrait litigieux. Elle agit alors pour son propre compte, dans le but de limiter le montant de la somme qu’elle pourrait être amenée à payer. Elle se substitue ainsi au cessionnaire en procédant au rachat de créance au prix de cession, se libérant par la même occasion de son engagement de cautionnement pour le montant initial.
Comment articuler le retrait litigieux avec la disproportion du cautionnement ?
Une stratégie de défense efficace pour une caution consiste à articuler plusieurs arguments. La caution peut, à titre principal, demander le bénéfice du retrait litigieux pour éteindre la dette à moindre coût. Si cette demande venait à échouer (par exemple, si le prix de cession est jugé indéterminable), elle peut invoquer, à titre subsidiaire, le caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses revenus et son patrimoine au moment de la signature. Cet argument, s’il est accueilli, peut conduire à la décharge de son obligation de paiement, parfois dans son intégralité. Cette double approche, validée par plusieurs arrêts notables, maximise les chances de protection de la caution.
Pièges procéduraux et délais d’action : sécuriser sa démarche
L’exercice du retrait litigieux ne s’improvise pas. Il est soumis à des règles de procédure strictes et à des délais d’appréciation souveraine par les juridictions du fond. Une demande mal formulée ou tardive peut être déclarée irrecevable, anéantissant vos chances de succès malgré un dossier solide.
Demande principale ou subsidiaire : une distinction déterminante
La manière dont vous formulez votre demande de retrait litigieux devant le juge est stratégique. Pendant longtemps, les débiteurs la présentaient souvent « à titre subsidiaire », après avoir contesté à titre principal la validité même de la créance. Cependant, une jurisprudence de plus en plus stricte, notamment de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, tend à sanctionner cette pratique. Il est important de noter que certains juges considèrent qu’en ne demandant le retrait qu’en dernier recours, le débiteur admet implicitement la validité de la créance, ce qui contredit la condition de « contestation sur le fond ». Pour sécuriser votre démarche et ne pas vous voir opposer un abus de droit, il est fortement conseillé de formuler la demande de retrait litigieux à titre principal, tout en maintenant vos autres contestations.
Dans quel délai exercer le retrait litigieux après la cession ?
Le Code civil ne fixe aucun délai de prescription ou de forclusion spécifique pour exercer le droit de retrait litigieux. Cette absence de délai légal ne signifie pas que vous pouvez agir indéfiniment. La jurisprudence, dans un souci de sécurité juridique, a comblé ce vide en exigeant que le défendeur à l’action en paiement agisse dans un « délai raisonnable ». Ce délai commence à courir à partir du moment où le débiteur a eu connaissance non seulement de l’existence de la cession, mais aussi du prix réel de cette cession. C’est en effet seulement à cet instant qu’il dispose de tous les éléments pour décider d’exercer son droit. L’appréciation du caractère « raisonnable » du délai est laissée à la libre appréciation des juges, d’où l’importance de ne pas tarder à agir au cours de l’instance une fois l’information sur le prix obtenue.
Retrait litigieux face aux procédures collectives : quelles opportunités ?
L’interaction entre le retrait litigieux et le droit des entreprises en difficulté (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) est complexe mais peut révéler des opportunités. Le droit de retrait ne s’éteint pas du simple fait de l’ouverture d’une procédure collective et peut être un outil de financement indirect pour réduire le passif de l’entreprise.
Exercer le retrait lorsque le débiteur est en procédure collective
Si une entreprise débitrice fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, son représentant légal (mandataire ou liquidateur judiciaire) peut exercer le droit de retrait litigieux au nom de la procédure. Si les conditions sont réunies (procès et contestation antérieurs à la cession), cette action permet de racheter une créance inscrite au passif pour une fraction de sa valeur. Le but est de réduire le montant total des dettes de l’entreprise, ce qui peut faciliter l’élaboration d’un plan de redressement ou augmenter l’actif disponible pour les autres créanciers en cas de liquidation.
Quand le cédant ou le cessionnaire est en difficulté
La situation se complexifie lorsque c’est le créancier initial (la banque cédante) ou l’acquéreur de la créance (la société de recouvrement) qui fait l’objet d’une procédure collective. Cette situation peut paradoxalement jouer en faveur du débiteur. Par exemple, la liquidation judiciaire du cessionnaire peut rendre l’accès aux documents de la cession, et notamment au prix, plus aisé. Le liquidateur judiciaire, dont la mission est de réaliser les actifs, pourrait être plus enclin à accepter une offre de rachat via le retrait litigieux pour clore rapidement le dossier et récupérer des liquidités, une information qui peut parfois se retrouver dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Guide pratique : les 4 étapes pour mettre en œuvre le retrait litigieux
Voici une synthèse des étapes clés pour engager une procédure de retrait litigieux avec des chances de succès.
Étape 1 : Auditer sa situation et préserver le caractère litigieux de la dette
Avant toute chose, vérifiez qu’aucun accord (échéancier, reconnaissance de dette) n’a été signé avec le créancier initial. Assurez-vous qu’une contestation sur le fond de la dette a bien été engagée en justice avant la date de la cession et qu’elle est toujours active. C’est le fondement de votre droit.
Étape 2 : Obtenir les preuves de la cession et du prix
Dans le cadre de la procédure judiciaire qui vous oppose au cessionnaire (la société de recouvrement), votre avocat doit le sommer de communiquer l’acte de cession et ses annexes (le fameux bordereau). Ces documents sont indispensables pour prouver la date de la cession et, surtout, pour obtenir les éléments nécessaires au calcul du prix.
Étape 3 : Engager l’action en justice avec la bonne stratégie
Une fois les informations obtenues, formulez votre demande de retrait litigieux. Comme vu précédemment, et comme le suggère un rappel de la jurisprudence récente, il est prudent de la présenter à titre principal. Agissez rapidement après avoir eu connaissance du prix pour ne pas vous voir opposer un délai d’action déraisonnable.
Étape 4 : Consigner le prix de rachat
L’exercice du retrait n’est pas une simple demande, il suppose une offre de remboursement effective. Vous devez être en mesure de payer le prix de cession, les frais de l’opération et les intérêts légaux. Il est souvent conseillé, à titre de preuve de son intention sérieuse, de consigner cette somme auprès d’un séquestre (comme la Caisse des Dépôts et Consignations) pour prouver au juge le sérieux de votre démarche et votre capacité à vous libérer.
Le retrait litigieux est une arme de défense redoutable pour le débiteur et sa caution, mais son maniement exige une expertise technique et une stratégie procédurale rigoureuse. L’assistance d’un avocat compétent en droit bancaire est indispensable pour naviguer entre les conditions strictes et les pièges potentiels. Pour une analyse approfondie de votre situation et un conseil adapté, notre cabinet se tient à votre disposition.
Sources
- Article 1699 du Code civil
- Article 1700 du Code civil
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Jurisprudence notable (exemples) : Cass. Civ. 1ère, Cass. Com., RTD Civ., Cour d’appel de Paris (Pôle 5, Chambre 6)