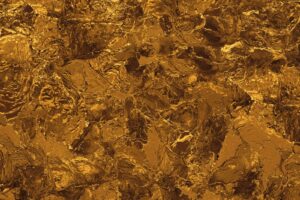La défaillance d’un établissement bancaire représente un risque majeur pour ses clients. Que vous soyez un particulier avec un simple compte courant ou une entreprise gérant plusieurs lignes de crédit, les conséquences peuvent être sévères. Cet article explore les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés bancaires, ainsi que les protections dont bénéficient les déposants.
La prévention des difficultés bancaires
Le rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
L’ACPR surveille en permanence la santé financière des établissements de crédit. Créée par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 et renforcée par la loi du 26 juillet 2013, elle dispose de pouvoirs étendus pour détecter et prévenir les situations à risque.
Selon l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier, l’ACPR a pour mission de :
- Contrôler le respect des règles prudentielles
- Veiller à la protection des clients
- Prévenir et résoudre les crises bancaires
Les indicateurs d’alerte
Les banques doivent respecter des ratios stricts concernant :
- Le niveau de fonds propres (ratio de solvabilité minimum de 8%)
- La liquidité (coefficient minimum de 100%)
- La division des risques (pas plus de 25% des fonds propres sur un même bénéficiaire)
Ces exigences, issues du règlement (UE) n°575/2013, constituent la première ligne de défense contre les défaillances.
L’administration provisoire
Quand la situation se dégrade, l’ACPR peut désigner un administrateur provisoire. L’article L. 613-18 du Code monétaire et financier précise que cet administrateur assume « tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale ».
Cette mesure intervient généralement avant que la banque ne soit en cessation des paiements.
Le traitement des difficultés bancaires
Une procédure collective spécifique
La cessation des paiements d’une banque obéit à une définition particulière. L’article L. 613-26 du Code monétaire et financier la définit comme l’impossibilité « d’assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ».
La procédure collective ne peut être ouverte qu’après avis de l’ACPR (article L. 613-27), contrairement au droit commun des entreprises.
Liquidateurs bancaires et judiciaires
En cas de liquidation, deux liquidateurs coexistent :
- Un liquidateur nommé par l’ACPR (article L. 613-29)
- Un liquidateur judiciaire désigné par le tribunal
Le premier s’occupe des inventaires et opérations bancaires spécifiques, tandis que le second gère les aspects généraux de la liquidation. La Cour de cassation a précisé leurs rôles respectifs dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°18-11.743).
La coordination européenne
Depuis la directive 2001/24/CE du 4 avril 2001, transposée par l’ordonnance n°2004-1127 du 21 octobre 2004, les procédures d’insolvabilité bancaire obéissent au principe d’unicité. La liquidation est pilotée par les autorités du pays où la banque a son siège statutaire.
Cette coordination évite le morcellement des procédures et des actifs entre différents pays.
La protection des déposants
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR)
Le FGDR, rebaptisé ainsi par la loi du 26 juillet 2013, intervient lorsque l’ACPR constate qu’un établissement ne peut plus restituer les fonds confiés.
Tous les établissements de crédit agréés en France doivent obligatoirement y adhérer (article L. 312-4 du Code monétaire et financier).
Plafond d’indemnisation
Le FGDR garantit les dépôts jusqu’à 70 000 € par déposant et par établissement. Ce montant, fixé par le règlement CRBF n°99-05 du 21 juillet 1999, a été maintenu alors que la garantie européenne standard est de 100 000 €.
Ce plafond s’applique à l’ensemble des comptes détenus dans une même banque, pas à chaque compte séparément.
Procédure et délais d’indemnisation
Après constatation de l’indisponibilité des fonds par l’ACPR, le FGDR dispose de 20 jours ouvrables pour indemniser les déposants. Ces délais sont souvent plus courts en pratique.
Les créances exclues du dispositif doivent être déclarées selon la procédure classique des procédures collectives.
Les recours des clients
Les clients d’une banque défaillante disposent de plusieurs voies de recours :
- La déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective
- L’action en responsabilité contre les dirigeants (article L. 312-6 du Code monétaire et financier)
- Le recours contre les décisions du FGDR
L’article L. 312-6 précise que le FGDR peut lui-même « engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient ».
Les clients lésés au-delà du plafond de garantie peuvent obtenir un remboursement complémentaire en fonction des actifs récupérés lors de la liquidation. Mais cela prend souvent plusieurs années.
Sources
- Code monétaire et financier, articles L. 511-41, L. 612-1, L. 613-18, L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 312-4, L. 312-6
- Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance
- Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
- Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit
- Ordonnance n°2004-1127 du 21 octobre 2004 transposant la directive 2001/24/CE
- Règlement CRBF n°99-05 du 21 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts
- Règlement (UE) n°575/2013 concernant les exigences prudentielles
- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, n°18-11.743