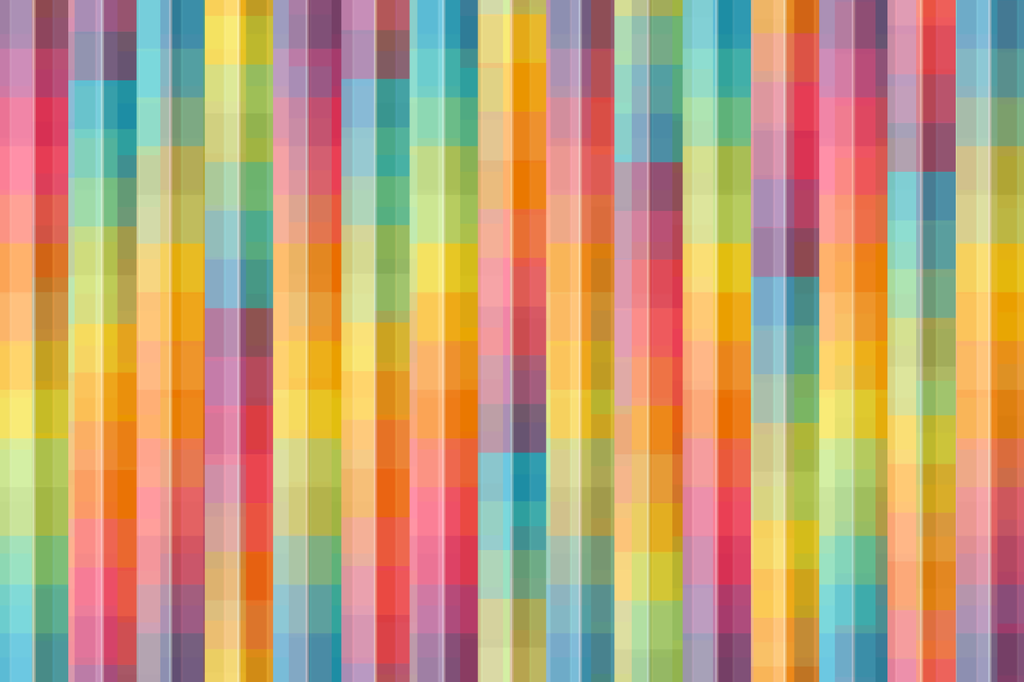Quand on se porte caution, on s’engage à payer la dette d’un tiers en cas de défaillance. Cet acte crée des relations juridiques complexes entre la caution, le créancier et le débiteur principal. Un réseau d’obligations et de droits en découle. Comprendre ces mécanismes est vital pour quiconque envisage de se porter garant.
I. Relations caution-créancier : droits et obligations
A. Obligations d’information du créancier
Le législateur a imposé au créancier diverses obligations d’information pour protéger la caution.
L’article 2302 du Code civil prévoit une information annuelle. Le créancier doit notifier à la caution, avant le 31 mars, le montant de la dette au 31 décembre précédent. Ce document précise aussi le terme de l’engagement ou la faculté de résiliation.
En cas d’impayé, l’article 2303 exige que le créancier informe la caution dès le premier incident non régularisé dans le mois suivant l’échéance.
Le manquement à ces obligations est sanctionné. Le créancier perd les intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle où la caution en est informée.
Ces obligations concernent tous les créanciers professionnels. La charge de la preuve pèse sur eux. Ils doivent justifier l’envoi effectif des informations, un simple exemplaire de lettre ne suffit pas.
B. Poursuites du créancier contre la caution
Le créancier ne peut poursuivre la caution que si la dette est exigible. Cette condition semble évidente, mais soulève des questions pratiques. La caution peut-elle invoquer un terme accordé au débiteur? Bénéficie-t-elle des délais de grâce?
Pour se défendre, la caution dispose de plusieurs moyens.
Elle peut d’abord opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette (nullité du contrat principal, compensation, prescription). Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution peut même invoquer les exceptions personnelles au débiteur, hormis son incapacité.
La caution simple dispose du bénéfice de discussion. Elle peut exiger que le créancier saisisse d’abord les biens du débiteur. Ce droit est refusé aux cautions solidaires et aux cautions judiciaires.
En présence de plusieurs cautions, chacune peut invoquer le bénéfice de division, obligeant le créancier à diviser ses poursuites.
Enfin, la loi protège le minimum vital de la caution personne physique. L’action du créancier ne peut jamais priver celle-ci d’un « reste à vivre » équivalent au RSA.
II. Relations caution-débiteur : mécanismes de recours
A. Recours personnel après paiement
La caution n’est pas destinée à supporter la charge finale de la dette. Après avoir payé, elle dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal.
L’article 2308 du Code civil précise que ce recours couvre:
- Les sommes payées au créancier
- Les intérêts légaux (qui courent de plein droit)
- Les frais engagés après dénonciation des poursuites au débiteur
La caution peut aussi obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice distinct du simple paiement (frais irrépétibles, tracas administratifs).
Ce recours présente un avantage: son étendue peut dépasser ce que la caution a versé. Son inconvénient majeur: la caution reste un créancier chirographaire, sans garantie particulière.
En cas de paiement partiel, la caution entre en concurrence avec le créancier initial. Les créanciers prévoient souvent une clause de non-concours pour éviter cette situation.
B. Recours subrogatoire
Parallèlement, l’article 2309 offre à la caution un recours subrogatoire. La caution se trouve « dans les souliers » du créancier original.
Ce mécanisme présente un atout majeur: la caution profite des sûretés dont bénéficiait le créancier (hypothèques, gages, autres cautionnements).
Mais ce recours a ses limites:
- Il ne peut excéder ce que la caution a payé
- Il est soumis au délai de prescription de l’action du créancier
- Il ne couvre pas les dommages-intérêts
En pratique, la caution peut exercer simultanément les deux recours, mais ne peut évidemment pas cumuler leur produit.
III. Relations entre cofidéjusseurs
A. Division des poursuites
Quand plusieurs personnes cautionnent une même dette, elles sont cofidéjusseurs. La caution qui a payé l’intégralité peut se retourner contre les autres.
Contrairement au recours contre le débiteur principal, ce recours entre cautions est divisé. Chaque cofidéjusseur n’est tenu que pour sa part.
Si l’un des cofidéjusseurs est insolvable, sa part se répartit entre la caution solvens et les autres cautions solvables.
Cette répartition se fait habituellement par parts viriles (égales). Mais quand les cautions se sont engagées pour des montants différents, on applique une répartition proportionnelle.
B. Types de recours entre cautions
L’article 2312 offre à la caution solvens un recours personnel contre les cofidéjusseurs. Ce recours est limité à la part de chacun dans la dette.
La caution bénéficie aussi d’un recours subrogatoire. Mais il suit la même règle de division: la caution ne peut demander à chaque cofidéjusseur que sa part.
Ces recours ne peuvent être exercés qu’après paiement. La caution peut néanmoins appeler ses cofidéjusseurs en garantie lors des poursuites du créancier.
IV. Situation particulière des ex-conjoints
A. Le mécanisme de l’article 1387-1 du Code civil
L’article 1387-1 du Code civil crée un mécanisme spécifique pour les dettes professionnelles des époux divorcés.
Le texte dispose: « lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel. »
Cette disposition suscite des controverses d’interprétation. Deux lectures s’affrontent:
Certains y voient une mesure d’extinction de l’obligation à la dette. Le juge libérerait l’ex-conjoint de son engagement envers le créancier.
D’autres l’interprètent comme une règle de contribution à la dette. L’ex-conjoint resterait tenu envers le créancier, mais pourrait exercer un recours intégral contre son ex-époux entrepreneur.
B. Protection et limites
La jurisprudence penche vers la seconde interprétation. Elle préserve les droits du créancier et la force obligatoire des contrats.
Dans une décision de novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance d’Évreux a considéré que l’article 1387-1 ne supprime pas l’obligation à la dette. Il permet seulement au juge de décider, dans le cadre de la liquidation de la communauté et uniquement entre époux, que la contribution finale à la dette sera supportée par celui qui conserve l’entreprise.
Cette solution ménage les intérêts légitimes du créancier tout en offrant une protection à l’ex-conjoint, qui dispose d’un recours spécifique.
La Cour de cassation n’a pas encore tranché définitivement cette question. Dans son premier arrêt sur ce texte (5 septembre 2018), elle a évité de prendre position sur la portée exacte du dispositif.
Les effets du cautionnement forment un réseau complexe d’obligations et de droits. Cautions, débiteurs et créanciers doivent connaître leurs positions respectives. Les réformes récentes, notamment l’ordonnance du 15 septembre 2021, ont renforcé la protection des cautions sans compromettre l’efficacité de cette sûreté.
Pour qui se porte caution, mieux vaut comprendre ces mécanismes avant de s’engager. Pour le créancier, respecter ses obligations d’information est crucial. Quant au débiteur, il doit mesurer les risques qu’il fait porter sur ses garants.
Sources
- Code civil, articles 2288 à 2320
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Cour de cassation, arrêt du 5 septembre 2018, n° 17-23.120
- Tribunal de Grande Instance d’Évreux, 17 novembre 2006