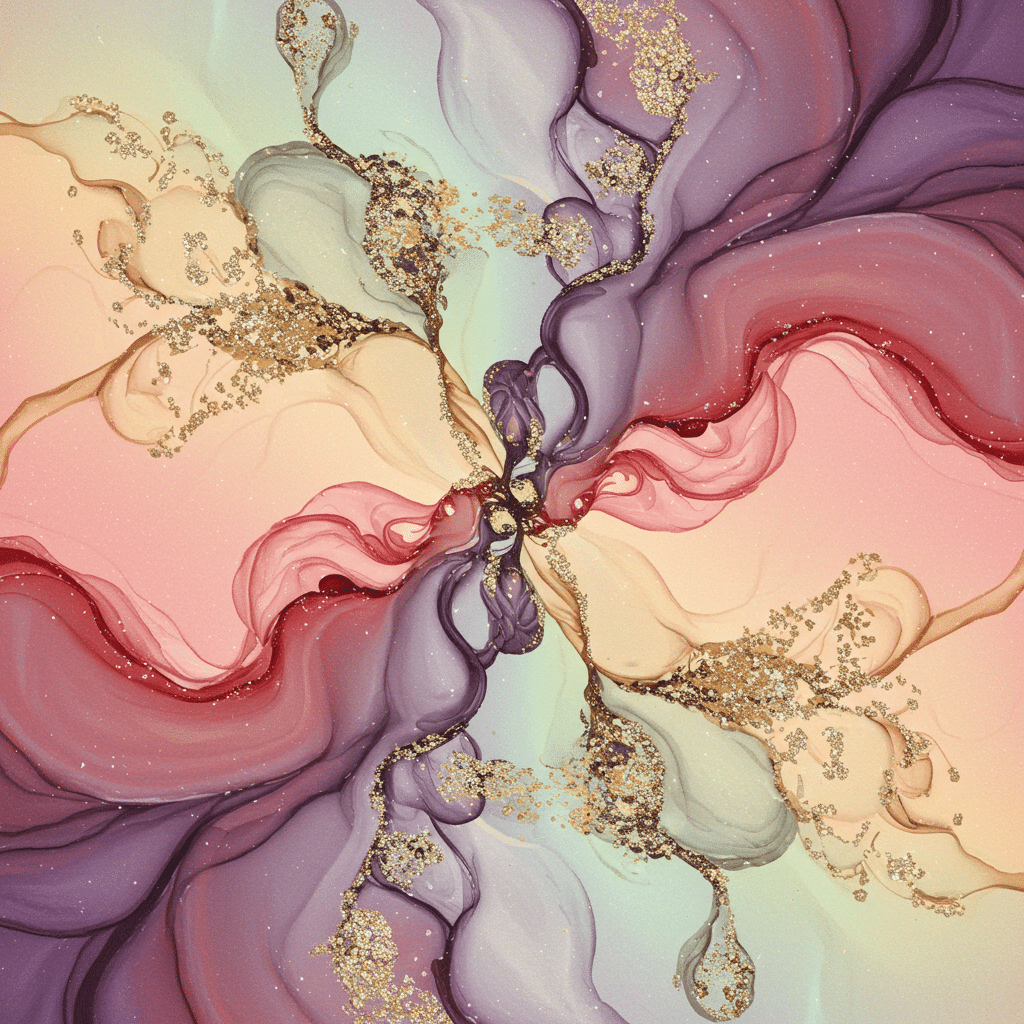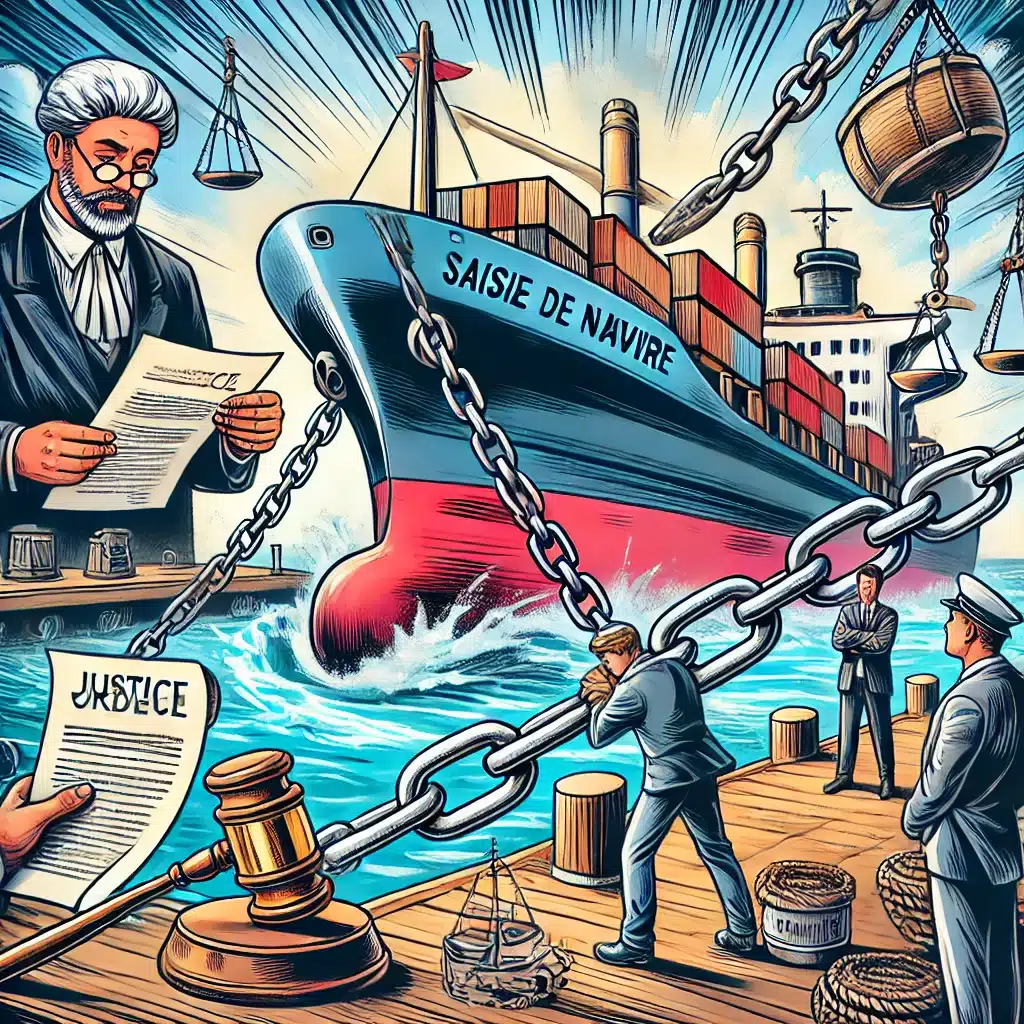À l’heure de la mondialisation et du commerce électronique, les marchés ne connaissent plus guère de frontières. Votre entreprise vend peut-être ses produits à l’étranger, ou vous êtes confronté à des concurrents basés hors de France. Cette ouverture internationale est une source d’opportunités, mais elle peut aussi complexifier les litiges. Que se passe-t-il si l’entreprise qui vous concurrence de manière déloyale est située dans un autre pays ? Ou si ses agissements, par exemple via internet, vous causent un préjudice sur plusieurs marchés nationaux ? La concurrence déloyale transfrontalière soulève des questions juridiques spécifiques : une entreprise étrangère peut-elle agir devant les tribunaux français ? Quel tribunal est compétent pour juger un litige international ? Et surtout, quelle loi le juge appliquera-t-il pour trancher l’affaire, ainsi que les sanctions et procédures applicables ? Aborder ces questions nécessite une expertise particulière en droit international privé, mais comprendre les grands principes de la concurrence déloyale en droit interne peut vous aider à mieux appréhender la situation.
Les étrangers peuvent-ils agir en France et vice-versa ?
La première question est simple : le terrain de jeu judiciaire est-il ouvert à tous ? La réponse est clairement oui. Le droit français, comme la plupart des droits modernes, repose sur un principe fondamental d’égalité de traitement entre les nationaux et les étrangers devant la justice.
Une entreprise étrangère, ou même un particulier étranger, qui s’estime victime d’actes de concurrence déloyale commis en France ou produisant leurs effets sur le marché français peut tout à fait saisir les tribunaux français pour défendre ses intérêts. Il n’y a aucune discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement.
Cette ouverture repose sur deux piliers :
- La Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée dès 1883 et ratifiée par une très grande majorité de pays dans le monde (dont la France). Ce texte fondamental prévoit que les ressortissants de chaque pays membre bénéficient, dans tous les autres pays membres, de la même protection que les nationaux, notamment en matière de répression de la concurrence déloyale (article 10 bis). C’est le principe du « traitement national ».
- Le droit interne français lui-même, qui, depuis une décision fondatrice de la Cour de cassation (l’arrêt Lefait de 1948), reconnaît que les étrangers jouissent en France de tous les droits qui ne leur sont pas expressément refusés par une loi. Or, aucun texte ne refuse aux étrangers le droit d’agir en justice pour concurrence déloyale.
Inversement, une entreprise française victime d’actes de concurrence déloyale commis par une entreprise étrangère ou ayant des effets à l’étranger pourra, selon les cas, envisager d’agir soit en France (si les tribunaux français sont compétents, voir ci-dessous), soit directement devant les tribunaux du pays étranger concerné, en bénéficiant généralement là aussi du principe du traitement national si ce pays est membre de la Convention de Paris.
Quel tribunal saisir ? La compétence internationale des juridictions françaises
C’est souvent la question la plus épineuse : si un litige a des liens avec plusieurs pays, quel tribunal est compétent pour le juger ? Il est essentiel de bien identifier la nature du litige, car les distinctions entre concurrence déloyale et d’autres types de litiges (comme la contrefaçon ou les pratiques anticoncurrentielles) peuvent complexifier le choix de la juridiction. Les règles varient selon que le défendeur (celui que vous attaquez) est domicilié dans l’Union Européenne ou en dehors.
Si votre concurrent est domicilié dans un pays de l’UE (Allemagne, Italie, Espagne, etc.), ce sont les règles européennes unifiées du Règlement « Bruxelles I bis » (n° 1215/2012) qui s’appliquent. Ce règlement prévoit :
- La règle de base : vous pouvez toujours saisir les tribunaux du pays où le défendeur a son domicile (son siège social statutaire, son administration centrale ou son principal établissement pour une société). Ce tribunal aura une compétence générale pour juger l’ensemble du litige et réparer la totalité du préjudice, où qu’il se soit produit.
- Une option importante pour vous, demandeur (article 7.2 du Règlement) : en matière délictuelle (ce qui est le cas de la concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil), vous pouvez aussi choisir de saisir les tribunaux du « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que cette expression vise deux possibilités :
- Soit le lieu de l’événement causal : là où la faute a été commise (par exemple, le pays depuis lequel une publicité dénigrante a été conçue et diffusée).
- Soit le lieu où le dommage se manifeste : là où le préjudice est subi, c’est-à-dire typiquement là où votre marché est affecté (par exemple, le pays où vous perdez des clients à cause de la confusion ou du dénigrement).
Cette option vous donne donc une marge de manœuvre stratégique. Si une entreprise allemande commet des actes déloyaux qui affectent principalement votre marché en France, vous pourrez choisir de l’attaquer soit en Allemagne (son domicile), soit en France (lieu du dommage).
Que se passe-t-il si le dommage est subi dans plusieurs pays (par exemple, un dénigrement sur un site internet accessible partout en Europe) ?
- Si vous saisissez le tribunal du lieu de l’événement causal ou du domicile du défendeur, il pourra statuer sur l’intégralité du préjudice subi dans tous les pays.
- Si vous choisissez de saisir le tribunal d’un des pays où le dommage s’est manifesté (par exemple, la France), ce tribunal ne sera compétent que pour statuer sur le préjudice subi sur son propre territoire national (en l’occurrence, en France). C’est la jurisprudence « Fiona Shevill ».
Concernant spécifiquement les litiges liés à internet, les tribunaux considèrent généralement que la simple accessibilité d’un site web fautif depuis la France ne suffit pas toujours à fonder leur compétence. Il faut souvent démontrer un lien de rattachement suffisant avec le marché français : le site vise-t-il spécifiquement le public français (langue, livraison possible en France…) ? A-t-il un impact économique réel en France ?
Si votre concurrent est domicilié hors de l’UE, ce sont les règles de droit commun français qui s’appliquent. Elles sont assez similaires : vous pouvez saisir les tribunaux français si le défendeur a un établissement en France, si le fait générateur de la faute a eu lieu en France, ou si le dommage est subi en France. Les règles spécifiques des articles 14 et 15 du Code civil (qui donnent compétence aux tribunaux français si le demandeur ou le défendeur est français) peuvent aussi jouer, mais leur application est de plus en plus limitée par les conventions internationales et les règles européennes.
Enfin, n’oubliez pas les clauses attributives de juridiction. Si vous aviez un contrat avec votre concurrent (même s’il n’est pas directement la cause du litige de concurrence déloyale) et que ce contrat désignait un tribunal compétent en cas de différend, cette clause pourrait s’appliquer et déterminer le tribunal compétent, même pour votre action en concurrence déloyale si elle est liée à cette relation contractuelle.
Quelle loi s’applique au litige ? Le conflit de lois
Une fois le tribunal compétent identifié (par exemple, un tribunal français), une autre question se pose : quelle loi nationale ce tribunal va-t-il appliquer pour juger si les actes sont déloyaux et quelles en sont les conséquences ? Il n’appliquera pas forcément la loi française, même s’il est un tribunal français. C’est la question du « conflit de lois », résolue là encore par des règles spécifiques.
Si le litige relève du champ d’application européen (la plupart des litiges intra-européens dont les faits sont postérieurs à janvier 2009), c’est le Règlement « Rome II » (n° 864/2007) qui désigne la loi applicable aux obligations non contractuelles. Ce règlement contient un article spécifique (article 6) pour la concurrence déloyale :
- La règle principale est l’application de la loi du pays où les relations de concurrence sont affectées ou susceptibles de l’être. C’est la loi du « marché affecté ». Par exemple, si une entreprise italienne dénigre une entreprise française sur le marché allemand, le juge (français, italien ou allemand) devrait en principe appliquer la loi allemande. Si seul le marché français est touché, ce sera la loi française.
- Que faire si plusieurs marchés sont affectés (par exemple, une copie parasitaire vendue dans toute l’Europe) ? Le règlement permet au juge d’appliquer distributivement la loi de chaque marché affecté (ce qui est très complexe) ou parfois, si l’action vise l’ensemble des effets, la loi du pays où l’auteur de la faute est établi pourrait jouer un rôle.
- Il existe une exception importante : si l’acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé (par exemple, un dénigrement très ciblé ou le débauchage de personnel clé visant une seule entreprise), on n’applique plus la loi du marché affecté, mais la règle générale pour les délits (article 4 de Rome II), qui désigne le plus souvent la loi du pays où le dommage direct est subi par cette victime spécifique.
Si le Règlement Rome II n’est pas applicable (faits plus anciens, litiges sans lien suffisant avec l’UE), c’est le droit commun français du conflit de lois qui s’applique. La règle traditionnelle est la lex loci delicti commissi : la loi du lieu où le délit (ou quasi-délit) a été commis. Mais comme pour la compétence, ce lieu peut être celui de la faute ou celui du dommage. La jurisprudence française tend de plus en plus à choisir la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation, ce qui, en matière de concurrence déloyale, revient très souvent à appliquer la loi du marché affecté, rejoignant ainsi la logique du Règlement Rome II.
Naviguer dans les méandres du droit international privé de la concurrence déloyale peut s’avérer complexe. Déterminer le bon tribunal et la loi applicable nécessite une analyse fine de la situation et une connaissance pointue des règles européennes et internationales.
Les litiges internationaux de concurrence déloyale nécessitent une expertise spécifique en droit international privé. Notre cabinet peut vous offrir une assistance juridique spécialisée pour naviguer ces complexités et défendre vos intérêts au-delà des frontières. Contactez-nous pour une consultation.
Sources
- Code civil : Article 14, Article 15 (Privilèges de juridiction), Article 1240, Article 1241.
- Code de procédure civile : Article 42, Article 46 (Compétence territoriale interne).
- Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle : Article 10 bis (Traitement national, définition CD).
- Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (« Bruxelles I bis ») : Article 4 (Compétence générale domicile défendeur), Article 7 (Compétences spéciales, notamment délictuelle).
- Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil (« Rome II ») : Article 4 (Loi applicable aux délits en général), Article 6 (Loi applicable à la concurrence déloyale).