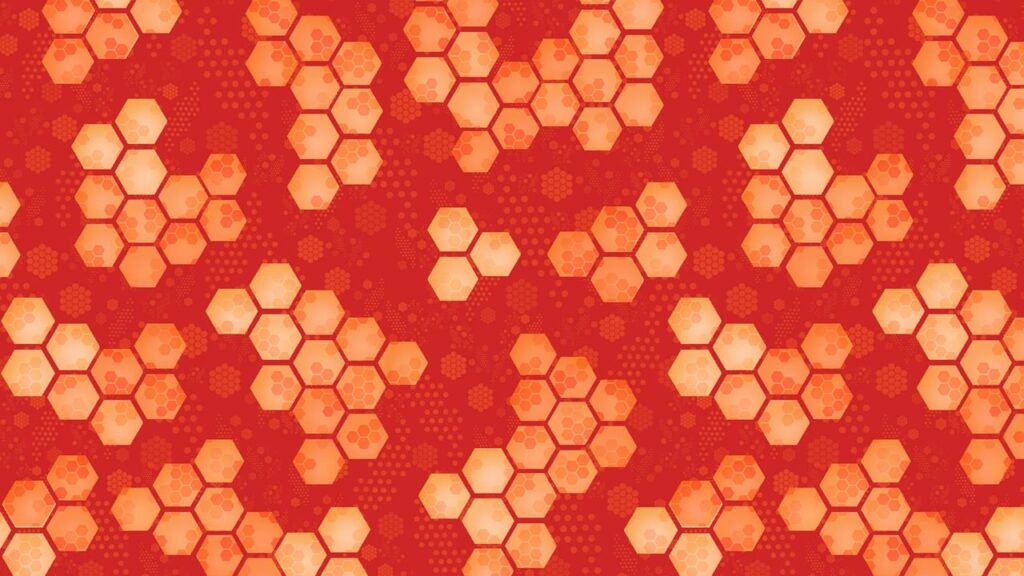La saisie-attribution constitue un mécanisme redoutable pour les créanciers munis d’un titre exécutoire. Cette procédure permet d’obtenir le paiement rapide d’une créance en bloquant les sommes dues au débiteur par un tiers. Ses effets juridiques sont immédiats et radicaux, mais restent encadrés par un système de contestation qui garantit les droits du débiteur.
1. Effets juridiques de la saisie-attribution
Indisponibilité partielle ou totale des sommes saisies
L’acte de saisie-attribution crée une indisponibilité des sommes qui en sont l’objet, conformément à l’article L. 141-2 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Cette indisponibilité est généralement partielle : elle se limite aux sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Toutefois, dans le cas spécifique d’une saisie-attribution opérée entre les mains d’un établissement bancaire, l’indisponibilité devient totale. L’article R. 211-19 combiné à l’article L. 162-1 du CPCE prévoit que l’ensemble des comptes du débiteur est bloqué pendant quinze jours ouvrables suivant la signification.
Concrètement, cela empêche:
- Le tiers saisi de payer le débiteur
- Ce dernier de céder sa créance
- Toute compensation avec une créance ultérieure
Attribution immédiate de la créance
L’effet majeur qui distingue la saisie-attribution est précisé à l’article L. 211-2 du CPCE: « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. »
Dès la signification de l’acte, le créancier devient donc propriétaire de la créance saisie. Cette caractéristique explique pourquoi cette procédure est si efficace: la créance sort instantanément du patrimoine du débiteur pour entrer dans celui du créancier saisissant.
Indifférence des saisies ultérieures
La conséquence logique de ce transfert immédiat est que toute saisie postérieure est sans effet sur la créance déjà attribuée. L’article L. 211-2, alinéa 2 du CPCE précise que « La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure collective ne remettent pas en cause cette attribution. »
Ce principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique quels que soient les privilèges dont peuvent se prévaloir les créanciers postérieurs. Même un créancier superprivilegié (comme un salarié) arrivant après l’attribution ne peut remettre en cause la saisie.
Indifférence de l’ouverture d’une procédure collective postérieure
L’effet attributif immédiat résiste même à l’ouverture ultérieure d’une procédure collective. La Cour de cassation a confirmé cette solution dans un arrêt de principe du 22 novembre 2002 (Cass. ch. mixte, 22 nov. 2002, n° 99-13.935). Le créancier qui a pratiqué une saisie-attribution avant l’ouverture d’une procédure collective échappe donc à la discipline collective.
La Chambre mixte a affirmé que « la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ».
2. Cas particuliers affectant les effets de la saisie
Créances à exécution successive
Les créances à exécution successive, comme les loyers, constituent un cas particulier. L’article L. 112-1, alinéa 2 du CPCE autorise la saisie de ces créances.
Une seule saisie-attribution suffit pour appréhender toutes les échéances à venir. Cette règle s’applique même si le débiteur fait ultérieurement l’objet d’une procédure collective, comme l’a confirmé la jurisprudence précitée.
Le paiement intervient alors au fur et à mesure des échéances. Selon l’article R. 211-15 du CPCE: « En l’absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l’article R. 211-6. »
Indisponibilité résultant d’un texte spécial
Certains textes spéciaux peuvent rendre indisponibles des sommes d’argent, empêchant ainsi leur saisie. Voici quelques exemples:
- Les indemnités d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, etc., sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires selon l’article L. 121-13 du Code des assurances.
- Les sommes déposées à titre de garantie lors d’une vente à terme d’immeuble à construire sont insaisissables (article L. 261-12, alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation).
- Les fonds qu’un avocat reçoit pour son client et qui transitent par un compte CARPA sont insaisissables (Cass. 2e civ., 18 févr. 1985).
Ces indisponibilités spéciales font échec à la saisie-attribution car celle-ci ne peut porter que sur des sommes disponibles.
Pluralité de saisies pratiquées le même jour
L’article L. 211-2, alinéa 3 du CPCE règle le cas des saisies multiples signifiées le même jour: « Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. »
Dans ce cas exceptionnel, la règle du « premier arrivé, premier servi » cède la place au principe du concours entre créanciers.
La Cour de cassation précise que cette répartition doit se faire au prorata des créances, sans tenir compte des privilèges des créanciers (Cass., avis, 24 mai 1996, n° 09-60.004).
3. Régime des contestations
Délai pour contester
La saisie-attribution peut être contestée dans un délai strict d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. L’article L. 211-4 du CPCE prévoit que « Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d’un mois. »
Ce délai a une nature particulière:
- Il n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption (CA Colmar, 30 mai 1994), sauf en cas d’ouverture d’une procédure collective (Cass. com., 19 janv. 1999, n° 96-18.256)
- Son expiration rend irrecevable toute contestation ultérieure
- Il court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur
Après ce délai, seule une action en répétition de l’indu reste possible pour le débiteur, mais à ses frais (article L. 211-4, alinéa 3 du CPCE).
Juge compétent
Les contestations relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution. L’article R. 211-10 du CPCE précise que « les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. »
Ce juge dispose d’une compétence étendue. Selon l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, il connaît « de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. »
Attention, ce juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution hors des cas prévus par la loi.
Formes de la contestation
La contestation doit être formée par assignation (CPCE, art. R. 211-11). Plusieurs formalités doivent être respectées, sous peine d’irrecevabilité:
- L’assignation doit être signifiée dans le délai d’un mois
- Elle doit être dénoncée le même jour à l’huissier de justice par lettre recommandée avec AR
- Le tiers saisi doit être informé par lettre simple
- Une copie de l’assignation doit être remise au greffe au plus tard le jour de l’audience
Une jurisprudence de 1998 a précisé que la contestation est recevable dès lors que l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois, peu importe que son enrôlement intervienne après ce délai (Cass., avis, 15 juin 1998).
Effets de la contestation sur le paiement
La contestation a pour effet immédiat de différer le paiement. L’article L. 211-5 du CPCE est clair: « En cas de contestation devant le juge de l’exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. »
Pour les créances à exécution successive faisant l’objet d’une contestation, le tiers saisi doit consigner les sommes auprès d’un séquestre désigné par le juge (article R. 211-16 du CPCE).
Le juge peut toutefois autoriser un paiement partiel lorsque:
- La dette du tiers saisi n’est pas sérieusement contestable
- La créance du saisissant paraît fondée
- Dans ce cas, sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal (CPCE, art. R. 211-12)
4. Voies de recours
Appel des décisions du juge de l’exécution
Les décisions du juge de l’exécution sont susceptibles d’appel, sauf s’il s’agit de mesures d’administration judiciaire (article R. 121-19 du CPCE).
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision (article R. 121-20 du CPCE). L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à bref délai prévue à l’article 905 du Code de procédure civile.
L’appel n’est pas suspensif d’exécution, les décisions du juge étant exécutoires de plein droit par provision.
Sursis à exécution
Pour pallier l’absence d’effet suspensif de l’appel, la partie lésée peut demander un sursis à exécution au Premier président de la cour d’appel.
Selon l’article R. 121-22 du CPCE:
- Cette demande suspend les poursuites jusqu’à la décision du Premier président
- Le sursis n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation
- Une demande manifestement abusive peut être sanctionnée par une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros
La décision de refus du sursis permet la poursuite de l’exécution. À l’inverse, le sursis accordé empêche le paiement jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
Décision de la cour d’appel
Si la cour d’appel réforme la décision du juge de l’exécution, sa décision peut entraîner des restitutions.
Lorsque le tiers saisi a déjà payé le saisissant en vertu de la décision réformée, celui-ci devra rembourser. La Cour de cassation a précisé que « la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution » (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 98-12.734).
L’arrêt rendu par la cour d’appel est naturellement susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles de droit commun.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution: articles L. 111-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-5, R. 211-1 à R. 211-23
- Cass. ch. mixte, 22 nov. 2002, n° 99-13.935
- Cass. 2e civ., 18 févr. 1985, D. 1985, inf. rap. p. 319
- Cass., avis, 24 mai 1996, n° 09-60.004
- Cass. com., 19 janv. 1999, n° 96-18.256
- Cass., avis, 15 juin 1998
- Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 98-12.734
- Cour de cassation, Rapport annuel 2002, p. 337, 427 et 495
- Code de l’organisation judiciaire: article L. 213-6
- JurisClasseur Procédure civile, V° Saisie-attribution – Fasc. 10 et 1600-30