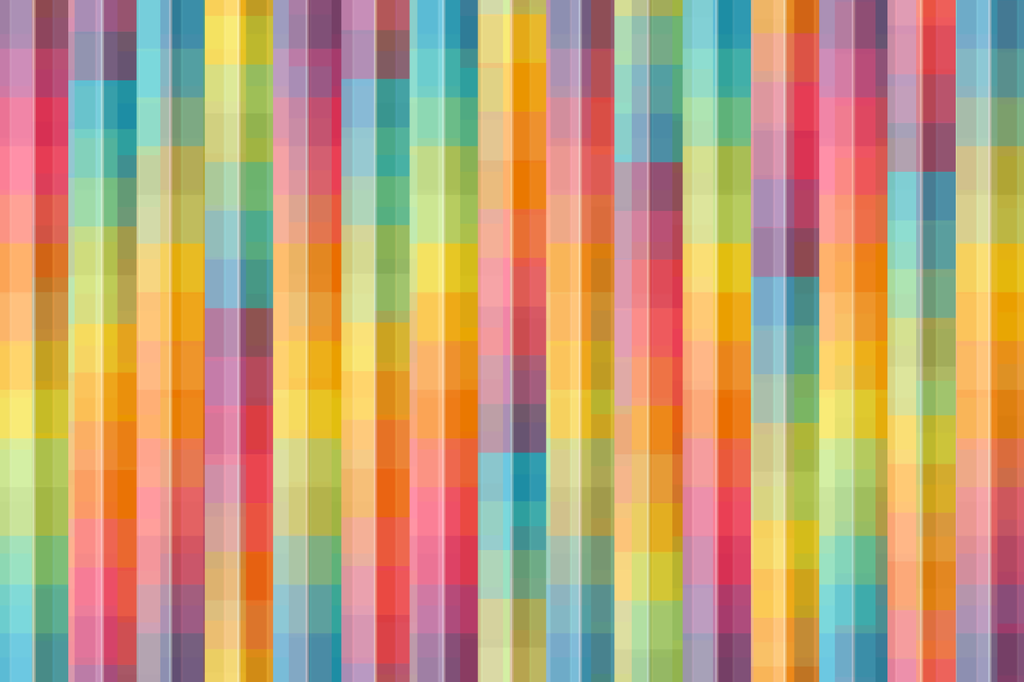Une fois qu’un élément est identifié comme un actif devant figurer au bilan de votre entreprise, une question essentielle se pose : pour quelle valeur ? Déterminer correctement la valeur d’entrée d’un actif n’est pas un simple exercice comptable. Cette valeur initiale, appelée coût historique, constitue la base sur laquelle seront calculés les amortissements futurs, les éventuelles dépréciations, et elle influence directement l’image du patrimoine de votre entreprise. Une erreur d’évaluation à l’entrée peut donc avoir des répercussions durables sur vos comptes annuels et votre fiscalité. Le Plan Comptable Général (PCG) encadre précisément les méthodes d’évaluation initiale. Cet article détaille comment déterminer ce coût d’entrée, que l’actif soit acheté, produit par l’entreprise, reçu gratuitement ou par échange, et aborde le traitement spécifique des coûts d’emprunt. Il est également crucial de prendre en compte les principes de l’amortissement des actifs, qui permettent d’étaler le coût d’un actif sur sa durée de vie utile. Une évaluation correcte dès l’acquisition garantit une répartition appropriée des charges, contribuant ainsi à une meilleure santé financière de l’entreprise. De plus, une compréhension claire de ces principes permet d’éviter les incohérences lors de la revalorisation ou de la cession des actifs à l’avenir. En parallèle, il est également crucial de bien comprendre la définition de la dépréciation des actifs, qui se réfère à la diminution de la valeur d’un actif au fil du temps en raison de l’usure, des obsolescences ou d’autres facteurs. Cette notion est essentielle pour garantir une évaluation précise des actifs, permettant aux entreprises de refléter fidèlement leur situation financière. En intégrant ces concepts dans leur stratégie comptable, les entreprises renforcent leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant la gestion de leurs ressources.
Le principe de base : l’évaluation au coût
La règle fondamentale posée par le PCG pour l’évaluation initiale des actifs est celle du coût historique. L’article 213-1 du PCG stipule que les actifs sont enregistrés dans les comptes pour leur coût au moment de leur entrée dans le patrimoine. Cependant, ce « coût » prend différentes formes selon la manière dont l’actif a été acquis.
Pour les actifs acquis à titre onéreux, c’est-à-dire achetés, la valeur d’entrée est leur coût d’acquisition. Nous détaillerons plus loin ce qui compose ce coût.
Pour les actifs produits par l’entreprise pour elle-même (une machine construite en interne, un logiciel développé…), la valeur d’entrée est leur coût de production. Là encore, les composantes de ce coût sont précisément définies.
Pour les actifs acquis à titre gratuit, sans contrepartie, leur valeur d’entrée est leur valeur vénale. La valeur vénale, définie à l’article 214-6 du PCG, correspond au montant qui pourrait être obtenu de la vente de cet actif sur un marché actif, dans des conditions normales, à la date d’entrée, net des coûts de sortie.
Enfin, pour les actifs acquis par voie d’échange contre d’autres actifs (non monétaires), la règle est aussi l’évaluation à la valeur vénale (celle de l’actif reçu ou, à défaut, celle de l’actif donné), sauf dans des cas spécifiques où l’échange manque de « substance commerciale » ou si la valeur vénale ne peut être déterminée de façon fiable.
Ce principe d’évaluation au coût historique est central en comptabilité française. Il vise à assurer une objectivité et une traçabilité de la valeur des actifs inscrits au bilan.
Décomposer le coût d’acquisition d’une immobilisation
Lorsqu’une entreprise achète une immobilisation (machine, bâtiment, véhicule…), son coût d’acquisition ne se limite pas au seul prix affiché sur la facture. L’article 213-8 du PCG précise les éléments qui doivent être inclus dans ce coût.
Le point de départ est bien sûr le prix d’achat, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus du fournisseur. Il faut y ajouter les droits de douane éventuels et les taxes non récupérables par l’entreprise (la TVA non déductible, par exemple).
À ce prix s’ajoutent tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction de l’entreprise. La liste peut être longue et dépend de la nature de l’actif. On y trouve typiquement :
- Les frais de livraison et de transport initiaux.
- Les frais d’installation et de montage.
- Les coûts de préparation du site (y compris d’éventuels frais de démolition préalables).
- Les coûts des essais nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de l’actif (déduction faite des éventuels revenus tirés de la vente des produits tests).
- Les honoraires de professionnels directement liés à l’acquisition ou à l’installation (architectes, géomètres, experts…).
Une particularité concerne les frais d’acquisition stricts comme les droits de mutation (pour un immeuble), les honoraires de notaire ou d’agence, et les frais d’actes. Pour les comptes individuels des entreprises françaises, le PCG offre une option : soit ces frais sont intégrés au coût d’acquisition de l’immobilisation (ce qui augmente sa valeur au bilan), soit ils sont comptabilisés directement en charges de l’exercice où ils sont engagés. Ce choix doit être exercé de manière cohérente. En revanche, dans les comptes consolidés (établis selon les normes françaises), ces frais doivent obligatoirement être inclus dans le coût de l’immobilisation.
Enfin, le coût d’acquisition doit également intégrer l’estimation initiale des coûts futurs de démantèlement, d’enlèvement de l’immobilisation et de restauration du site sur lequel elle se trouve, mais uniquement si l’entreprise a une obligation actuelle (légale ou contractuelle) de réaliser ces travaux à la fin de l’utilisation de l’actif. Ces coûts, bien que non encore décaissés, représentent la contrepartie d’une provision pour risques et charges inscrite au passif du bilan. Ils font l’objet d’un plan d’amortissement distinct en comptes individuels.
Il est tout aussi important de savoir quels coûts ne doivent pas être inclus dans le coût d’acquisition. Le PCG exclut les coûts qui ne sont pas directement nécessaires pour amener l’actif à son état de fonctionnement prévu. Par exemple : les coûts d’ouverture d’une nouvelle installation (frais administratifs généraux), les coûts de lancement d’un nouveau produit fabriqué avec la machine, les coûts de formation du personnel à l’utilisation de l’actif, ou les coûts de relocalisation de l’activité. Ces dépenses sont comptabilisées en charges.
L’activation des coûts, c’est-à-dire leur incorporation dans la valeur de l’immobilisation, cesse lorsque l’actif est en état de fonctionner comme prévu par la direction, même s’il n’est pas encore utilisé à pleine capacité ou s’il génère des pertes initiales (PCG, art. 213-12).
Calculer le coût de production d’une immobilisation
Lorsqu’une entreprise produit elle-même une immobilisation pour ses propres besoins, les principes de détermination du coût sont similaires à ceux d’une acquisition externe (PCG, art. 213-14). Le coût de production est la somme des coûts engagés pour créer cet actif.
Il comprend d’abord le coût d’acquisition des matières premières et fournitures consommées pour la fabrication de l’immobilisation.
Il inclut également les autres coûts engagés pendant les opérations de production. Ces coûts se divisent en :
- Charges directes de production : ce sont les coûts qui peuvent être directement affectés à la production de l’actif sans calcul intermédiaire. Pensez aux salaires et charges sociales du personnel ayant directement travaillé sur la fabrication de l’immobilisation, à l’énergie consommée spécifiquement par les machines utilisées pour cette production.
- Charges indirectes de production : ce sont les coûts qui ne peuvent pas être affectés directement mais qui sont nécessaires à la production. Ils doivent être raisonnablement rattachés à la production de l’actif. Il s’agit par exemple d’une quote-part des frais généraux de l’atelier de production (loyer, entretien, assurance), ou d’une quote-part de l’amortissement des machines utilisées pour fabriquer l’immobilisation (PCG, art. 213-17). L’affectation de ces charges indirectes doit se faire sur des bases rationnelles et cohérentes (par exemple, en fonction des heures de main-d’œuvre directe, des heures machine…).
Attention cependant, la quote-part des charges fixes correspondant à une sous-activité (c’est-à-dire lorsque l’usine tourne en dessous de sa capacité normale) ne doit pas être incorporée au coût de production de l’immobilisation (PCG, art. 213-18). Elle reste une charge de l’exercice. Seuls les coûts correspondant à une activité normale sont activables.
Le traitement comptable des coûts d’emprunt
Financer l’acquisition ou la production d’une immobilisation importante nécessite souvent de recourir à l’emprunt, ce qui génère des coûts financiers (intérêts…). Le PCG (art. 213-9) offre une option pour le traitement de ces coûts d’emprunt lorsqu’ils financent un actif éligible. Un actif éligible est défini comme un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu (par exemple, la construction d’un immeuble, la fabrication d’une machine complexe).
Pour ces actifs éligibles, l’entreprise peut choisir :
- Soit de comptabiliser tous les coûts d’emprunt en charges financières de l’exercice au cours duquel ils sont encourus. C’est l’approche la plus simple.
- Soit d’incorporer les coûts d’emprunt directement attribuables à l’actif éligible dans son coût d’entrée. Cette incorporation n’est possible que pendant la période d’acquisition ou de production de l’actif, jusqu’à ce qu’il soit prêt à être utilisé.
Les coûts d’emprunt concernés peuvent être les intérêts des emprunts spécifiques ou généraux, l’amortissement des frais d’émission d’emprunt, ou encore les charges financières de location-financement (dans les comptes consolidés).
Si l’entreprise opte pour l’incorporation, le montant à activer doit être calculé précisément. S’il s’agit d’un emprunt spécifiquement contracté pour l’actif, on active les intérêts réels de cet emprunt (diminués des éventuels produits financiers issus du placement temporaire des fonds). Si l’entreprise utilise des fonds provenant d’emprunts généraux, elle doit appliquer un taux de capitalisation (moyenne pondérée des taux de ses emprunts en cours) aux dépenses engagées pour l’actif. Le montant des coûts d’emprunt activé au cours d’un exercice ne peut jamais dépasser le montant total des coûts d’emprunt supportés par l’entreprise durant ce même exercice.
Le choix entre la comptabilisation en charges et l’incorporation au coût de l’actif doit être appliqué de manière cohérente à tous les actifs éligibles de l’entreprise et doit être mentionné dans l’annexe aux comptes annuels.
Gérer les cas d’acquisition particuliers
L’évaluation initiale peut présenter quelques spécificités selon les circonstances de l’acquisition.
En cas d’échange d’une immobilisation contre une autre immobilisation non monétaire, la règle générale est d’évaluer l’actif reçu à sa valeur vénale (PCG, art. 213-3). Toutefois, si l’échange n’a pas de « substance commerciale » (c’est-à-dire s’il ne modifie pas significativement les flux de trésorerie futurs attendus) ou si la valeur vénale ne peut être déterminée de façon fiable, alors l’actif reçu est évalué à la valeur comptable nette de l’actif donné en échange. Une soulte (somme d’argent) versée ou reçue ajuste ces valeurs.
Pour les biens acquis à titre gratuit, comme nous l’avons vu, l’évaluation se fait à la valeur vénale (PCG, art. 213-4). La contrepartie est généralement enregistrée en produits exceptionnels.
Si un bien est acquis ou produit grâce à une subvention d’investissement, cette subvention n’a aucune incidence sur le calcul du coût d’entrée de l’actif financé (PCG, art. 213-6). L’actif est comptabilisé pour son coût total (acquisition ou production), et la subvention suit son propre traitement comptable (généralement étalée en produits sur la durée d’amortissement de l’actif financé).
Enfin, pour les actifs acquis en monnaie étrangère, leur coût d’entrée doit être converti en euros en utilisant le taux de change en vigueur à la date de l’opération (date d’entrée de l’actif). Si une couverture de change a été mise en place spécifiquement pour cette acquisition avant l’opération, c’est le taux de cette couverture qui peut être utilisé (PCG, art. 420-1). Cette valeur en euros servira de base aux calculs ultérieurs d’amortissement et de dépréciation.
Évaluation initiale spécifique des stocks
Les principes généraux d’évaluation au coût s’appliquent aussi aux stocks, mais avec des modalités adaptées à leur nature.
Le coût d’acquisition des stocks (marchandises, matières premières) comprend le prix d’achat (net de remises/rabais/escomptes et taxes récupérables) ainsi que les frais accessoires nécessaires pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent (transport, manutention, assurances…). C’est ce qu’indique l’article 321-20 du PCG.
Le coût de production des stocks (produits finis, en-cours) inclut les coûts directs (matières consommées, main d’œuvre directe) et une quote-part des frais indirects de production (fixes et variables), calculée sur la base d’une activité normale de l’outil de production (PCG, art. 213-32). Sont exclus les coûts anormaux (gaspillages), les frais de stockage non nécessaires au processus de production, les frais administratifs généraux et les frais de commercialisation. Ces aspects seront développés plus en détail dans un article dédié aux stocks.
Calculer précisément le coût d’entrée de vos actifs est une étape déterminante. Une erreur peut fausser durablement vos comptes. Pour une évaluation conforme et optimisée, notre cabinet est à votre service. Il est essentiel de se baser sur des méthodes rigoureuses et de respecter les principes de l’amortissement comptable pour une gestion financière saine. Cela permettra non seulement de refléter fidèlement la valeur de vos actifs, mais aussi d’optimiser vos résultats fiscaux. Une bonne maîtrise de ces enjeux contribuera également à la pérennité de votre entreprise.
Sources
- Plan Comptable Général (tel qu’issu notamment du Règlement ANC n° 2014-03 et ses mises à jour ultérieures), Articles 213-1, 213-3, 213-4, 213-6, 213-8, 213-9, 213-12, 213-14, 213-17, 213-18, 214-6, 321-20, 213-32, 420-1, 831-2.