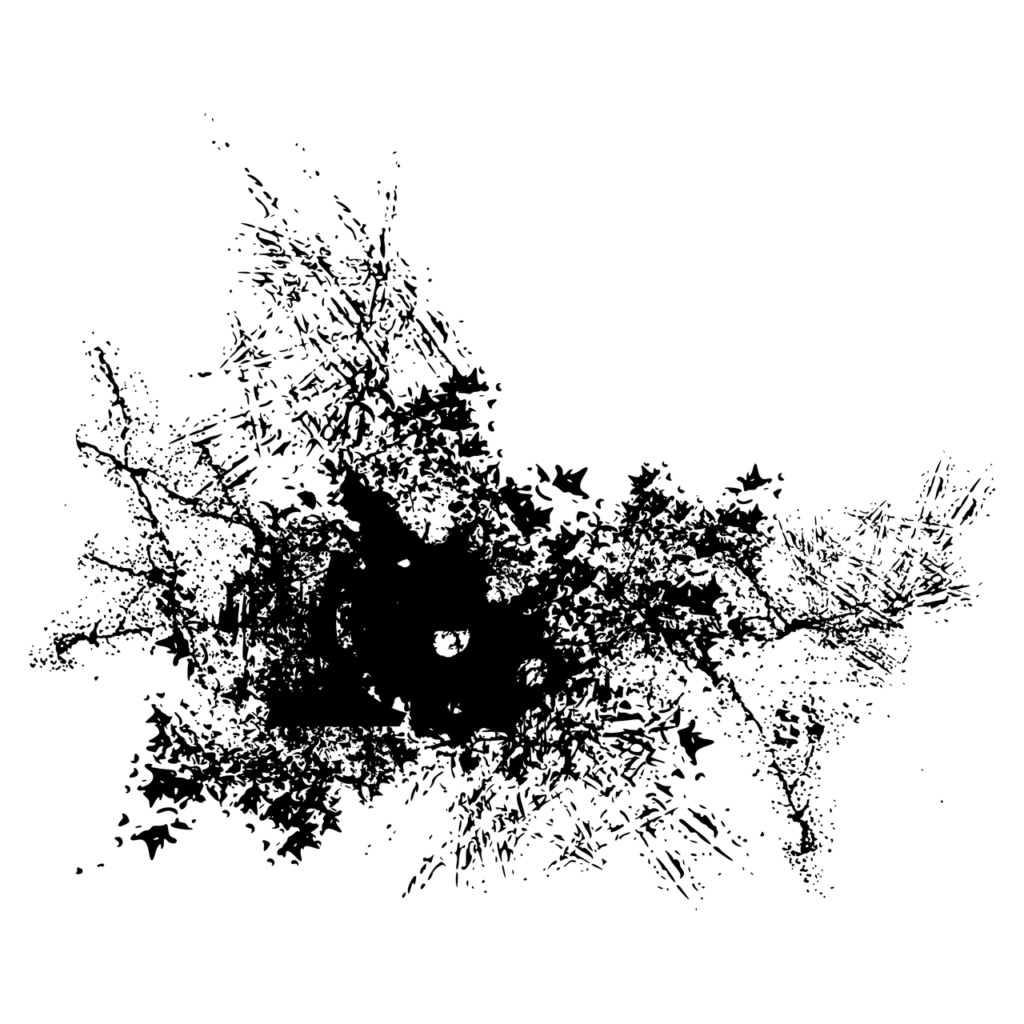La facture. Ce document, souvent perçu comme une simple formalité administrative, est en réalité bien plus que cela. C’est une pièce maîtresse de vos relations commerciales, un élément de preuve essentiel et un outil indispensable à la bonne gestion de votre trésorerie. Une facturation imprécise ou des délais de paiement mal maîtrisés peuvent rapidement entraîner des difficultés financières, des litiges coûteux et même des sanctions. Dans le monde des affaires, la clarté et la rigueur sur ces aspects ne sont pas une option, mais une nécessité.
Notre cabinet observe régulièrement des situations où des erreurs ou des oublis en matière de facturation ou de délais de paiement créent des complications évitables pour les entreprises. Cet article a pour but de vous éclairer sur les obligations légales fondamentales que vous devez connaître et respecter, que vous soyez vendeur ou acheteur dans un cadre professionnel. Nous aborderons les mentions qui doivent impérativement figurer sur vos factures, les règles encadrant leur transmission et leur conservation, et le cadre légal, parfois complexe, des délais de paiement interentreprises.
Que doit absolument contenir votre facture ?
Loin d’être un document à contenu libre, la facture B2B (entre professionnels) est strictement réglementée par le Code de commerce, notamment son article L.441-9. Chaque mention a son importance pour garantir la transparence et prévenir les litiges.
Le prix et les réductions : la base de la transaction
Le cœur de la facture réside bien sûr dans l’information tarifaire. Elle doit être précise et sans ambiguïté. Vous devez indiquer le prix unitaire hors TVA de chaque produit vendu ou service rendu. La mention de la TVA n’est pas exigée par les règles de concurrence (mais l’est par les règles fiscales, bien entendu). Si le prix est indiqué sans mention « HT » ou « TTC », la jurisprudence considère généralement qu’il s’entend hors taxe en cas de silence du contrat.
Les réductions de prix (rabais, remises) doivent aussi être mentionnées, mais attention : seules celles qui sont acquises au moment de la vente ou de la prestation et directement liées à cette opération spécifiques doivent figurer sur la facture initiale, comme le demande l’article L.441-9 du Code de commerce. Pensez par exemple à une remise immédiate sur quantité. En revanche, les ristournes de fin d’année conditionnées à un volume d’achat annuel, ou les escomptes pour paiement anticipé qui ne sont pas encore décidés ou prévus explicitement sur la facture, n’ont pas à y figurer initialement. Ils feront l’objet d’avoirs ou de notes de crédit ultérieures si les conditions sont remplies.
L’objectif est d’éviter que des avantages conditionnels ou non directement liés à la transaction immédiate ne viennent fausser la base de calcul, notamment pour le seuil de revente à perte (un sujet que nous aborderons dans un autre article).
Les conditions de règlement : anticiper le paiement
Pour éviter les malentendus et fluidifier les encaissements, la facture doit comporter des informations claires sur le paiement, toujours selon l’article L.441-9 du Code de commerce :
- La date exacte à laquelle le règlement doit intervenir. Indiquer un délai (« paiement à 30 jours ») n’est généralement pas suffisant ; une date précise (jour, mois, année) est requise.
- Les conditions d’escompte applicables si votre client paie avant la date limite prévue. Même si vous n’offrez pas d’escompte, il est recommandé de le mentionner (par exemple, « Escompte pour paiement anticipé : néant »).
- Le taux des pénalités de retard exigibles dès le lendemain de la date limite de paiement indiquée. Ce taux ne peut être inférieur à un plancher légal (actuellement trois fois le taux d’intérêt légal) et est, sauf accord contraire, basé sur le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. Ces pénalités sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, comme le précise l’article L.441-10 du Code de commerce.
- Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée actuellement à 40 euros par l’article D.441-5 du Code de commerce. Cette indemnité est due en plus des pénalités de retard pour chaque facture payée en retard.
Les autres informations indispensables
Au-delà du prix et des conditions de paiement, d’autres mentions sont obligatoires pour assurer l’identification claire de la transaction et des parties, toujours d’après l’article L.441-9 du Code de commerce :
- Le nom et l’adresse des parties (vendeur et acheteur). L’adresse du siège social est la référence, mais l’adresse d’un établissement secondaire peut être tolérée si c’est le lieu de la relation commerciale et du paiement.
- L’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse principale des parties. Cet ajout récent vise à faciliter l’acheminement direct de la facture au service comptable compétent.
- La date de la vente ou de la réalisation de la prestation de services.
- La quantité et la dénomination précise des produits vendus ou des services rendus. Une désignation vague (« Divers ») est insuffisante ; il faut permettre une identification claire de ce qui a été fourni, incluant potentiellement la marque ou des caractéristiques spécifiques si nécessaire.
- Le numéro du bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur. Cela facilite le rapprochement entre la commande et la facture.
Ces mentions forment un ensemble cohérent visant la transparence et la traçabilité des échanges commerciaux.
Délivrance, conservation, communication : les aspects pratiques
Établir une facture conforme est une chose, la gérer correctement en est une autre. La loi encadre également la manière dont elle circule et est conservée.
Quand et comment transmettre la facture ?
Le principe est simple : la facture doit être délivrée par le vendeur dès la réalisation de la livraison des biens ou l’achèvement de la prestation de services, comme l’exige l’article L.441-9 du Code de commerce. Il ne faut pas attendre que le client la réclame.
La transmission peut se faire classiquement sur papier (en double exemplaire, un pour chaque partie). Mais la facturation électronique est aujourd’hui largement admise et encouragée, sous réserve de respecter certaines conditions garantissant l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture (conformément à l’article 289 du Code général des impôts). La transmission par fax peut aussi être envisagée, bien que moins sécurisée.
Quelques assouplissements existent :
- Un léger différé de facturation de quelques jours peut être toléré pour des raisons de gestion administrative.
- Pour des livraisons ou prestations multiples et régulières à un même client au cours d’un même mois civil, une facture périodique (ou récapitulative) peut être établie, regroupant ces opérations. Elle doit être émise au plus tard à la fin de ce mois, comme le permet l’article 289 du Code général des impôts.
Qui est concerné par ces règles ?
L’obligation de facturation s’applique très largement à « tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle » selon les termes de l’article L.441-9 du Code de commerce. Cela concerne donc :
- Les producteurs, les industriels, les commerçants (grossistes, détaillants).
- Les prestataires de services, y compris les professions libérales réalisant des prestations pour des professionnels.
- Les artisans.
- Les agriculteurs dans leurs relations professionnelles.
- Même les personnes publiques (État, collectivités, établissements publics) lorsqu’elles exercent des activités de production, de distribution ou de services, en vertu de l’article L.410-1 du Code de commerce.
Quelques exceptions ou spécificités existent :
- Les particuliers ne sont pas soumis à l’obligation d’émettre une facture lorsqu’ils vendent occasionnellement à un professionnel (sauf si les ventes deviennent habituelles ou significatives). Inversement, un professionnel vendant à un particulier n’est généralement pas tenu d’émettre une facture au sens du Code de commerce (mais souvent une note ou un ticket de caisse selon d’autres réglementations).
- Les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui (mandataires, courtiers pour la vente elle-même) ne facturent pas la vente principale mais leur propre commission.
- Pour les transactions internationales (exportations), l’administration admet une certaine souplesse par rapport aux règles françaises strictes, pour ne pas pénaliser les entreprises françaises. En revanche, un importateur français doit s’assurer de recevoir une facture conforme ou comportant les éléments essentiels requis en France.
Combien de temps conserver vos factures ?
La facture est un document comptable et une preuve juridique. Sa conservation est donc obligatoire. L’article L.441-9 du Code de commerce renvoie aux délais prévus par le Code général des impôts. En pratique, cela signifie qu’il faut conserver les factures (clients et fournisseurs) pendant une durée de six ans d’un point de vue fiscal (délai de reprise de l’administration, régi par le Livre des procédures fiscales).
D’un point de vue commercial, le Code de commerce (article L.123-22) impose la conservation des documents comptables et pièces justificatives pendant dix ans à compter de la clôture de l’exercice. Il est donc prudent de retenir ce délai de dix ans pour archiver vos factures, qu’elles soient sous forme papier ou électronique (dans des conditions garantissant leur intégrité et leur lisibilité).
Délais de paiement : un cadre légal strict
Le crédit interentreprises est une composante majeure de l’économie, mais des délais de paiement excessivement longs peuvent fragiliser, voire asphyxier, les entreprises créancières. C’est pourquoi la loi encadre strictement les délais de règlement.
Le délai supplétif et les plafonds légaux
Que se passe-t-il si vous n’avez rien prévu de spécifique avec votre partenaire commercial ? La loi, via l’article L.441-10 du Code de commerce, fixe un délai supplétif : le paiement doit intervenir au plus tard le 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Les parties peuvent cependant convenir d’un délai différent, mais sans pouvoir dépasser certains plafonds légaux impératifs définis au même article L.441-10 :
- Le délai convenu ne peut jamais dépasser 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.
- Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu. Ce délai doit être expressément stipulé au contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste envers le créancier (ce qui serait le cas, par exemple, s’il était imposé sans justification par un client puissant à un petit fournisseur).
Il est donc interdit de prévoir contractuellement des délais de paiement de 90 jours ou plus, pratique qui était courante par le passé. De même, toute clause ou pratique visant à retarder artificiellement le point de départ du délai (par exemple, en liant le départ du délai à une validation interne excessivement longue) est prohibée et sanctionnable au titre de l’article L.441-16 du Code de commerce.
Des règles spécifiques pour certains secteurs
Pour tenir compte des spécificités de certaines filières, l’article L.441-11 du Code de commerce prévoit des délais de paiement maximaux plus courts. C’est notamment le cas pour :
- Les produits agricoles et alimentaires périssables, ainsi que les viandes congelées/surgelées et poissons surgelés : 30 jours après la fin de la décade de livraison (ou après la date de livraison selon les cas).
- Le bétail sur pied destiné à la consommation et les viandes fraîches dérivées : 20 jours après le jour de livraison.
- Certaines boissons alcooliques (spiritueux notamment) : 30 jours après la fin du mois de livraison.
- Le transport routier de marchandises, la location de véhicules, la commission de transport : 30 jours après la date d’émission de la facture.
- D’autres secteurs comme l’agroéquipement, les articles de sport d’hiver, le cuir, l’horlogerie-bijouterie, ou le jouet bénéficient également de règles spécifiques.
Ces délais spécifiques priment sur les délais généraux de 60 jours / 45 jours fin de mois.
L’impact des procédures de vérification/acceptation
Certains contrats prévoient une procédure pour vérifier la conformité des marchandises livrées ou des services rendus avant de déclencher le paiement. La loi (article L.441-10 du Code de commerce) encadre cette pratique : la durée de cette procédure doit être raisonnable (fixée selon les usages, sans excéder 30 jours par défaut) et ne doit normalement pas servir à décaler le point de départ ou à augmenter la durée du délai de paiement maximal légal, sauf accord contractuel spécifique non abusif.
Qui est responsable et quelles sont les sanctions ?
Le respect des règles de facturation et de délais de paiement n’est pas une simple recommandation. Des sanctions administratives existent, et la responsabilité peut être partagée.
Facturation incorrecte : une responsabilité partagée
La loi, en application de l’article L.441-9 du Code de commerce, est claire : l’obligation d’établir une facture conforme incombe au vendeur ou au prestataire de services. Mais l’acheteur professionnel a également l’obligation de la réclamer si elle n’est pas délivrée spontanément et de s’assurer qu’elle comporte les mentions obligatoires.
En cas de contrôle par l’administration (notamment la DGCCRF – Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), les deux parties peuvent donc voir leur responsabilité engagée si la facture est manquante ou non conforme. Imaginez le casse-tête si vous découvrez tardivement que vos factures fournisseurs ne sont pas conformes lors d’un contrôle fiscal ou commercial…
Sanctions administratives en cas de manquement
Les manquements aux règles de facturation et de délais de paiement relèvent principalement de sanctions administratives prononcées par la DGCCRF :
- Pour les infractions aux règles de facturation (mentions manquantes, défaut de délivrance…), l’amende administrative peut atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, en vertu de l’article L.441-9 du Code de commerce. Ces montants sont doublés en cas de réitération dans les deux ans.
- Pour le non-respect des délais de paiement légaux (dépassement des plafonds), les sanctions sont nettement plus lourdes : l’article L.441-16 du Code de commerce prévoit une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale. Là encore, les montants sont doublés en cas de réitération.
De plus, l’administration a la possibilité d’ordonner la publication de la décision de sanction aux frais de l’entreprise sanctionnée, sur son propre site internet mais aussi dans la presse (article L.470-2 du Code de commerce). Cette pratique du « Name and Shame » peut avoir un impact réputationnel significatif.
La complexité des règles de facturation et de délais de paiement, ainsi que la sévérité des sanctions encourues, nécessitent une vigilance constante et une bonne organisation interne. Pour vous assurer de la conformité de vos pratiques, revoir vos modèles de factures, ou encore sécuriser vos conditions de paiement dans vos contrats, notre cabinet peut auditer vos processus et documents.
Un conseil adapté à votre situation pourrait vous faire économiser temps et ressources. Contactez-nous pour en savoir plus.
Sources
- Code de commerce
- Code général des impôts
- Livre des procédures fiscales