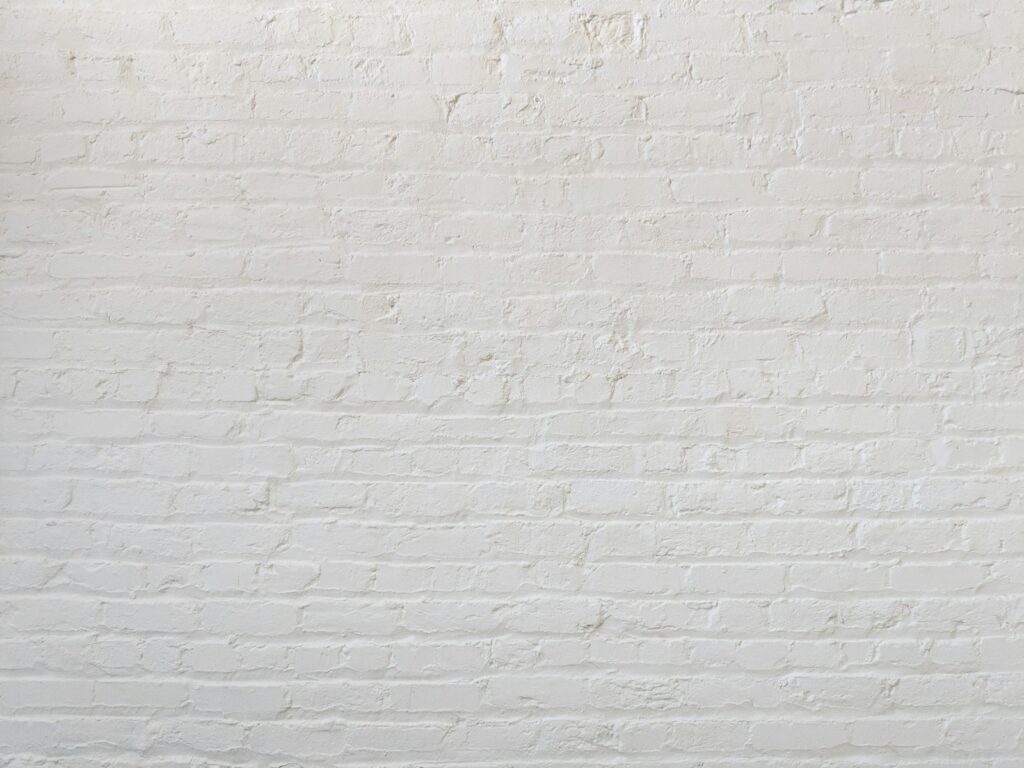La fiscalité des bons de caisse a connu une simplification bienvenue, unifiant le traitement des intérêts perçus, qualifiés de revenus de créances. Pour les épargnants, cette clarification est essentielle afin de mesurer le rendement net de leur placement. Longtemps complexe, le régime a été harmonisé, mais il convient de bien en comprendre les mécanismes pour éviter toute mauvaise surprise. Pour une vision d’ensemble de cet instrument financier, vous pouvez consulter notre guide complet sur les bons de caisse.
L’imposition des produits des bons de caisse : revenus de créance
Pour les personnes physiques domiciliées en France, les intérêts générés par les bons de caisse sont traités comme des revenus de capitaux mobiliers. Depuis les réformes successives, le régime par défaut est celui du prélèvement forfaitaire unique (PFU), mais une option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu reste possible.
Le principe du barème progressif de l’impôt sur le revenu
Initialement, la loi de finances rectificative pour 2012 a supprimé le prélèvement forfaitaire libératoire, rendant les produits des bons nominatifs imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce principe demeure, mais il est désormais optionnel. Le contribuable peut choisir, lors de sa déclaration annuelle de revenus, de soumettre l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers et plus-values au barème progressif. Cette option est globale et irrévocable pour l’année concernée. Elle peut s’avérer avantageuse pour les contribuables dont le taux marginal d’imposition est inférieur au taux du PFU, notamment ceux qui ne sont pas imposables.
Les prélèvements sociaux et l’acompte non libératoire
Indépendamment du choix fiscal, les intérêts des bons de caisse subissent des prélèvements à la source. Au moment de leur versement, l’établissement payeur applique deux retenues distinctes :
- Les prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %.
- Un acompte d’impôt sur le revenu de 12,8 %, qui correspond au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax ».
Cet acompte de 12,8 % n’est pas libératoire de l’impôt. Il vient s’imputer sur le montant total de l’impôt sur le revenu dû l’année suivante. Si le montant de l’acompte prélevé excède l’impôt final, l’excédent est restitué au contribuable. Les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain seuil peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement à la source.
Les cas de prélèvements forfaitaires majorés
Dans certaines situations spécifiques, la fiscalité des bons de caisse se durcit considérablement. Le législateur a prévu des régimes de taxation forfaitaire à des taux fortement majorés pour sanctionner le manque de transparence et lutter contre l’évasion fiscale.
Paiement dans un État non coopératif
Lorsque les produits des bons de caisse sont versés sur un compte situé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif (ETNC) par la France, un prélèvement forfaitaire majoré s’applique. Ce taux dissuasif, actuellement fixé à 75 %, vise à décourager les flux financiers vers des juridictions opaques. Il s’applique que le bénéficiaire soit une personne physique ou morale et a un caractère libératoire, ce qui signifie qu’il éteint définitivement la dette fiscale sur ces revenus.
Le bénéficiaire anonyme : un régime dissuasif
Bien que l’ordonnance du 28 avril 2016 ait supprimé la possibilité d’émettre des bons de caisse anonymes, les titres émis antérieurement et toujours en circulation peuvent conserver cette caractéristique. Pour ces bons, un régime fiscal particulièrement pénalisant est maintenu. En cas de paiement à un bénéficiaire qui choisit de conserver l’anonymat, un prélèvement spécial est perçu. Ce prélèvement inclut non seulement une taxation très élevée des intérêts, mais également une taxation du capital lui-même. Le but est clairement d’inciter les détenteurs à lever l’anonymat pour se conformer aux exigences de transparence fiscale.
La fiscalité des plus-values de cession des bons de caisse
Outre les intérêts perçus à l’échéance, les bons de caisse peuvent être cédés avant leur terme. Les gains réalisés à cette occasion, qualifiés de plus-values, sont également soumis à l’impôt.
Calcul de la base imposable
La plus-value de cession est déterminée par la différence entre le prix de vente du bon, net des frais et taxes supportés par le vendeur, et son prix d’acquisition. Cette plus-value est soumise au même régime que les intérêts : par défaut, le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (auquel s’ajoutent les 17,2 % de prélèvements sociaux), ou, sur option globale, le barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’imposition a lieu au titre de l’année de la cession du titre.
Imputation des moins-values
Si la cession d’un bon de caisse génère une perte, cette moins-value n’est pas perdue. Elle peut être imputée exclusivement sur des plus-values de même nature, c’est-à-dire sur des gains provenant de la cession d’autres bons ou titres dont les produits relèvent du même régime d’imposition. Cette imputation peut être réalisée sur les plus-values de l’année de la cession, et le solde éventuel peut être reporté sur les cinq années suivantes. Cette règle permet de lisser la charge fiscale en ne taxant que le gain net global réalisé sur un portefeuille de placements similaires.
La retenue à la source spécifique
Un mécanisme particulier de retenue à la source, prévu par l’article 1678 bis du Code général des impôts, s’applique aux produits des bons de caisse dans certaines situations, principalement lorsqu’ils bénéficient à des non-résidents ou à des personnes morales.
Champ d’application et taux
Cette retenue à la source s’applique aux intérêts des bons de caisse qui profitent à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France ou à des entités dont le siège est situé en France ou à l’étranger. Pour les personnes physiques domiciliées en France, cette retenue a été supprimée. Le taux de ce prélèvement est fixé à 15 %. Il est opéré par l’établissement payeur pour le compte du Trésor public. Pour les bénéficiaires non-résidents, cette retenue peut, selon les conventions fiscales internationales, ouvrir droit à un crédit d’impôt dans leur pays de résidence pour éviter une double imposition.
Personnes morales et impôt sur les sociétés
Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés qui perçoivent des produits de bons de caisse entrent également dans le champ d’application de cette retenue à la source. Pour elles, cette retenue n’est pas libératoire de l’impôt sur les sociétés. Elle constitue un acompte qui viendra s’imputer sur le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les produits ont été perçus. L’excédent éventuel est restituable.
La fiscalité des bons de caisse, bien que simplifiée, comporte des subtilités qu’il est indispensable de maîtriser pour optimiser ses placements. Le choix entre le prélèvement forfaitaire unique et l’option pour le barème progressif, la gestion des plus et moins-values, ainsi que les règles spécifiques aux non-résidents ou aux situations d’anonymat, sont autant de paramètres à considérer. Un conseil avisé permet de naviguer au mieux dans ce cadre réglementaire. Pour toute question relative à la fiscalité de vos placements ou pour une assistance personnalisée, notre cabinet d’avocats, compétent en droit bancaire et financier, se tient à votre disposition. Contactez un Avocat en droit bancaire et financier de notre équipe pour une analyse de votre situation.
Sources
- Code général des impôts, article 1678 bis
- Code monétaire et financier