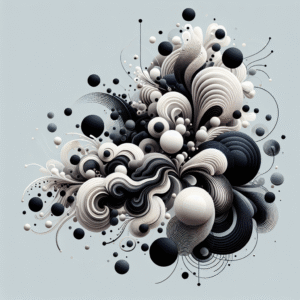Le contrat de franchise est une architecture contractuelle complexe, au carrefour du droit de la distribution et du droit de la concurrence. Pour les entreprises, il représente un formidable levier de développement, mais sa mise en œuvre expose à des risques juridiques importants s’il n’est pas correctement maîtrisé. La question centrale est de savoir comment concilier les restrictions nécessaires au bon fonctionnement du réseau avec la prohibition des ententes anticoncurrentielles. Notre cabinet, compétent pour vous conseiller sur vos contrats de franchise, observe que de nombreux litiges naissent d’une mauvaise appréciation de cet équilibre. Avant d’explorer la jurisprudence, il est essentiel de rappeler que la franchise est une forme d’accord vertical, dont le guide complet permet de saisir les enjeux généraux. Cet article se concentre spécifiquement sur la manière dont les autorités et les tribunaux analysent ces accords. Pour une vision d’ensemble, comprendre la nature et le fonctionnement du contrat de franchise est un prérequis indispensable.
La reconnaissance et l’encadrement de la franchise en droit de la concurrence
Le droit de la concurrence porte, par nature, un regard méfiant sur les accords entre entreprises qui restreignent leur liberté commerciale. Pourtant, la franchise, qui repose sur de telles restrictions, a trouvé sa place. Cette reconnaissance est le fruit d’une analyse économique pragmatique, considérant que les effets positifs du modèle peuvent l’emporter sur ses aspects restrictifs.
L’approche favorable de la Cour de Justice (Pronuptia)
L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 janvier 1986, Pronuptia de Paris, est la pierre angulaire de l’analyse concurrentielle du contrat de franchise. Avant cette décision, l’incertitude était grande. La Cour a opéré une distinction fondamentale qui structure encore aujourd’hui le raisonnement juridique. Elle a jugé que la franchise est en soi un modèle pro-concurrentiel : elle permet à un franchiseur de créer un réseau sans avoir à investir dans chaque point de vente, et à des entrepreneurs indépendants d’accéder à un marché avec le soutien d’une marque et d’un savoir-faire éprouvés.
Partant de ce constat, la Cour a établi un principe directeur : les clauses indispensables à l’existence même de ce système ne tombent pas sous le coup de l’interdiction des ententes (aujourd’hui l’article 101, paragraphe 1, du TFUE). Autrement dit, pour que la franchise fonctionne, certaines restrictions sont non seulement utiles, mais nécessaires. Il s’agit des clauses qui visent deux objectifs légitimes : préserver l’identité et la réputation du réseau, et protéger le savoir-faire transmis par le franchiseur.
Les clauses non restrictives de concurrence
En application du raisonnement de l’arrêt Pronuptia, une série de clauses sont considérées comme inhérentes au contrat de franchise et donc, par principe, licites. Elles ne constituent pas le cœur du problème concurrentiel, mais définissent le cadre de la collaboration. On y trouve notamment :
- L’obligation pour le franchisé d’appliquer les méthodes commerciales définies par le franchiseur.
- L’obligation d’utiliser la marque, l’enseigne et l’identité visuelle du réseau.
- Le droit pour le franchiseur d’adapter le savoir-faire et les méthodes commerciales en fonction des évolutions du marché.
- L’obligation pour le franchisé de préserver l’image de marque du réseau.
Ces stipulations sont vues comme l’essence même de la réplication d’un succès commercial, qui est le but du modèle de franchise.
La protection de l’identité et de la réputation du réseau
Pour qu’un réseau de franchise soit performant et reconnaissable par les consommateurs, il doit présenter une certaine homogénéité. Cette uniformité justifie des clauses qui, dans un autre contexte, pourraient être jugées problématiques. Les tribunaux admettent leur validité tant qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Clauses de localisation du franchisé
Le franchiseur peut imposer au franchisé d’exercer son activité depuis un local agréé et exclusivement depuis celui-ci. Cette clause est licite. Elle permet au franchiseur de maîtriser le maillage territorial de son réseau et de s’assurer que les points de vente respectent les standards de la marque. Il ne s’agit pas d’une protection territoriale absolue (qui est interdite), mais d’une simple délimitation du lieu d’exploitation contractuel. Le franchisé ne peut donc pas, de sa propre initiative, déplacer son magasin ou en ouvrir un second sans l’accord du franchiseur.
L’obligation d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif (justifications et limites)
C’est l’une des clauses les plus sensibles. Le franchiseur peut exiger que le franchisé s’approvisionne exclusivement ou très majoritairement auprès de lui ou de fournisseurs qu’il a référencés. La justification est double : garantir la qualité et l’uniformité des produits ou services vendus sous l’enseigne, et protéger le savoir-faire (par exemple, si les produits intègrent une technologie ou une recette secrète). Toutefois, cette clause a des limites strictes. Elle n’est valable que si elle est indispensable pour maintenir l’identité et la réputation du réseau. Si les mêmes objectifs de qualité peuvent être atteints par la simple définition de spécifications techniques objectives que le franchisé pourrait faire respecter par des fournisseurs de son choix, alors l’exclusivité peut être jugée disproportionnée et anticoncurrentielle.
L’étanchéité des réseaux de franchise
Le franchiseur peut interdire au franchisé de vendre les produits contractuels à des revendeurs non agréés, situés en dehors du réseau. Cette clause vise à garantir que la distribution des produits reste au sein du système de franchise sélective mis en place. Elle est essentielle pour protéger l’intégrité du réseau et éviter que les produits ne se retrouvent sur des marchés parallèles, ce qui nuirait à l’image de marque et à la cohérence de la stratégie commerciale. Cette interdiction est donc généralement admise par la jurisprudence.
La sélection des franchisés et les critères (qualitatifs et quantitatifs)
Un franchiseur est libre de choisir ses franchisés. Il peut mettre en place un processus de sélection fondé sur des critères objectifs. Ces critères peuvent être qualitatifs (expérience professionnelle, compétences techniques, aptitude à gérer une entreprise) ou quantitatifs (capacité financière, taille minimale du local). Cette sélection est la base d’un réseau de distribution sélective. Tant que les critères sont appliqués de manière non discriminatoire à tous les candidats, le refus d’agréer un candidat ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle. C’est une prérogative nécessaire pour assurer l’homogénéité et la compétence du réseau.
La protection du savoir-faire transmis
Le deuxième pilier de la justification des restrictions en franchise est la protection du savoir-faire. Le franchiseur transmet un ensemble d’informations secrètes, substantielles et identifiées qui confèrent au franchisé un avantage concurrentiel. Pour que ce transfert ait un sens, le franchiseur doit pouvoir se prémunir contre la dissipation de cet actif immatériel.
Les clauses de non-concurrence pendant et après contrat (durée, territorialité)
La clause de non-concurrence est un mécanisme de protection fondamental. Sa validité est appréciée différemment selon qu’elle s’applique pendant ou après le contrat.
Pendant toute la durée du contrat de franchise, l’interdiction faite au franchisé d’exercer une activité concurrente est presque toujours considérée comme valable. Elle est vue comme une simple expression de l’obligation de loyauté et de concentration des efforts sur l’exploitation de la franchise.
Après la fin du contrat, la situation est plus complexe. Une clause de non-concurrence post-contractuelle n’est licite que si elle respecte des conditions cumulatives strictes :
- Elle doit être indispensable à la protection du savoir-faire transmis.
- Elle doit être limitée dans le temps (généralement un an maximum).
- Elle doit être limitée dans l’espace (souvent au territoire où le franchisé exerçait son activité).
- Elle doit être proportionnée à l’objet du contrat.
Ces obligations post-contractuelles représentent un enjeu majeur lors de la cessation du contrat de franchise et doivent être rédigées avec une précision extrême.
Les clauses de confidentialité et non-divulgation
Corollaire indispensable de la transmission de savoir-faire, la clause de confidentialité interdit au franchisé de divulguer à des tiers les informations confidentielles reçues. Cette obligation est valable pendant toute la durée du contrat et subsiste après sa terminaison, sans limitation de temps. Elle est universellement admise comme étant essentielle et sa violation peut entraîner la résiliation du contrat aux torts du franchisé ainsi que des poursuites en dommages et intérêts.
L’agrément du cessionnaire du magasin
Lorsqu’un franchisé souhaite vendre son fonds de commerce, le contrat de franchise prévoit très souvent une clause d’agrément. Elle donne au franchiseur le droit d’approuver ou de refuser le candidat acquéreur (le cessionnaire). Cette clause est licite car elle permet au franchiseur de s’assurer que le nouveau membre du réseau possède les compétences et les moyens financiers requis. Le franchiseur protège ainsi la pérennité et l’homogénéité de son réseau. Cependant, un refus d’agrément ne doit pas être abusif ou discriminatoire. Il doit être fondé sur des critères objectifs et légitimes, liés aux intérêts du réseau.
Les restrictions caractérisées en franchise et leur sanction
Si le droit de la concurrence admet de nombreuses clauses restrictives au nom de la spécificité de la franchise, il reste intraitable face à certaines pratiques considérées comme particulièrement nocives. Ces « restrictions de concurrence par leur objet » ou « restrictions caractérisées » sont presque toujours illicites et exposent les entreprises à de lourdes sanctions pécuniaires.
L’interdiction des prix minimaux imposés et prix fixes (jurisprudence abondante)
Le franchiseur ne peut en aucun cas imposer au franchisé un prix de revente fixe ou minimal pour ses produits ou services. Le franchisé est un commerçant indépendant et doit rester libre de déterminer sa politique de prix. Toute pression, menace ou contrainte visant à imposer un niveau de prix est illégale. La jurisprudence est constante et sévère sur ce point. Cette pratique est à distinguer des prix de vente simplement conseillés, qui sont autorisés tant qu’ils n’aboutissent pas, dans les faits, à des prix imposés. La distinction est subtile et au cœur des problématiques de fixation des prix pour éviter les pièges juridiques.
La protection territoriale absolue
Si la clause de localisation est admise, la protection territoriale absolue est en revanche une restriction caractérisée. Le franchiseur ne peut pas garantir à un franchisé qu’aucun autre franchisé ou que le franchiseur lui-même ne réalisera de ventes (actives ou passives) sur son territoire. Une telle clause aboutirait à un cloisonnement total des marchés nationaux, ce qui est contraire aux principes fondamentaux du droit de la concurrence. Il est possible d’organiser une protection territoriale limitée, par exemple en interdisant au franchiseur et aux autres franchisés de s’installer physiquement ou de faire de la publicité ciblée sur le territoire concédé, mais une étanchéité totale est proscrite.
L’interdiction des rétrocessions entre franchisés
Interdire aux franchisés d’un même réseau de se vendre des produits entre eux est également une restriction caractérisée. Ces ventes parallèles au sein du réseau permettent de fluidifier l’approvisionnement (un franchisé en rupture de stock peut se fournir chez un confrère) et d’introduire une forme de concurrence au niveau de la distribution. Empêcher ces rétrocessions limite la concurrence et est donc sanctionné. Cette liberté de s’approvisionner auprès d’autres membres du réseau doit être préservée.
La structuration d’un réseau de franchise et la rédaction des contrats qui le régissent exigent une analyse fine du droit de la concurrence. Une clause mal rédigée ou une pratique commerciale malheureuse peut avoir des conséquences financières importantes et déstabiliser l’ensemble du réseau. Pour sécuriser votre développement et garantir la conformité de vos pratiques, contactez notre cabinet d’avocats.
Sources
- Code de commerce, notamment les dispositions sur la concurrence et les contrats de distribution.
- Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), notamment son article 101.
- Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (VBER).
- Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de l’Autorité de la concurrence française.