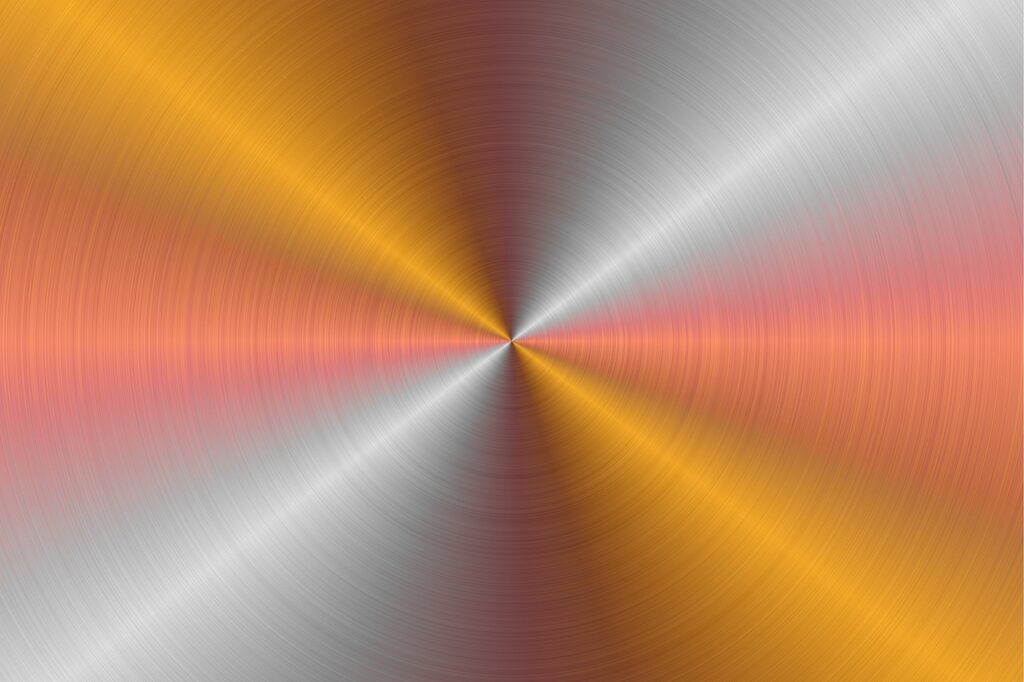On ne plaisante pas avec la mise en demeure. Ce petit acte juridique, redouté des débiteurs, joue un rôle majeur dans notre arsenal juridique. Il marque le passage d’une phase amiable à l’antichambre du contentieux. Avant d’envisager une procédure judiciaire, elle constitue une étape décisive pour régler le conflit ou obtenir le paiement d’une créance.
1. Qu’est-ce qu’une mise en demeure ?
Définition et origine
Du latin « mora » signifiant « retard », la mise en demeure évoque l’immobilisme dommageable. L’expression « péril en la demeure » traduit les risques inhérents à tout retard d’exécution.
Juridiquement, la « demeure » désigne l’état du débiteur en retard pour exécuter son obligation. Cet état génère des dommages-intérêts et des risques à sa charge, conformément aux articles 1231 et suivants du Code civil. La lettre de mise en demeure représente l’interpellation formelle adressée à une personne pour qu’elle s’exécute dans un délai fixé.
Place dans le système juridique
La mise en demeure se situe après la naissance de l’obligation mais avant son exécution. Elle constate l’inexécution et déclenche des sanctions contre le débiteur récalcitrant.
Plus qu’une simple relance, elle constitue parfois un préalable obligatoire au recouvrement de créances. L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale l’impose avant toute procédure de recouvrement des cotisations sociales.
Originaire du droit des obligations (articles 1344 à 1345-3 du Code civil), elle s’applique dans de nombreux domaines. Une recherche révèle que cette expression apparaît 1502 fois dans 60 codes différents !
2. Nature juridique de la mise en demeure
Un acte juridique unilatéral
La mise en demeure est une manifestation unilatérale de volonté. L’auteur exprime son impatience et son intention d’obtenir l’exécution d’une prestation.
Elle produit des effets juridiques déterminés, comme le rappelle la Cour de cassation (Civ. 1re, 24 juin 1975, n° 74-10.644). Le créancier met ainsi une pression sur le débiteur pour qu’il s’exécute.
Un acte interpellatif et déclaratif
La mise en demeure rappelle, informe et interpelle. Elle expose le destinataire aux sanctions potentielles s’il persiste dans son attitude.
Son contenu dépasse la simple invitation : elle interpelle une dernière fois le débiteur avant l’engagement de poursuites. Elle constate le retard sans créer de droits nouveaux. L’interpellation doit être suffisante pour que le document ait une valeur juridique.
Un acte extrajudiciaire et réceptice
Bien que préalable à l’exercice d’un droit, la mise en demeure reste un acte extrajudiciaire. La jurisprudence précise qu’elle n’est pas de nature contentieuse (Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-20.680).
La mise en demeure est un acte réceptice – elle n’existe que par la notification faite au destinataire. Sans cette notification, elle ne produit aucun effet juridique. « La mise en demeure ne peut produire effet qu’à la condition d’être parvenue à son destinataire » (Civ. 2e, 16 novembre 2004, n° 03-16.270).
3. Les conditions de validité
Consentement : une volonté ferme et précise
La mise en demeure doit exprimer une volonté libre et éclairée. Cette volonté doit être ferme et précise, manifestant l’intention d’obtenir l’exécution de l’engagement.
En cas de doute, le juge déterminera la portée de cette volonté. La demande formulée doit préciser la somme due ou la prestation attendue.
Capacité : qui peut délivrer/recevoir une mise en demeure
La capacité pour délivrer une mise en demeure est appréciée largement. Même un incapable (mineur, majeur en curatelle) pourrait adresser valablement une mise en demeure puisqu’il s’agit d’un acte conservatoire.
En revanche, la capacité pour recevoir une mise en demeure est plus restrictive. Pour la Cour de cassation, la mise en demeure « ne constitue pas un simple acte conservatoire » (Civ. 3e, 3 juillet 1996, n° 94-18.325). Le destinataire doit jouir d’une capacité étendue, celle d’accomplir des actes d’administration.
Objet : ce que peut et ne peut pas faire une mise en demeure
La mise en demeure ne crée pas d’obligation nouvelle. Elle rappelle le caractère obligatoire d’un engagement préexistant.
Elle ne caractérise pas une faute du débiteur (Civ. 3e, 5 juillet 2011, n° 10-17.351) ni sa mauvaise foi (Civ. 1re, 17 avril 2019, n° 18-13.842).
Son objet est l’interpellation du destinataire sur l’inexécution d’une obligation. Interface entre phase amiable et contentieuse, elle doit fournir des informations précises. La Cour de cassation exige que son contenu « permette au destinataire de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation » (Civ. 2e, 17 mars 2022, n° 20-18.056).
L’article 1225 du Code civil impose que la mise en demeure mentionne « expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
4. Forme et contenu de la mise en demeure
Les formes autorisées
L’article 1344 du Code civil prévoit plusieurs formes pour la mise en demeure :
- La sommation (acte délivré par un huissier)
- Un acte portant interpellation suffisante (recommandé avec accusé)
- L’exigibilité de l’obligation, si le contrat le prévoit
Dans certains cas, une lettre recommandée avec avis est exigée. Cette forme sécurise la procédure en prouvant l’envoi et la date de réception.
Les mentions obligatoires
Pour être valide, la mise en demeure doit comporter :
- La date du courrier
- Les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire
- La mention « mise en demeure » clairement indiquée
- La somme due ou l’obligation à exécuter
- Le fondement de la créance (contrat, facture)
- Le délai accordé (délai raisonnable)
- Les conséquences en cas d’absence de réponse satisfaisante
La signature est une formalité recommandée pour éviter toute contestation.
Modèle et exemple
Exemple de formulation pour une mise en demeure de payer :
« Je vous mets en demeure de régler la somme de [montant] euros correspondant à [cause], dans un délai de [durée] à compter de la réception. À défaut, je me verrai contraint de procéder au recouvrement judiciaire, entraînant des frais supplémentaires. »
Des modèles de lettre sont disponibles en ligne. Pour les affaires complexes, mieux vaut faire appel à un service professionnel pour rédiger une mise en demeure.
5. Effets juridiques de la mise en demeure
Point de départ des intérêts moratoires
La mise en demeure fait automatiquement courir les intérêts moratoires au taux légal pour les obligations financières (article 1344-1 du Code civil), sans justification de dommage.
Transfert des risques
Pour les obligations de délivrer quelque chose, la mise en demeure transfère les risques au débiteur (article 1344-2 du Code civil). En cas de perte, c’est lui qui supportera les conséquences.
Déchéance du terme
Dans les contrats de prêt, la mise en demeure peut entraîner la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité de la somme due, si une clause le prévoit.
Préalable à la résolution
La mise en demeure est généralement un préalable obligatoire à la résolution d’un contrat, sauf urgence. Elle fixe le point de départ du délai imparti avant la cessation du contrat.
6. Contestation et moyens de défense
Contester une mise en demeure
Le destinataire peut contester une mise en demeure pour plusieurs motifs :
- Créance non liquide et exigible
- Montant contesté
- Problème dans la procédure
- Délai de prescription dépassé
- Absence de cause valable
La réponse doit être envoyée par recommandé avec accusé pour constituer une preuve.
Conséquences d’une absence de réponse
Ne pas réagir peut entraîner :
- L’obtention d’un titre exécutoire
- Une saisie de biens
- Une condamnation par le tribunal
- Des frais additionnels
La CNIL met en demeure régulièrement des sociétés ne respectant pas leurs obligations légales. Ces mises en demeure exigent la mise à jour des pratiques concernées sous peine de sanctions.
En pratique, notre cabinet recommande une attention particulière au contenu de la mise en demeure, surtout lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’une action. Les juges exercent un contrôle rigoureux sur les informations qu’elle contient. Face à une mise en demeure, consultez un professionnel pour évaluer la situation et déterminer la meilleure démarche.
Pour une analyse de votre cas ou pour vous aider à rédiger une lettre de mise en demeure concernant des travaux non exécutés ou une prestation insatisfaisante, notre équipe se tient à votre disposition.
Sources
- Code civil, articles 1231 et suivants, 1344 à 1345-3, 1225 et 1226
- Code de la sécurité sociale, articles L. 244-1, L. 244-2 et R. 133-3
- Code monétaire et financier
- Code de procédure civile
- Civ. 1re, 24 juin 1975, n° 74-10.644
- Civ. 2e, 16 novembre 2004, n° 03-16.270
- Civ. 3e, 3 juillet 1996, n° 94-18.325
- Civ. 3e, 5 juillet 2011, n° 10-17.351
- Civ. 1re, 17 avril 2019, n° 18-13.842
- Civ. 2e, 17 mars 2022, n° 20-18.056
- Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-20.680
- DEHARO Gaëlle, « Répertoire de procédure civile – Mise en demeure », Dalloz, septembre 2022