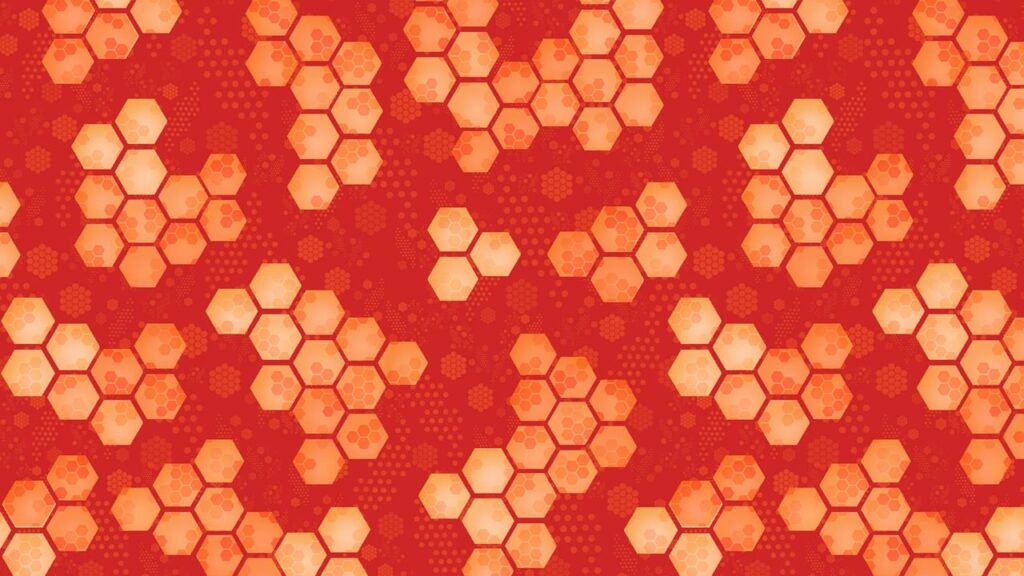Les entreprises confrontées à des impayés disposent d’un arsenal juridique souvent méconnu. Parmi ces outils, la saisie conservatoire de créances constitue un levier particulièrement efficace. Cette procédure permet de bloquer rapidement les fonds détenus par votre débiteur, notamment ses comptes bancaires, avant même d’obtenir un jugement définitif.
1. L’intérêt stratégique de la saisie des créances
La saisie conservatoire répond à une préoccupation majeure : empêcher un débiteur d’organiser son insolvabilité. Cette mesure préventive gèle les avoirs du débiteur sans attendre l’aboutissement d’une procédure judiciaire, souvent longue.
Son principal avantage? L’effet de surprise. Le débiteur n’est informé qu’après le blocage de ses comptes. Cette procédure diffère des voies d’exécution classiques qui nécessitent un titre exécutoire (jugement définitif, acte notarié…).
Le code des procédures civiles d’exécution (CPCE) définit clairement son objectif : « rendre indisponibles les biens mobiliers » du débiteur (article L.521-1).
2. Le domaine de la saisie conservatoire de créances
Les créances concernées
La saisie conservatoire ne peut porter que sur des créances de sommes d’argent. L’article L.523-1 du CPCE est explicite sur ce point.
Les obligations de faire, de ne pas faire ou de donner ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure. Elles s’exécutent différemment.
Attention toutefois : les rémunérations du travail sont expressément exclues par l’article L.3252-7 du Code du travail.
Le cas particulier des comptes bancaires
Les comptes bancaires constituent la cible privilégiée des saisies conservatoires. Pourquoi? Parce que l’argent s’y trouve déjà sous forme liquide, facilement identifiable.
Le banquier, en tant que tiers saisi, joue un rôle clé. Il devra déclarer le solde des comptes du débiteur au jour de la saisie (article L.162-1 du CPCE).
La Cour de cassation a précisé que « le banquier n’est tenu de déclarer que le solde de l’ensemble des comptes » (Civ. 2e, 5 juillet 2000, n°97-22.287).
3. La procédure de saisie des créances
L’acte de saisie et sa signification au tiers saisi
Pour initier la procédure, le créancier doit obtenir l’autorisation du juge de l’exécution, sauf exceptions prévues à l’article L.511-2 du CPCE (titre exécutoire, lettre de change acceptée, chèque impayé…).
L’huissier signifie ensuite l’acte de saisie au tiers détenteur des fonds (généralement une banque). Cet acte doit contenir, à peine de nullité :
- Les coordonnées du débiteur
- L’indication du titre autorisant la saisie
- Le décompte des sommes réclamées
- La défense faite au tiers de disposer des sommes saisies
Depuis le 1er janvier 2021, lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire, l’acte lui est transmis par voie électronique.
Les obligations du tiers saisi
Le tiers saisi (banquier) doit déclarer l’étendue de ses obligations envers le débiteur (article L.211-3 du CPCE).
S’il ne respecte pas cette obligation, il s’expose à des sanctions sévères :
- Condamnation à payer les causes de la saisie
- Dommages-intérêts en cas de déclaration inexacte ou mensongère
La jurisprudence a toutefois nuancé cette rigueur. Un arrêt du 5 juillet 2000 rappelle que la garantie du tiers saisi n’est pas une sanction automatique (Civ. 2e, n°97-19.629).
La dénonciation au débiteur
À peine de caducité, la saisie doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours (article R.523-3 du CPCE).
Cette dénonciation doit contenir :
- Une copie de l’autorisation du juge ou du titre
- Une copie de l’acte de saisie
- L’information sur ses droits de contestation
Cette étape est cruciale. Une erreur de procédure à ce stade pourrait invalider toute la saisie.
4. Les effets de la saisie
L’indisponibilité partielle
La saisie rend les sommes indisponibles uniquement « à concurrence du montant autorisé » (article L.523-1 du CPCE).
C’est un avantage pour le débiteur : seul le montant de la créance est bloqué, pas l’intégralité du compte.
Une innovation sociale importante : l’article L.162-2 du CPCE impose de laisser à disposition du débiteur (personne physique) une somme équivalente au RSA pour un allocataire seul.
La consignation et le privilège du saisissant
L’article L.523-1 précise que la saisie « emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l’article 2350 du code civil ».
Cette disposition confère au créancier saisissant un privilège comparable à celui du gagiste. En cas de procédure collective ultérieure, cette protection peut s’avérer déterminante.
Toutefois, la jurisprudence considère que ce privilège disparaît si la saisie n’est pas convertie avant l’ouverture d’une procédure collective (Com. 22 avril 1997, n°94-16.979).
5. La conversion en saisie-attribution
L’acte de conversion
Une fois muni d’un titre exécutoire, le créancier peut transformer sa saisie conservatoire en saisie-attribution.
L’acte de conversion doit mentionner :
- La référence au procès-verbal de saisie conservatoire
- Le titre exécutoire
- Le décompte des sommes dues
- La demande de paiement
Cette conversion « emporte attribution immédiate de la créance saisie » (article L.523-2 du CPCE).
Les contestations possibles
Le débiteur dispose de 15 jours pour contester l’acte de conversion (article R.523-9 du CPCE).
Cette contestation doit être dénoncée le même jour à l’huissier par LRAR. Le débiteur doit également informer le tiers saisi par lettre simple.
La jurisprudence exige que cette contestation soit non seulement signifiée mais aussi enrôlée dans le délai de 15 jours (Paris, 3 décembre 1998).
En l’absence de contestation, l’huissier peut délivrer un certificat de non-contestation permettant le paiement immédiat par le tiers saisi.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L.511-1 et suivants, L.521-1, L.523-1 à L.523-2, R.523-1 à R.523-10
- Code du travail, article L.3252-7
- Code civil, article 2350
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juillet 2000, n°97-22.287, Bull. civ. II, n°113
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juillet 2000, n°97-19.629, Bull. civ. II, n°115
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 avril 1997, n°94-16.979, Bull. civ. IV, n°100
- Cour d’appel de Paris, 3 décembre 1998, Procédures 1999, Comm. 24