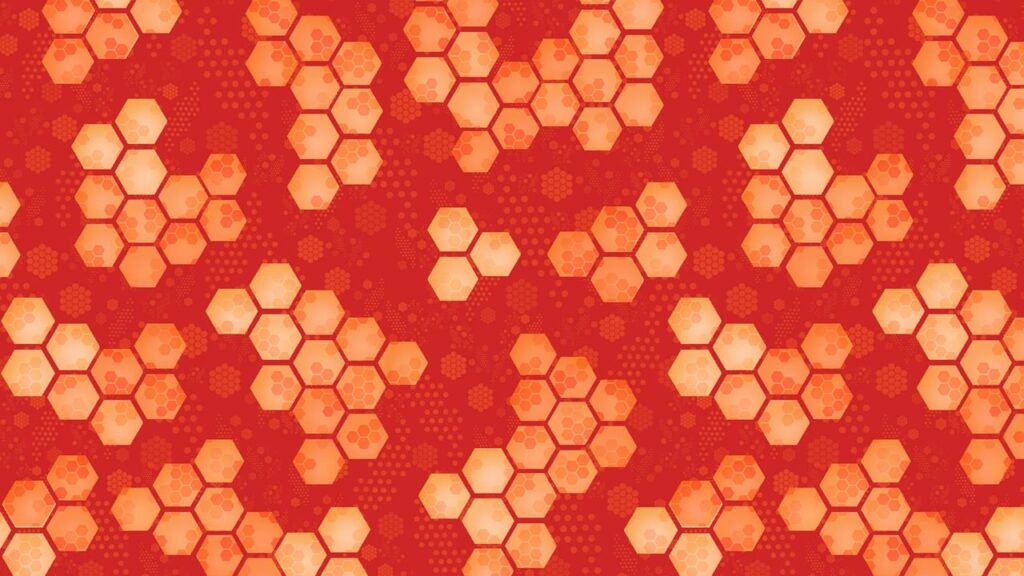I. Introduction à la saisie conservatoire de navires
La saisie conservatoire de navire est une procédure qui permet d’immobiliser temporairement un navire au port. C’est une mesure préventive, non une sanction définitive. Elle vise à garantir le paiement d’une créance en empêchant le débiteur de faire disparaître son gage.
Dans l’univers maritime, cette procédure joue un rôle central. Les navires se déplacent constamment entre juridictions. Leur mobilité complique le recouvrement des créances. Sans moyen d’immobilisation rapide, les créanciers perdraient toute chance d’obtenir paiement.
La saisie conservatoire se distingue de la saisie-exécution. Elle ne cherche pas à vendre le navire mais à créer une pression sur le débiteur. La première immobilise, la seconde transfère la propriété. En pratique, la saisie conservatoire est fréquente tandis que la saisie-exécution reste rare.
II. Régime juridique international
La Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 constitue le texte fondamental en matière de saisie conservatoire. Elle harmonise les règles dans ce domaine entre les États signataires. Ce texte fixe les conditions de saisie et liste les créances maritimes justifiant une telle procédure.
Son champ d’application couvre toute saisie pratiquée dans un État contractant sur un navire battant pavillon d’un autre État contractant. Elle s’applique parfois aux navires d’États non contractants saisis dans un État membre.
Plus de 70 pays ont ratifié cette convention, dont la France et la plupart des nations maritimes. Des États importants comme les États-Unis ou le Japon restent toutefois non-signataires.
La Convention de Genève du 12 mars 1999 devait remplacer celle de 1952. Elle étend la liste des créances maritimes et clarifie certaines procédures. Malgré son entrée en vigueur, elle n’a été ratifiée que par quelques pays, limitant son impact réel.
III. Conditions de la saisie conservatoire
La « créance maritime » est au cœur du dispositif de la Convention de 1952. L’article 1er énumère exhaustivement les créances permettant une saisie conservatoire, comme les dommages causés par un navire, les salaires d’équipage ou les fournitures.
Cette convention simplifie considérablement la tâche du créancier. Il lui suffit d’alléguer l’existence d’une créance maritime, sans devoir prouver sa certitude ou son exigibilité. Cette simple allégation justifie la mesure conservatoire.
Un lien doit exister entre la créance et le navire saisi. Le créancier peut saisir le navire auquel la créance se rapporte. Dans certains cas, il peut aussi saisir d’autres navires appartenant au même propriétaire. Ce droit ne s’étend pas aux créances liées à la propriété contestée ou aux hypothèques maritimes.
IV. Régime juridique français
Le droit français articule habilement règles internationales et internes. Pour les navires battant pavillon d’un État contractant, la Convention de 1952 s’applique pleinement. Pour les autres, le droit interne prend le relais.
Le Code des transports, principalement en ses articles L. 5114-20 et suivants, organise la saisie conservatoire en droit français. Ces dispositions reprennent largement les principes de la loi du 3 janvier 1967 et du décret du 27 octobre 1967.
Le droit interne français se montre plus souple que la Convention. Il permet la saisie pour toute créance « paraissant fondée en son principe », sans restriction aux créances maritimes.
La compétence judiciaire varie selon le fondement de la saisie. Pour une créance maritime relevant de la Convention, le président du tribunal de commerce est compétent. Pour les autres créances, c’est le juge de l’exécution qui intervient. Cette dualité complexifie parfois la procédure.
V. Procédure et mise en œuvre
L’autorisation judiciaire préalable est obligatoire. Le créancier présente une requête au juge compétent. Cette demande doit mentionner la créance alléguée et le navire visé. Le juge statue rapidement, sans entendre le débiteur.
Après obtention de l’autorisation, un huissier notifie l’acte de saisie au capitaine du navire. Il avise également les autorités portuaires qui interdisent alors le départ du navire. Cette phase cruciale doit être exécutée avant que le navire ne quitte le port.
Un gardien est désigné, souvent le capitaine lui-même. Sa mission : veiller à la conservation du navire pendant la saisie. Sa responsabilité peut être engagée en cas de dommage ou de départ illicite.
La publicité de la saisie s’effectue par inscription au registre spécial tenu par les douanes ou le greffe du tribunal de commerce. Cette formalité rend la saisie opposable aux tiers et empêche toute cession du navire.
VI. Effets de la saisie conservatoire
L’effet principal est l’immobilisation immédiate du navire. Il ne peut plus quitter le port sans autorisation judiciaire. Cette contrainte crée une forte pression sur l’armateur qui subit des coûts d’immobilisation considérables.
Cette mesure n’est pas définitive. Le créancier doit engager une procédure au fond dans un délai d’un mois. À défaut, la saisie devient caduque. Ce délai garantit l’équilibre entre les intérêts du créancier et les droits du débiteur.
Des solutions alternatives existent. Le juge peut autoriser le départ du navire moyennant une garantie financière. Cette option, fréquente en pratique, permet au navire de poursuivre son exploitation tout en sécurisant la créance. La garantie prend souvent la forme d’une caution bancaire ou d’une lettre d’engagement d’un P&I Club.
La saisie conservatoire des navires reste un outil essentiel dans le commerce maritime. Sa double dimension, à la fois mesure de pression et garantie de paiement, en fait un mécanisme équilibré. Elle protège les créanciers sans paralysek totalement l’exploitation maritime.
Sources
- Convention de Bruxelles du 10 mai 1952
- Code des transports, articles L.5114-20 et suivants
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2023, n° 20-21.546
- Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
- Jurisprudence de la Cour de cassation, notamment Com. 5 octobre 2010, n° 09-13.092