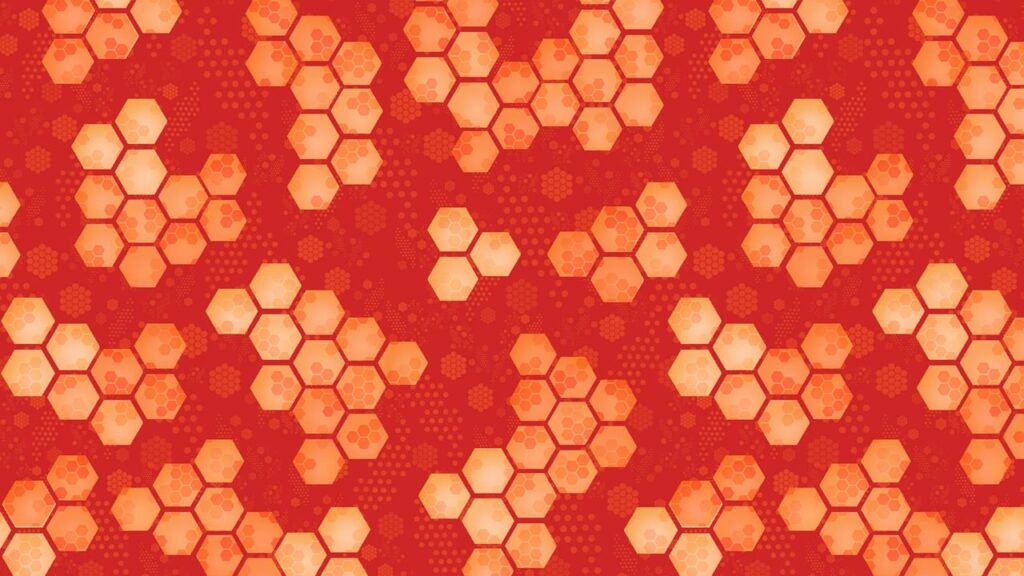Les litiges concernant la propriété ou la possession de biens meubles peuvent devenir complexes. Lorsqu’un bien vous appartient mais se retrouve entre les mains d’un tiers, il existe une procédure spécifique pour protéger vos droits : la saisie-revendication. Cette mesure conservatoire, méconnue du grand public, constitue un outil juridique puissant pour qui sait l’utiliser correctement.
Comprendre la saisie-revendication
Définition et objectif
La saisie-revendication est une mesure conservatoire qui rend un bien meuble indisponible avant qu’une décision de justice définitive n’en ordonne la remise au demandeur. Elle vise à empêcher la disparition, la détérioration ou l’aliénation d’un bien durant la procédure judiciaire.
Comme le précise l’article L. 222-2 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) : « Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication. »
Cette procédure permet de « geler » la situation juridique du bien, sans toutefois en dépouiller le détenteur.
Cadre légal
Le régime juridique de la saisie-revendication est principalement défini par les articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du CPCE. Ces dispositions ont remplacé depuis 2012 les anciens articles 155 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Contrairement aux mesures d’exécution forcée, la saisie-revendication n’exige pas de titre exécutoire préalable. Elle se distingue notamment de la saisie-appréhension qui permet l’enlèvement effectif du bien en vue de sa remise au créancier.
Nature conservatoire
La saisie-revendication appartient à la catégorie des mesures conservatoires. Elle ne préjuge pas du fond du droit et ne permet pas d’obtenir immédiatement la remise du bien. Son effet principal est de rendre le bien indisponible entre les mains du détenteur, le temps d’obtenir une décision sur le fond. Il est toutefois essentiel de connaître les obstacles et limites qui peuvent affecter cette mesure provisoire.
La jurisprudence a confirmé cette nature conservatoire, notamment dans un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 1999, précisant qu’une demande d’autorisation de saisie-revendication constitue la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.
Conditions de mise en œuvre
Personne apparemment fondée à agir
Peut agir toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble. Cette formulation volontairement large inclut :
- Le propriétaire du bien
- L’acheteur qui n’a pas obtenu livraison
- Le déposant réclamant son bien au dépositaire
- Le prêteur sollicitant le retour d’un bien prêté
- Le crédit-bailleur impayé
- Le bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété
- Le titulaire d’un privilège spécial
C’est au juge d’apprécier le caractère apparent du droit invoqué, sans toutefois préjuger du fond. Dans un arrêt du 31 mai 2001 (n° 99-11.107), la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient à celui qui sollicite une saisie-revendication d’établir le caractère apparent du droit qu’il invoque.
Autorisation judiciaire préalable
L’article R. 222-17 du CPCE pose en principe la nécessité d’une autorisation préalable du juge délivrée sur requête. Cette autorisation est délivrée par le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, conformément à l’article R. 511-2 du même code.
L’ordonnance du juge doit désigner avec précision le bien qui peut être saisi et l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Elle est opposable à tout détenteur du bien désigné, ce qui permet au créancier de saisir le bien même s’il n’est plus entre les mains du débiteur initial.
Types de biens concernés
La saisie-revendication ne peut porter que sur des biens meubles corporels, à l’exclusion des immeubles et des meubles incorporels (créances, parts sociales, etc.).
- Les objets mobiliers (mobilier, équipement, etc.)
- Les véhicules
- Les marchandises
- Les stocks
- Les œuvres d’art
- Les souvenirs de famille (selon un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1995)
Les biens fongibles (interchangeables) peuvent également être revendiqués s’ils sont suffisamment individualisés.
Dispenses d’autorisation
Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE dispense de l’autorisation judiciaire préalable le créancier qui détient :
- Un titre exécutoire
- Une décision de justice non encore exécutoire
Ces dispenses permettent d’accélérer la procédure lorsque le créancier dispose déjà d’un titre constatant son droit.
Exécution de la saisie
Lieu d’exécution
L’article R. 222-20 du CPCE dispose que la saisie-revendication peut être pratiquée en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
Une particularité notable : si le bien se trouve dans un local d’habitation appartenant à un tiers, une autorisation spéciale du juge est nécessaire. Cette protection supplémentaire vise à garantir l’inviolabilité du domicile.
Acte de saisie et mentions obligatoires
L’huissier de justice doit dresser un acte de saisie qui contient, à peine de nullité (article R. 222-21 du CPCE) :
- La mention de l’autorisation du juge ou du titre permettant la saisie
- La désignation détaillée du bien saisi
- La déclaration du détenteur concernant une éventuelle saisie antérieure
- L’indication que le bien est placé sous la garde du détenteur
- La mention du droit de contester la validité de la saisie
- La désignation de la juridiction compétente pour les contestations
- Les noms et qualités des personnes présentes lors des opérations
- La reproduction des textes applicables
L’huissier peut photographier les biens saisis, ces photographies étant conservées en vue d’une éventuelle vérification ultérieure.
Notification et signification
Une fois l’acte de saisie dressé, il est remis au détenteur. L’huissier doit lui rappeler verbalement les obligations qui lui incombent et son droit de contester la mesure.
Si le détenteur est absent lors des opérations, une copie de l’acte lui est signifiée. Il dispose alors d’un délai de huit jours pour informer l’huissier de l’existence d’une éventuelle saisie antérieure.
Quand la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, l’acte doit également être signifié dans un délai de huit jours à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien.
Droits du détenteur
Le détenteur du bien saisi conserve plusieurs droits :
- Il peut continuer à utiliser le bien (sans pouvoir l’aliéner)
- Il a le droit de contester la validité de la saisie et d’en demander la mainlevée
- Il peut faire valoir un droit propre sur le bien saisi (droit de rétention par exemple)
En cas de contestation, il appartient au détenteur de saisir le juge compétent dans les conditions prévues à l’article R. 222-18 du CPCE.
Effets et suites de la saisie
Indisponibilité du bien
L’effet principal de la saisie-revendication est de rendre le bien indisponible. Le détenteur ne peut ni l’aliéner, ni le déplacer, sauf motif légitime et après en avoir informé le créancier.
Cette indisponibilité est sanctionnée pénalement : l’article 314-6 du Code pénal réprime le détournement d’objet saisi d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Garde du bien
Le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui devient responsable de sa conservation. L’article R. 222-23 du CPCE prévoit toutefois qu’à tout moment, le juge de l’exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.
Cette solution peut être pertinente en cas de risque de dégradation ou de détournement du bien par le détenteur.
Droits propres du détenteur
L’article R. 222-24 du CPCE envisage l’hypothèse où le détenteur se prévaudrait d’un droit propre sur le bien saisi (droit de rétention, droit d’usage, etc.). Dans ce cas, il doit en informer l’huissier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le créancier saisissant dispose alors d’un délai d’un mois pour contester ce droit devant le juge de l’exécution. À défaut, l’indisponibilité cesse automatiquement, le créancier étant réputé avoir accepté tacitement la prétention du détenteur.
Conversion en saisie-appréhension
La saisie-revendication n’étant qu’une mesure provisoire, elle doit être suivie d’une action au fond visant à obtenir un titre exécutoire. L’article R. 511-7 du CPCE impose au créancier d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité.
Une fois le titre exécutoire obtenu, la saisie-revendication peut être convertie en saisie-appréhension, permettant ainsi l’enlèvement effectif du bien et sa remise au créancier.
L’article R. 222-25 du CPCE précise les modalités de cette conversion, qui s’opère selon les règles de la saisie-appréhension prévues aux articles R. 222-2 à R. 222-10 du même code.
Conclusion
La saisie-revendication est un mécanisme juridique complexe mais essentiel pour protéger vos droits sur les biens meubles. Sa nature conservatoire et ses spécificités d’exécution exigent une connaissance approfondie du Code des procédures civiles d’exécution. Pour toute question ou pour vous faire accompagner dans une telle démarche, n’hésitez pas à consulter un avocat expert en voies d’exécution.
Sources
- Articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution
- Article 314-6 du Code pénal
- Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 1999 (n° 96-21.218)
- Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2001 (n° 99-11.107)
- Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 1995 (n° 93-18.769)
- Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (dispositions historiques)
- Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution