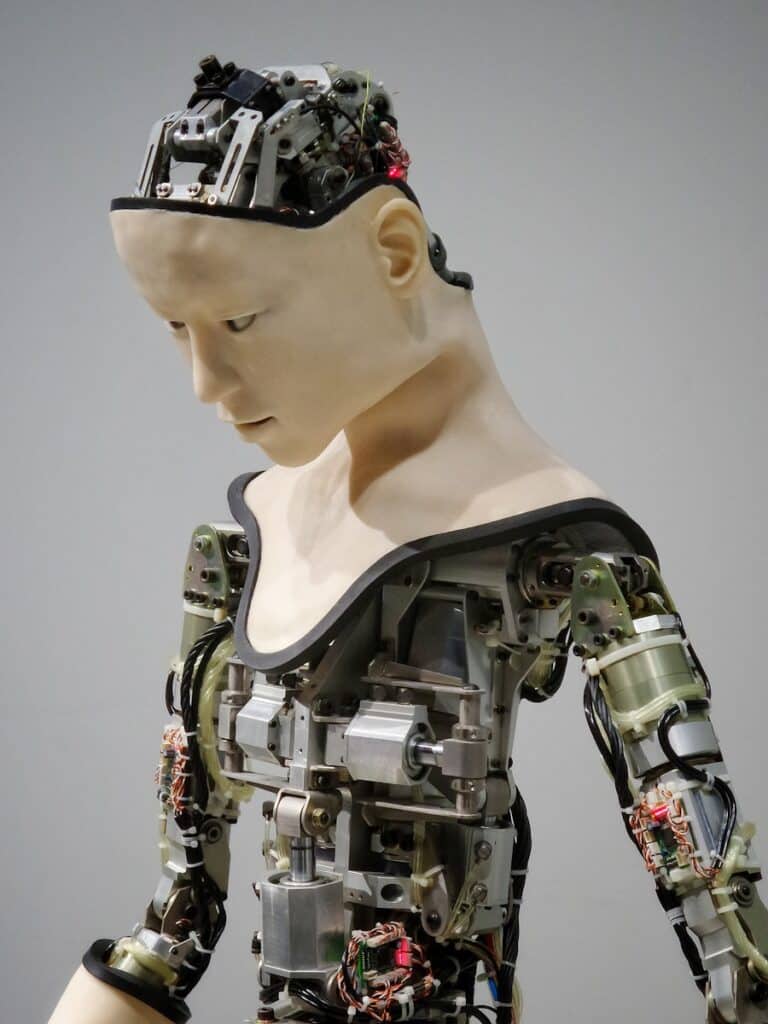Les difficultés financières font partie de la vie des entreprises. Heureusement, le droit français offre plusieurs outils pour les anticiper et les traiter avant qu’une situation ne devienne irrémédiable. Parmi ces outils, la procédure de sauvegarde accélérée se distingue comme une solution rapide et efficace, particulièrement adaptée aux entreprises qui ont déjà bien avancé dans la négociation d’un plan de redressement avec leurs créanciers.
Cet article explore le fonctionnement de cette procédure, modernisée par une importante réforme en 2021. Nous verrons comment elle s’articule avec la phase de négociation amiable (la conciliation), quelles entreprises peuvent y prétendre, comment elle se déroule concrètement et quels en sont les effets pour l’entreprise et ses partenaires. Comprendre ce mécanisme peut ouvrir des perspectives intéressantes pour surmonter une passe difficile.
Qu’est-ce que la sauvegarde accélérée ?
La sauvegarde accélérée est une procédure collective judiciaire. Son objectif principal n’est pas de traiter des difficultés insurmontables, mais plutôt de finaliser et de rendre obligatoire un plan de restructuration qui a déjà été largement négocié et approuvé par une majorité de créanciers lors d’une phase amiable préalable : la conciliation. Imaginez une négociation bien engagée mais qui achoppe sur quelques créanciers récalcitrants : la sauvegarde accélérée permet, sous certaines conditions, de passer outre leur refus et d’imposer le plan à tous.
Son cadre légal actuel découle principalement de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. Cette réforme majeure a eu plusieurs impacts significatifs. D’abord, elle a fusionné l’ancienne sauvegarde accélérée avec une procédure voisine, la sauvegarde financière accélérée (SFA), en une procédure unique plus cohérente. Ensuite, elle a aligné le droit français sur la directive européenne (UE) 2019/1023 concernant les cadres de restructuration préventive. L’objectif est clair : offrir aux entreprises européennes des outils efficaces pour se restructurer rapidement et éviter la faillite lorsque c’est possible.
La différence fondamentale avec la procédure de sauvegarde « classique » réside dans sa porte d’entrée et sa durée. On ne peut pas demander une sauvegarde accélérée directement. Il faut obligatoirement passer par une conciliation préalable et avoir un projet de plan déjà très avancé. C’est une procédure conçue pour l’efficacité et la rapidité, visant à une adoption du plan en quatre mois maximum, là où une sauvegarde classique peut s’étendre sur une période bien plus longue. Elle est donc moins une procédure d’observation qu’une procédure d’homologation rapide d’une solution négociée en amont.
Quelles conditions remplir pour accéder à la sauvegarde accélérée ?
L’accès à cette procédure rapide est encadré par des conditions précises, définies notamment par l’article L. 628-1 du code de commerce. Elles visent à s’assurer que la procédure est utilisée à bon escient, c’est-à-dire lorsque les chances de succès sont réelles grâce au travail préparatoire effectué.
Le passage obligé par la conciliation
C’est la condition sine qua non : l’entreprise doit être engagée dans une procédure de conciliation au moment où elle demande l’ouverture de la sauvegarde accélérée, ou cette conciliation doit s’être terminée très récemment. La conciliation est cette phase amiable et confidentielle où, sous l’égide d’un conciliateur désigné par le président du tribunal, l’entreprise négocie avec ses principaux créanciers pour trouver un accord permettant de surmonter ses difficultés.
La sauvegarde accélérée apparaît ainsi comme une « procédure dérivée », un prolongement judiciaire de la conciliation. Elle intervient lorsque la conciliation a permis de bâtir un consensus majoritaire mais que l’unanimité, souvent requise pour un accord de conciliation classique, n’a pu être atteinte ou que l’accord doit être imposé à certains créanciers pour être viable. Le rapport rédigé par le conciliateur sur le déroulement des négociations et les perspectives d’adoption du plan jouera un rôle déterminant dans la décision du tribunal d’ouvrir ou non la sauvegarde accélérée.
Un projet de plan avancé et susceptible d’être adopté
Pour comprendre comment préparer et négocier efficacement un plan de sauvegarde, il ne suffit pas d’être en conciliation. Le débiteur doit pouvoir présenter au tribunal un projet de plan de sauvegarde déjà élaboré et suffisamment abouti. Plus encore, ce projet doit recueillir un « soutien suffisamment large » de la part des créanciers qui seront concernés par la procédure (les « parties affectées »). Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Le tribunal va évaluer si l’adhésion déjà obtenue rend « vraisemblable » l’adoption formelle du plan par les futures instances de vote (les classes de parties affectées) dans le court délai imparti par la loi.
Cette exigence reflète la logique dite du « prepack » (plan pré-négocié ou pré-apprêté) importée du droit anglo-saxon. L’idée est que l’essentiel du travail de restructuration (analyse de la situation, élaboration des propositions, négociations) doit être fait avant l’ouverture de la procédure judiciaire. Le soutien des créanciers peut se manifester par un accord de principe ou, idéalement, par un protocole d’accord signé durant la conciliation, engageant les créanciers majoritaires à voter en faveur du plan lors de la phase judiciaire.
Les critères d’éligibilité de l’entreprise
Historiquement, l’accès à la sauvegarde accélérée (et surtout à la SFA) était limité par des seuils de taille (nombre de salariés, chiffre d’affaires, total de bilan). La réforme de 2021 a marqué une volonté d’ouverture en supprimant ces seuils pour l’éligibilité générale à la procédure fusionnée.
Désormais, la principale condition tenant à l’entreprise elle-même est d’ordre comptable : elle doit pouvoir justifier que ses comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou, à défaut, établis par un expert-comptable. Cette exigence vise à garantir la fiabilité des informations financières sur lesquelles reposent le projet de plan et la décision du tribunal.
La situation de cessation des paiements n’est pas un obstacle absolu
Contrairement à la sauvegarde classique qui suppose que l’entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible), la sauvegarde accélérée peut être ouverte même si cette situation est avérée. C’est une souplesse importante.
Toutefois, cette tolérance est strictement encadrée dans le temps. Pour que la sauvegarde accélérée soit possible, l’état de cessation des paiements ne doit pas remonter à plus de 45 jours avant la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable. Attention, le point de référence n’est pas la demande de sauvegarde accélérée, mais bien la demande de conciliation qui l’a précédée. Cette règle permet d’éviter que des entreprises durablement insolvables n’utilisent cette procédure rapide, conçue pour des restructurations préventives. Le tribunal vérifiera scrupuleusement ce point, et si la date de cessation des paiements s’avère finalement antérieure à cette limite, la procédure de sauvegarde accélérée devra être clôturée, comme le prévoit l’article L. 628-8 du code de commerce.
Comment s’ouvre et se déroule la procédure ?
Une fois les conditions d’accès réunies, l’ouverture et le déroulement de la sauvegarde accélérée suivent un formalisme propre, allégé sur certains points pour tenir les délais très courts.
L’ouverture par le tribunal
La demande d’ouverture est une démarche exclusive du débiteur ; ni les créanciers, ni le ministère public ne peuvent la solliciter. Elle est déposée auprès du tribunal de commerce (ou judiciaire pour certaines professions) compétent, généralement celui du siège social de l’entreprise. Si la conciliation préalable avait fait l’objet d’un dépaysement (renvoi devant une autre juridiction), cette juridiction reste compétente pour la sauvegarde accélérée.
Le tribunal examine la demande lors d’une audience à laquelle le ministère public est obligatoirement présent. Sa décision se fonde principalement sur le rapport du conciliateur, qui expose l’historique des négociations et évalue les chances de succès du plan proposé, ainsi que sur les pièces justificatives apportées par le débiteur prouvant que les conditions d’ouverture sont remplies. Le tribunal peut demander communication de tous les documents relatifs à la conciliation, même s’ils sont confidentiels.
Les acteurs désignés
Si le tribunal prononce l’ouverture de la sauvegarde accélérée, il désigne les organes habituels des procédures collectives, avec quelques spécificités.
- Un ou plusieurs administrateurs judiciaires sont systématiquement désignés. L’article L. 628-3 du code de commerce prévoit que le tribunal désigne en priorité le conciliateur qui a mené la phase amiable, s’il est inscrit sur les listes professionnelles. C’est une pratique très fréquente et logique : qui mieux que le conciliateur connaît le dossier, les points de blocage éventuels et la manière de finaliser l’accord rapidement ? Cette continuité est un gage d’efficacité.
- Un mandataire judiciaire est également désigné. Son rôle est de représenter l’intérêt collectif des créanciers et de procéder à la vérification du passif déclaré.
- Un juge-commissaire est nommé pour surveiller le déroulement rapide de la procédure.
- Fait notable : le débiteur peut demander au tribunal d’être dispensé de réaliser l’inventaire complet de ses biens, formalité parfois lourde et moins pertinente dans ce contexte où l’objectif est l’adoption rapide d’un plan financier.
Le rôle central des classes de parties affectées
C’est l’une des innovations majeures issues de la transposition de la directive européenne et de la réforme de 2021. La sauvegarde accélérée repose désormais obligatoirement sur la constitution de classes de parties affectées. Ces classes remplacent les anciens comités de créanciers (comité des établissements de crédit, comité des principaux fournisseurs) qui existaient auparavant.
Leur objectif est de regrouper, au sein de différentes classes, les créanciers mais aussi, le cas échéant, les associés ou actionnaires, dont les droits (créances, participation au capital) sont susceptibles d’être modifiés par le projet de plan. Le regroupement se fait sur la base d’une « communauté d’intérêt économique suffisante ». Par exemple, les créanciers bénéficiant de sûretés n’auront pas les mêmes intérêts que les créanciers chirographaires (sans garantie particulière), et pourraient donc être placés dans des classes distinctes. La jurisprudence récente affine les critères de constitution de ces classes (voir par exemple des arrêts de la Cour d’appel de Versailles de 2023). C’est au sein de ces classes que le projet de plan sera soumis au vote. Leur constitution est ordonnée dès le jugement d’ouverture.
Les effets concrets de l’ouverture
L’une des grandes particularités de la sauvegarde accélérée réside dans la portée limitée de ses effets. L’article L. 628-6 du code de commerce est très clair : la procédure ne produit ses effets qu’à l’égard des parties affectées par le projet de plan.
Concrètement, cela signifie que les règles classiques des procédures collectives (arrêt des poursuites individuelles, interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture, arrêt du cours des intérêts pour certaines créances) ne s’appliquent qu’aux créanciers et associés dont le plan prévoit de modifier les droits. Pour tous les autres (par exemple, un fournisseur dont le plan ne modifie pas les délais de paiement ou un créancier public non concerné par le plan), la relation contractuelle se poursuit normalement : ils doivent être payés à l’échéance et peuvent agir en justice en cas de défaut de paiement. C’est un avantage considérable pour l’entreprise qui peut ainsi préserver ses relations commerciales courantes tout en restructurant sa dette financière ou stratégique. Les salariés, bien que non directement « affectés » par le vote du plan, continuent de bénéficier des protections du droit du travail et du régime de garantie des salaires (AGS) si applicable.
Concernant les contrats en cours, les règles générales sur leur continuation (prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce) s’appliquent. L’administrateur peut exiger la poursuite des contrats nécessaires à l’activité. Cependant, pour gagner du temps, certaines facultés de l’administrateur (comme la mise en demeure du cocontractant pour qu’il se prononce sur la poursuite ou la demande de résiliation judiciaire) sont exclues dans le cadre strict de la sauvegarde accélérée.
La déclaration simplifiée des créances affectées
Qui dit procédure collective dit généralement déclaration des créances. La sauvegarde accélérée simplifie grandement ce processus pour les créanciers déjà identifiés lors de la conciliation. Le mécanisme repose sur une liste des créances des parties affectées, établie par le débiteur, puis certifiée par le commissaire aux comptes ou attestée par l’expert-comptable.
Cette liste est déposée au greffe du tribunal. L’article L. 628-7 du code de commerce précise que ce dépôt vaut déclaration de créance au nom des créanciers qui y figurent. Le mandataire judiciaire a ensuite pour mission d’informer chaque créancier concerné du montant et de la nature de sa créance telle qu’elle apparaît sur la liste. Si un créancier constate une erreur ou une omission, ou si sa créance a évolué depuis l’établissement de la liste, il conserve la possibilité (et a même intérêt) de faire sa propre déclaration individuelle dans les délais légaux habituels (généralement deux mois après la publication du jugement d’ouverture au BODACC). Sa déclaration individuelle prévaudra alors sur la liste. Les créanciers qui n’auraient pas participé à la conciliation et qui ne figurent pas sur la liste doivent, eux, déclarer leur créance selon la procédure normale s’ils veulent faire valoir leurs droits.
Quelle est l’issue de la sauvegarde accélérée ?
La procédure est conçue pour aboutir rapidement à une solution pérenne. Sa durée et ses modalités de sortie sont donc strictement encadrées.
Une durée maximale impérative de 4 mois
L’efficacité de la sauvegarde accélérée repose sur sa brièveté. L’article L. 628-8 du code de commerce fixe un délai butoir : le tribunal doit statuer sur le plan dans un délai maximum de quatre mois à compter du jugement d’ouverture. C’est un délai maximal, non susceptible de prolongation. Il englobe toutes les étapes : finalisation du projet de plan, information des parties affectées, vote au sein des classes, et enfin décision du tribunal. Cela impose un rythme soutenu à tous les intervenants.
L’adoption et l’arrêté du plan
Pour découvrir les différentes mesures qu’un plan de sauvegarde peut contenir, l’étape décisive est le vote du projet de plan au sein de chaque classe de parties affectées. Pour être adopté, le projet doit recueillir une majorité spécifique dans chaque classe : la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant participé au vote, comme le détaille l’article L. 626-30-2 du code de commerce. Il est important de noter que les créanciers dont le plan ne modifie pas les conditions de paiement ou prévoit un remboursement intégral rapide ne participent pas au vote.
Une fois le plan approuvé par les classes, il est soumis au tribunal pour être « arrêté » (c’est-à-dire homologué). Le tribunal ne se contente pas d’enregistrer le résultat des votes. Il exerce un contrôle de légalité et d’opportunité. En particulier, comme le prévoit l’article L. 626-31, il doit vérifier que « les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés ». Cela signifie qu’il peut refuser d’arrêter un plan, même approuvé par la majorité requise, s’il estime par exemple que les sacrifices demandés aux minoritaires sont disproportionnés ou que le plan n’est pas viable. C’est une garantie importante pour les créanciers ou associés mis en minorité.
L’échec de la procédure
Si l’issue de la procédure est positive, l’exécution, le suivi et la modification du plan de sauvegarde sont des étapes clés. Mais que se passe-t-il si le plan n’est pas approuvé par les classes ou si le tribunal refuse de l’arrêter ? Contrairement à la sauvegarde classique où des alternatives existent (consultation individuelle des créanciers), la sauvegarde accélérée est plus binaire. L’article L. 628-8 prévoit que si aucun plan n’est arrêté dans le délai de quatre mois, le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.
C’est alors un constat d’échec pour cette voie spécifique. L’entreprise se retrouve sans le bénéfice du plan espéré. Sa situation financière n’a probablement pas disparu, voire s’est aggravée. Elle devra alors envisager d’autres solutions : peut-être une nouvelle tentative de négociation, ou, plus probablement, si les conditions sont réunies, l’ouverture d’une autre procédure collective comme une sauvegarde classique (si elle n’est plus en cessation des paiements), un redressement judiciaire, ou malheureusement une liquidation judiciaire si aucun redressement n’est envisageable.
La sauvegarde accélérée représente une opportunité intéressante pour les entreprises qui ont déjà franchi des étapes importantes de négociation avec leurs créanciers en conciliation. Sa rapidité et son efficacité peuvent être déterminantes. Toutefois, sa mise en œuvre demande une préparation et une expertise juridique. Si vous pensez que cette procédure pourrait correspondre à la situation de votre entreprise, un conseil adapté est essentiel. Pour une analyse personnalisée de vos options et un accompagnement expert dans la mise en œuvre d’une sauvegarde accélérée, contactez notre cabinet.
Sources
- Code de commerce : Articles L. 611-4 et s. (Conciliation), L. 628-1 à L. 628-8 (Sauvegarde accélérée), L. 622-1 et s. (Dispositions générales applicables), L. 626-29 et s. (Plan de sauvegarde et classes de parties affectées).
- Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.
- Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive.