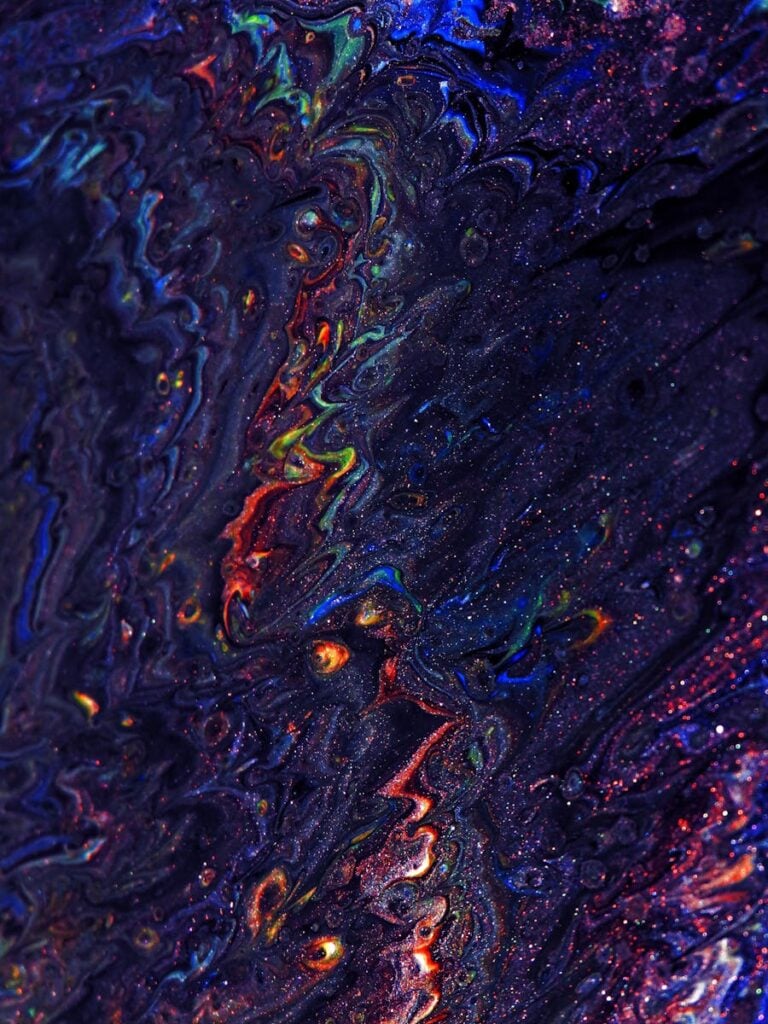Quand un litige se règle devant un tribunal, les parties peuvent choisir de s’entendre plutôt que d’attendre une décision imposée. Ce mécanisme d’accord, appelé contrat judiciaire, possède une nature hybride. Il mêle la liberté contractuelle et l’autorité judiciaire.
Mais quelle est la portée réelle de ce type d’accord? Quel pouvoir exerce le juge? Et quelle force juridique en découle pour les parties?
La dimension judiciaire du contrat judiciaire
Le contrat judiciaire tire son originalité de sa double nature. D’abord conventionnel par sa formation, il devient judiciaire par l’intervention du magistrat.
La jurisprudence a défini ce mécanisme dès le XIXe siècle. Selon la Cour de cassation, le contrat judiciaire se caractérise comme « un accord de volontés des parties dont l’existence est constatée par le juge » (Civ. 8 juill. 1925, DP 1927. 1. 21).
Cette qualification implique deux phases distinctes:
- La formation d’un contrat valide entre les parties
- L’intervention du juge qui constate cet accord
Attention: l’acte judiciaire n’est pas une condition de validité du contrat mais une condition de sa qualification comme « judiciaire ». Sans cette intervention, l’accord reste valable mais devient simplement conventionnel (Civ. 3e, 25 janv. 1983, Bull. civ. III, n° 23).
Le rôle limité du juge dans l’économie du contrat
Dans le contrat judiciaire, le juge n’exerce pas sa fonction juridictionnelle habituelle. Il ne tranche pas le litige. Son rôle se limite à constater l’accord préexistant entre les parties.
Cette limitation de l’office du juge représente la particularité essentielle du mécanisme. Comme l’a rappelé la Cour de cassation, « le juge ne peut conférer plus de droits aux parties qu’il n’en résulte de leur convention » (Civ. 1re, 13 mai 1997, n° 95-18.195, RTD civ. 1997. 744).
Le professeur Hauser qualifie cette intervention de simple « manteau judiciaire » posé sur l’accord des parties (RTD civ. 2008. 662). Le juge ne contrôle pas l’opportunité de la solution élaborée par les parties. Son contrôle se limite généralement à:
- La conformité à l’ordre public
- L’absence de fraude manifeste
Exemple pratique: si deux plaideurs s’accordent sur le montant d’une indemnité, le juge se contente de constater cet accord sans évaluer si la somme est adéquate.
L’autorité du contrat judiciaire
L’autorité du contrat judiciaire constitue son principal intérêt pratique. Elle repose sur deux fondements distincts.
D’une part, le contrat judiciaire tire sa force de l’autorité de la chose convenue. L’article 1103 du Code civil s’applique pleinement: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
D’autre part, l’intervention du juge confère au contrat une authenticité particulière. La décision qui constate l’accord des parties lui donne force exécutoire, transformant l’accord en titre permettant l’exécution forcée.
Cette intervention judiciaire produit d’importants effets:
- Elle authentifie l’accord des parties
- Elle lui confère date certaine
- Elle permet le recours aux voies d’exécution forcée
La Cour de cassation a clarifié cette dualité en précisant que « le contrat judiciaire s’impose aux parties sur le fondement de la force obligatoire du contrat et non pas dans l’autorité de la chose jugée » (Req. 21 mars 1877, DP 1878. 1. 211).
Comparaison avec l’autorité de chose jugée
Cette approche distingue nettement le contrat judiciaire d’une décision juridictionnelle classique.
Le contrat judiciaire ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée. Cette absence produit des conséquences pratiques majeures, notamment en matière de voies de recours.
Un jugement ordinaire peut être contesté par appel ou pourvoi en cassation. En revanche, le contrat judiciaire ne peut être remis en cause que par:
- Une action en nullité pour vice du consentement
- Une action en rescision pour lésion (dans les cas prévus par la loi)
- Une action en résolution pour inexécution
La Cour de cassation a confirmé cette position: « Le contrat judiciaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne suit pas le régime des décisions juridictionnelles » (Soc. 3 mars 1977, n° 76-11.000).
Il existe toutefois une exception notable. L’ancien article 2052 du Code civil attribuait à la transaction « l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Cette formulation critiquée par la doctrine a été modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Désormais, l’article 2052 dispose simplement que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Cette évolution législative confirme la distinction fondamentale entre autorité contractuelle et autorité juridictionnelle.
Le choix du contrat judiciaire n’est donc pas anodin. Il valorise l’autonomie des parties mais modifie profondément le régime des recours disponibles.
Vous devez comprendre ces nuances avant d’opter pour cette solution. Un accord mal rédigé ou conclu sans pleine connaissance des enjeux peut s’avérer difficile à contester ultérieurement.
Sources
- Code civil, articles 1103 et 2052 (version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)
- Cour de cassation, Civ. 8 juillet 1925, DP 1927. 1. 21
- Cour de cassation, Civ. 3e, 25 janvier 1983, Bull. civ. III, n° 23
- Cour de cassation, Civ. 1re, 13 mai 1997, n° 95-18.195, RTD civ. 1997. 744
- Cour de cassation, Req. 21 mars 1877, DP 1878. 1. 211
- Cour de cassation, Soc. 3 mars 1977, n° 76-11.000
- HAUSER J., « Des conventions dans le divorce et du contrat judiciaire », RTD civ. 2008. 662
- DEHARO G., « Contrat judiciaire », Répertoire de procédure civile, 2017, Dalloz