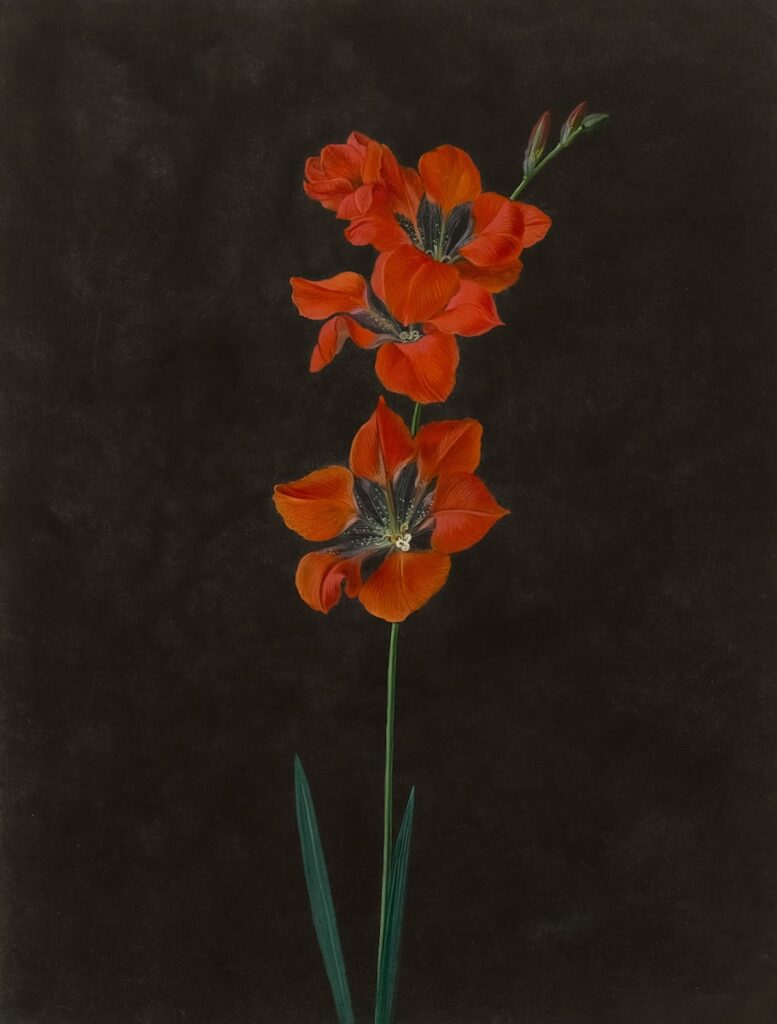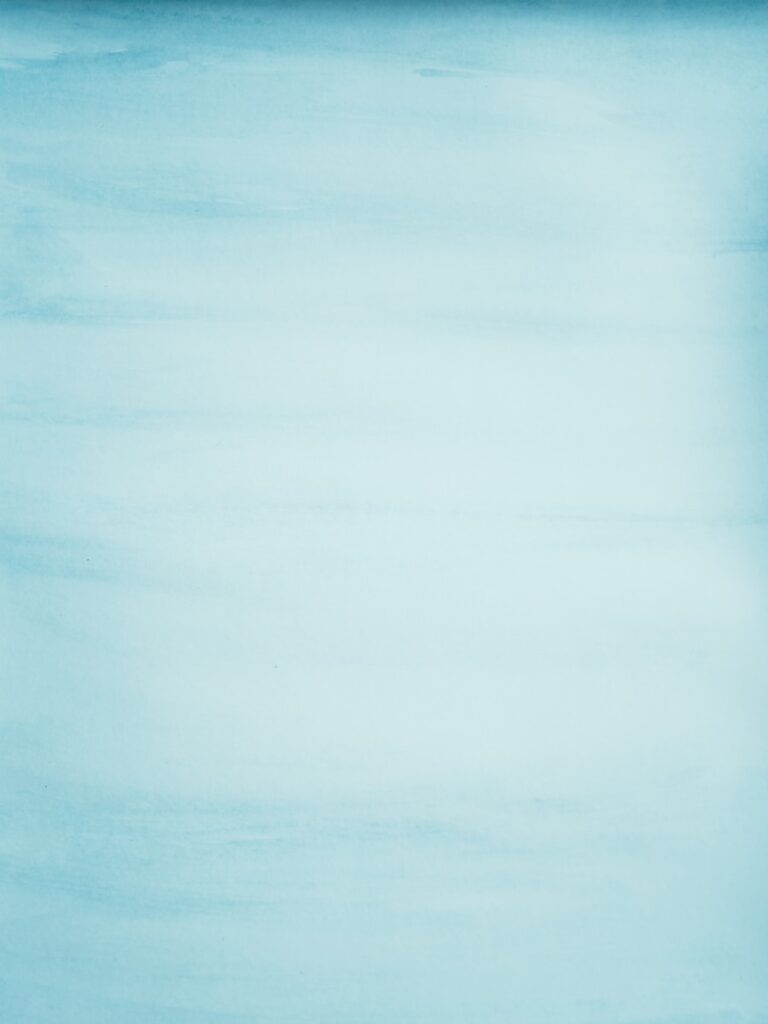Vous pensez que votre affaire progresse normalement devant le tribunal… et soudain, l’adversaire invoque la péremption d’instance. Cette sanction procédurale radicale éteint l’instance en cours pour cause d’inactivité prolongée. Comment savoir si votre procédure risque d’être touchée par cette sanction qui peut anéantir deux années d’attente?
Le trio fatal à la survie de votre procédure
La péremption d’instance repose sur trois piliers. L’article 386 du code de procédure civile (CPC) pose cette règle simple mais redoutable : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Ces trois conditions sont cumulatives :
- L’existence d’une instance
- L’absence de diligences des parties
- L’écoulement d’un délai de deux ans
Examinons-les en détail.
L’existence d’une instance : le champ d’application
Une instance, pas plus, pas moins
La péremption frappe uniquement les procédures constituant une instance. Selon la jurisprudence, une instance est « une suite d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement ».
Certaines procédures échappent à cette qualification :
- La saisie immobilière, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 mars 2005)
- Les procédures collectives dans leur ensemble (Com. 10 janv. 2006)
En revanche, la procédure s’applique devant toutes les juridictions civiles, y compris :
- Le juge de l’exécution
- Les juridictions d’appel
- La Cour de cassation (articles 1009-2 et 1009-3 du CPC)
Elle frappe même les instances mettant en cause l’ordre public, comme l’a confirmé la Cour de cassation (Com. 21 nov. 1995).
Les exceptions : quand la péremption ne s’applique pas
La péremption ne s’applique pas quand la procédure échappe à la maîtrise des parties :
- Dans les contestations d’honoraires (Civ. 2e, 16 oct. 2003)
- En matière de vérification des créances en procédure collective (Com. 19 mars 2002)
- Dans l’instance arbitrale encadrée par des délais conventionnels
- Après un jugement mixte lorsque les chefs définitifs et avant dire droit sont indivisibles
L’absence de diligences : la preuve de l’inactivité
Quand les parties doivent agir (ou non)
La péremption ne peut être constatée que si les parties étaient tenues d’accomplir des diligences. La jurisprudence identifie des périodes où aucune diligence n’est attendue :
- Après la fixation de l’audience de plaidoiries (Civ. 2e, 16 déc. 2016)
- Après la clôture des débats
- Entre un jugement d’incompétence et l’invitation du greffe à poursuivre l’instance (Civ. 2e, 15 janv. 2009)
Attention : la jurisprudence a longtemps considéré qu’en l’absence de fixation d’audience, les parties devaient demander cette fixation pour éviter la péremption.
La caractérisation des diligences interruptives
Toute activité procédurale n’est pas une diligence au sens de l’article 386 du CPC. Pour être qualifié de diligence, un acte doit :
- Émaner d’une partie (ou de son représentant)
- Être de nature à faire progresser l’instance vers sa solution
La Cour de cassation contrôle rigoureusement cette qualification. Ne constituent pas des diligences :
- Un changement d’avocat
- Des pourparlers transactionnels
- Une demande de jonction d’instances
- Des lettres échangées entre avocats sans suite procédurale
En revanche, sont considérés comme des diligences :
- Une constitution d’avocat (Civ. 2e, 22 févr. 2007)
- Une assignation en reprise d’instance
- Une demande de fixation d’audience
- Des conclusions apportant des éléments nouveaux
Dans le cadre d’une expertise, la situation est nuancée :
- Le dépôt du rapport par l’expert n’est pas une diligence
- En revanche, une correspondance adressée au juge pour hâter l’expertise l’est (Civ. 2e, 26 févr. 1992)
L’écoulement du délai de deux ans : les règles de computation
Le point de départ du délai
Le délai de péremption commence à courir dès l’introduction de l’instance. En pratique :
- En cas d’assignation, c’est la date de l’assignation
- Après chaque diligence, un nouveau délai de deux ans court
Dans certains cas particuliers :
- Après cassation : le délai court à compter de l’arrêt de cassation (Civ. 2e, 6 mars 1991)
- En cas de radiation pour inexécution : depuis la notification de la décision ordonnant la radiation (art. 524 al. 7 du CPC)
Les causes d’interruption du délai
Le délai de péremption peut être interrompu par :
- L’accomplissement d’une diligence
- L’interruption de l’instance (décès d’une partie, cessation de fonction de l’avocat…)
- Le sursis à statuer (art. 392 al. 2 du CPC)
- La demande d’aide juridictionnelle (Civ. 2e, 19 nov. 2009)
Un point essentiel : la radiation pour défaut de diligence et le retrait du rôle n’interrompent pas le délai. Le délai continue à courir pendant une mesure d’instruction, sauf si le juge prononce un sursis à statuer.
Le revirement jurisprudentiel de mars 2024 : un tournant décisif
La Cour de cassation a opéré un revirement majeur par quatre arrêts du 7 mars 2024 (n° 21-19.475, 21-19.761, 21-20.719 et 21-23.230). La règle est désormais claire :
« Lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire. La direction de la procédure leur échappe alors au profit du conseiller de la mise en état. »
Cette solution est révolutionnaire. Une fois toutes les charges procédurales accomplies, la péremption ne court plus contre les parties, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Ce revirement met fin à une jurisprudence critiquée qui obligeait les parties à solliciter régulièrement une fixation d’audience, même quand le retard était imputable à l’encombrement des juridictions.
Comment éviter la péremption d’instance ?
Quelques réflexes à adopter pour éviter cette sanction :
- Tenez un calendrier rigoureux des procédures en cours
- Identifiez les phases où les diligences sont nécessaires
- N’attendez jamais l’approche du délai de deux ans pour agir
- En cas de doute, demandez une fixation d’audience ou accomplissez un acte de procédure
- Si un sursis à statuer est accordé, surveillez la survenance de l’événement attendu
La gestion des délais de péremption requiert une vigilance constante. Un cabinet d’avocats expérimenté en procédure civile saura gérer ces délais et accomplir les diligences nécessaires au moment opportun.
Votre dossier comporte-t-il des risques de péremption ? N’hésitez pas à nous consulter pour une analyse précise de votre situation procédurale. Notre cabinet vérifiera si les trois conditions de la péremption sont réunies et proposera les actes nécessaires pour préserver vos droits.
Sources
- Articles 386 à 393 du code de procédure civile
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 mars 2024, n° 21-19.475, 21-19.761, 21-20.719 et 21-23.230
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 décembre 2016, n° 15-26.083
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 janvier 2009, n° 07-22.074
- Cour de cassation, Commerce, 10 janvier 2006, n° 03-14.923
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 mars 2005, n° 03-16.312
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 février 1992, n° 90-20.244