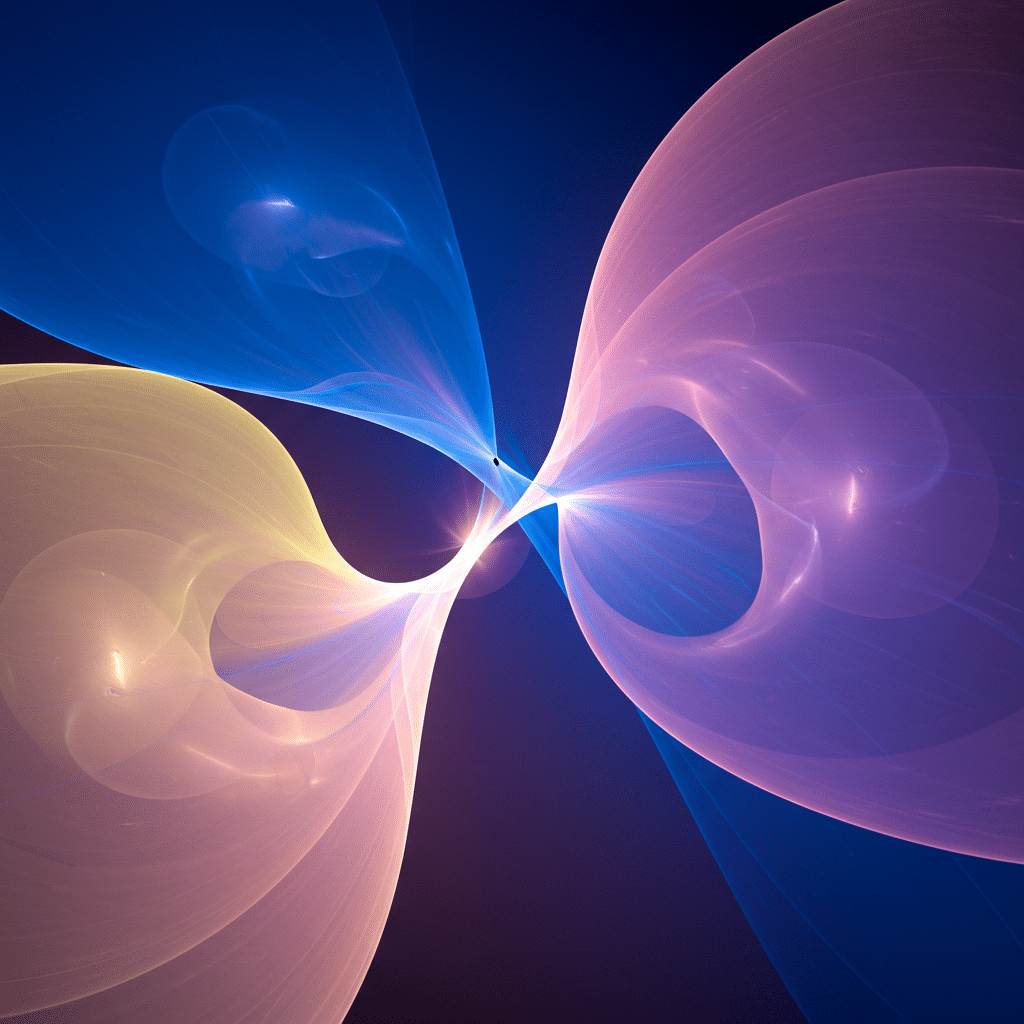Dans le monde judiciaire, l’acquiescement constitue un acte important aux conséquences juridiques significatives. Qu’il s’agisse d’acquiescer à une demande ou à un jugement, cet acte juridique unilatéral permet d’adhérer aux prétentions adverses ou de se soumettre à une décision de justice. Pour une compréhension complète de l’acquiescement et de ses principes fondamentaux, consultez notre article dédié. Toutefois, pour produire ses effets, l’acquiescement doit répondre à des conditions strictes de validité. Retour sur les exigences que la loi et la jurisprudence imposent.
Le consentement dans l’acquiescement
L’acquiescement repose essentiellement sur la volonté de son auteur. Cette volonté doit être exempt de vices.
Un consentement libre et éclairé
Pour être valable, l’acquiescement exige un consentement libre et éclairé. Le Code de procédure civile ne le précise pas expressément, mais la jurisprudence l’affirme constamment. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’acquiescement doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie concernée. Pour approfondir la reconnaissance de l’acquiescement exprès et implicite, lisez notre article.
La Deuxième chambre civile a récemment réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt du 23 mars 2023 : « si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain » (Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 21-20.289).
Cette certitude dans l’expression du consentement s’avère encore plus importante lorsque l’acquiescement est tacite. Dans ce cas, les juges recherchent si les faits invoqués traduisent sans équivoque la volonté d’acquiescer.
Les vices du consentement
Comme tout acte juridique, l’acquiescement peut être entaché de vices du consentement :
- L’erreur (de fait ou de droit) peut invalider l’acquiescement. Par exemple, un acquiescement donné par une partie qui croyait erronément que le jugement n’était pas susceptible de recours peut être annulé.
- Le dol, c’est-à-dire les manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement, emporte également nullité de l’acquiescement.
- La violence, qu’elle soit physique ou morale, annule l’acquiescement obtenu sous contrainte.
À noter que depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l’abus de l’état de dépendance (article 1143 du Code civil) constitue également un vice du consentement applicable à l’acquiescement.
La charge de la preuve du vice incombe à celui qui l’invoque. Cette preuve peut s’avérer difficile à rapporter, notamment quand la partie était assistée d’un conseil lors de l’acquiescement.
Conditions et réserves
L’acquiescement peut être assorti de conditions ou de réserves.
Les conditions suspendent l’efficacité de l’acquiescement jusqu’à la réalisation d’un événement futur et incertain. En pareil cas, l’acquiescement devient conditionnel et son caractère unilatéral se transforme. Il nécessite alors l’acceptation de la partie adverse, créant un véritable contrat judiciaire.
Les réserves, quant à elles, permettent de restreindre la portée de l’acquiescement. Par exemple, une partie peut acquiescer à certains chefs d’un jugement tout en se réservant la possibilité de contester les autres. Ces réserves doivent être suffisamment précises pour éviter toute ambiguïté.
Capacité et pouvoir d’acquiescer
L’acquiescement emportant renonciation à un droit, seules les personnes ayant la capacité de disposer du droit litigieux peuvent valablement acquiescer.
Incapacités juridiques
- Pour les majeurs sous tutelle, seul le tuteur peut acquiescer, et uniquement après autorisation du juge des tutelles (article 475 du Code civil).
- Pour les majeurs sous curatelle, l’assistance du curateur est requise (article 467 du Code civil).
- Pour les majeurs sous sauvegarde de justice, ils conservent l’exercice de leurs droits et peuvent donc acquiescer (article 435 du Code civil), sous réserve d’une éventuelle action en rescision pour lésion.
- En matière de divorce, l’article 1120 du Code de procédure civile précise que l’acquiescement au jugement prononçant le divorce est possible, sauf pour les majeurs protégés.
Mandataires et représentants légaux
- Les mandataires conventionnels doivent disposer d’un mandat spécial pour acquiescer au nom de leur mandant.
- Les mandataires ad litem (avocats notamment) bénéficient d’une présomption légale de pouvoir acquiescer au nom de leur client (article 417 du Code de procédure civile). Cette présomption est irréfragable à l’égard du juge et de la partie adverse.
- L’administrateur légal des biens d’un mineur ne peut acquiescer qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Cas des administrations publiques
Les administrations publiques peuvent acquiescer par l’intermédiaire de leur représentant légal. Cependant, des règles spécifiques peuvent s’appliquer selon le type d’administration concernée.
Cas particuliers et jurisprudence récente
- Le paiement des dépens et des frais : jusqu’en 1994, le paiement sans réserve des dépens valait acquiescement au jugement. Depuis deux arrêts du 23 novembre 1994, la Cour de cassation a opéré un revirement : les articles 410 et 558 du Code de procédure civile ne sont plus applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées au titre de l’article 700.
- La participation à une mesure d’instruction : la jurisprudence a également évolué. Désormais, la seule participation à une mesure d’instruction ordonnée par un jugement ne vaut pas acquiescement (Civ. 2e, 22 mai 1995, n° 93-11.413).
- L’exécution d’un jugement exécutoire : elle ne peut constituer un acquiescement, puisque la partie y est contrainte. Pour une analyse plus approfondie des situations où l’exécution volontaire peut valoir acquiescement, consultez notre article sur l’acquiescement légal et volontaire. Avec la généralisation de l’exécution provisoire de droit depuis la réforme de 2019, les cas d’acquiescement par exécution volontaire se réduisent considérablement.
- L’exécution partielle d’un jugement : elle n’entraîne acquiescement que pour les chefs exécutés, si ceux-ci sont distincts et indépendants des autres.
À titre d’exemple récent, dans un arrêt du 11 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « le paiement effectué par le notaire, en l’absence de contestation judiciaire formée par le copropriétaire vendeur, en conséquence de l’opposition faite par le syndicat des copropriétaires, ne peut caractériser un acquiescement, cette opposition n’étant ni une demande en justice ni un jugement » (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 23-11.700).
Conseils pratiques pour sécuriser l’acquiescement
La validité d’un acquiescement peut s’avérer délicate à établir, notamment en cas d’acquiescement tacite. Pour comprendre les effets et les conséquences pratiques de l’acquiescement, lisez notre article dédié. Pour cette raison, il est recommandé de :
- Formaliser tout acquiescement par écrit, de préférence par acte authentique ou par déclaration au greffe
- Préciser clairement l’étendue de l’acquiescement, surtout en présence de multiples chefs de demande
- Formuler des réserves expresses si l’acquiescement ne porte que sur certains points du litige
- Vérifier la capacité juridique des parties pour éviter toute contestation ultérieure
Ces précautions simples peuvent prévenir de nombreux contentieux. Pour une assistance juridique personnalisée en matière de procédure civile, un avocat spécialisé saura vous guider dans la rédaction d’un acte d’acquiescement ou dans l’analyse d’un acquiescement qui vous serait opposé.
Vous hésitez sur la validité d’un acquiescement ou souhaitez en donner un en toute sécurité juridique ? Notre cabinet se tient à votre disposition pour examiner votre situation et vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter. Contactez-nous pour un premier rendez-vous d’évaluation de votre dossier.
Sources
- Code de procédure civile, articles 408 à 410, 417
- Code civil, articles 435, 467, 475, 1143
- Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 21-20.289
- Civ. 2e, 22 mai 1995, n° 93-11.413 (participation à une mesure d’instruction)
- Civ. 2e, 23 novembre 1994, n° 92-18.354 et 92-21.071 (paiement des dépens)
- Civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 23-11.700
- Yves STRICKLER, Répertoire de procédure civile, « Acquiescement », Dalloz, avril 2021