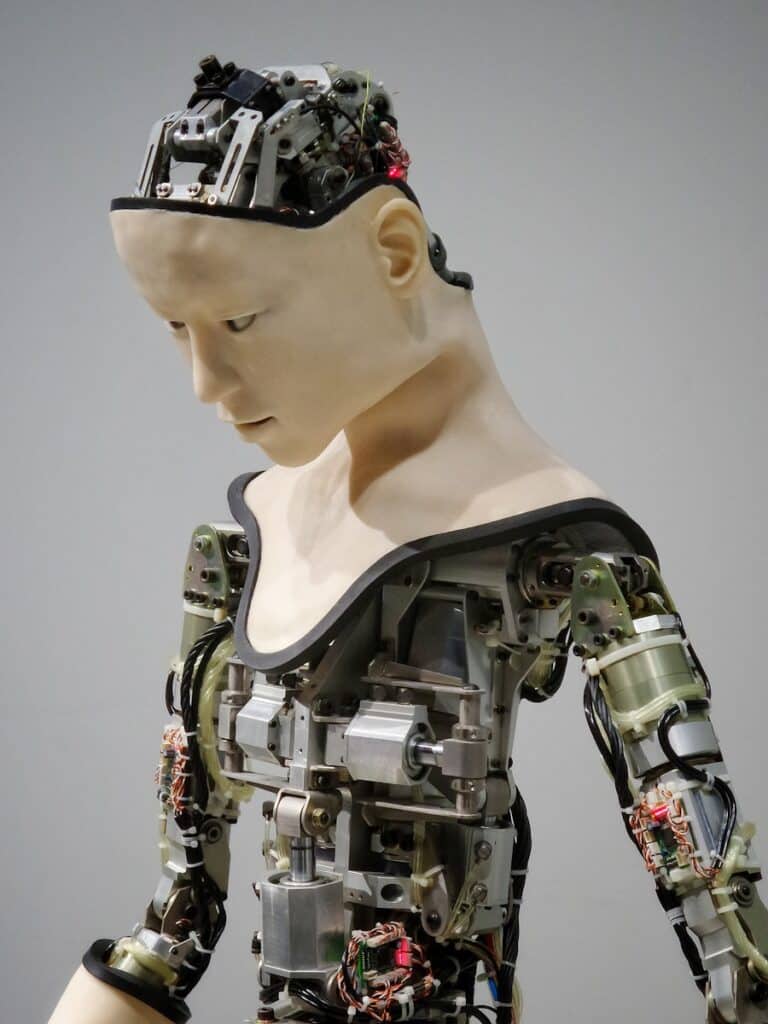Un procès qui s’éternise, des parties qui oublient de le faire avancer, et soudain, la sanction tombe : la péremption d’instance. Ce mécanisme, prévu par le Code de procédure civile (CPC), met fin à une procédure laissée à l’abandon pendant deux ans. Loin d’être une simple formalité, la péremption entraîne des effets redoutables : anéantissement des actes, perte de droits, et prise en charge de l’intégralité des frais. Comprendre son fonctionnement, et surtout la notion de diligence interruptive qui permet de l’éviter, est une nécessité pour tout justiciable souhaitant préserver ses droits.
Le concept clé : définition et nature des diligences interruptives de péremption
Au cœur du mécanisme de la péremption se trouve la notion de diligence interruptive. C’est l’acte par lequel une partie manifeste sa volonté de poursuivre la procédure et de la faire progresser vers son dénouement. Sans diligences interruptives régulières, le délai de deux ans court inexorablement, menant à l’extinction de l’instance. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a considérablement fait évoluer l’appréciation de cette notion, déplaçant le focus de l’action du juge vers la responsabilité de chaque partie.
Qu’est-ce qu’une diligence au sens de l’article 386 du Code de procédure civile ?
Une diligence, au sens de l’article 386 du Code de procédure civile (CPC), est tout acte qui fait avancer la procédure de manière significative. Elle matérialise l’impulsion processuelle que les parties doivent donner à l’instance pour éviter la sanction de leur inertie. Il ne s’agit pas de n’importe quelle démarche. Une diligence doit être utile et de nature à faire progresser le litige. Le dépôt de conclusions, la communication de nouvelles pièces, une demande de fixation d’audience ou encore une sollicitation d’expertise sont autant d’exemples de diligences interruptives qui font courir un nouveau délai de deux ans.
Le revirement de 2024 : la fin des diligences utiles et la nouvelle appréciation du juge
La jurisprudence a longtemps débattu de la nature de la diligence « utile ». Fallait-il une diligence qui fasse matériellement progresser l’affaire, ou la simple manifestation de la volonté des parties suffisait-elle ? Par plusieurs arrêts (Cass. 2e civ., 7 mars 2024), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié sa position en affirmant que lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment l’échange de leurs conclusions et pièces, le délai de péremption cesse de courir contre elles. Autrement dit, si le dossier est en état d’être jugé, notamment après une ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état, et que la balle est dans le camp de la juridiction (pour fixer une date de plaidoirie par exemple), l’inaction du tribunal ne peut plus être reprochée aux justiciables. Cette nouvelle définition apportée par la haute juridiction protège les parties diligentes contre les lenteurs de l’appareil judiciaire.
Une simple initiative peut-elle interrompre le délai ?
La question se pose de savoir si une démarche informelle, comme une simple lettre de l’avocat au greffe pour demander l’état d’avancement du dossier, peut constituer une diligence interruptive. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à considérer qu’un tel acte, pour être qualifié de diligence interruptive, doit manifester une volonté non équivoque de faire progresser l’affaire. Une simple lettre de relance pourrait être jugée insuffisante si elle n’appelle pas à un acte de procédure concret visant à faire avancer une prétention. Cependant, une lettre demandant formellement la fixation de l’affaire pour plaider a plus de chances d’être reconnue comme une diligence interruptive valable, car elle exprime clairement l’intention de mettre un terme à l’instance. La prudence commande toutefois de privilégier les actes de procédure formels (voir même une demande de fixation présentée par voie électronique) pour éviter toute incertitude.
L’extinction de l’instance et ses conséquences directes
L’effet le plus direct et le plus brutal de la péremption est l’extinction de l’instance. Selon l’article 389 du CPC, tous les actes de la procédure sont rétroactivement anéantis. L’assignation, les conclusions, les expertises ordonnées : tout disparaît comme si le procès n’avait jamais eu lieu. La conséquence la plus grave de cet anéantissement est la perte de l’effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice initiale, comme le prévoit l’art. 2243 du Code civil. L’action en justice elle-même survit en théorie à la péremption de l’instance. Cependant, si le délai de prescription du droit d’agir est écoulé au moment où la péremption est constatée, le justiciable perd définitivement son droit. Il ne pourra plus introduire une nouvelle instance, et un éventuel pourvoi en cassation contre la décision constatant la péremption serait voué à l’échec sur ce point. Cette interaction entre péremption et prescription constitue un véritable danger, notamment dans le contexte des procédures collectives où les délais sont cruciaux.
Le sort des décisions de justice et la charge des frais de procédure
La péremption anéantit les décisions qui ne sont pas encore définitives. Ainsi, une ordonnance du juge de la mise en état qui aurait accordé une provision, même assortie de l’exécution provisoire, devra être remise en cause, et les sommes versées devront être restituées. La situation est plus nuancée pour les jugements dits « mixtes », qui tranchent une partie du fond et ordonnent une mesure d’instruction pour le reste. Si les points jugés sont indivisibles de ceux qui restent à trancher, la péremption ne peut être acquise. Dans le cas contraire, l’instance peut se périmer uniquement pour les chefs de demande non encore jugés. Quant aux frais, la règle est implacable. L’art. 393 du CPC met à la charge du demandeur initial tous les frais de l’instance périmée, qu’il s’agisse des dépens ou des frais irrépétibles. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modération et ne peut répartir cette charge, même si l’inertie est partagée par l’autre partie.
Péremption et incidents d’instance : les interactions à maîtriser
La vie d’un procès est souvent rythmée par des incidents qui peuvent affecter le cours du délai de péremption. Il est essentiel de distinguer l’interruption de la suspension. L’interruption, provoquée par une diligence interruptive, fait courir un nouveau délai de deux ans. La suspension, elle, arrête temporairement le décompte du temps sans effacer le délai déjà écoulé. Un sursis à statuer, par exemple, suspend le délai de péremption, qui recommencera à courir pour le temps restant une fois la cause de la suspension disparue. À l’inverse, il faut savoir que la radiation administrative de l’affaire du rôle, qui sanctionne un défaut de diligence des parties, n’interrompt ni ne suspend le délai de péremption. Elle constitue un piège pour le plaideur non averti, qui pourrait croire à tort que le temps est arrêté. De même, il ne faut pas confondre la péremption avec la caducité, qui sanctionne l’inaccomplissement d’une formalité dans un délai précis (comme la caducité de la citation faute de saisine de la juridiction), ou le désistement, qui est un abandon volontaire de l’instance.
Cas spécifiques : la péremption dans les procédures spécialisées
Si les principes de la péremption s’appliquent à de nombreuses procédures, leurs applications pratiques varient grandement dans certains contextes juridiques spécifiques. Le droit des entreprises en difficulté, le recouvrement par injonction de payer ou le droit cambiaire offrent des illustrations éclairantes de ces interactions.
En procédures collectives : une vigilance accrue pour les créanciers
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension des poursuites individuelles. Un créancier qui avait engagé une action en paiement contre son débiteur voit son instance interrompue. Attention, car cette interruption peut créer un faux sentiment de sécurité. Or, le créancier doit impérativement déclarer sa créance au passif de la procédure collective dans les délais légaux. S’il omet cette formalité essentielle, sa créance deviendra inopposable à la procédure. Pour faire reconnaître ses droits, il devra engager une action en relevé de forclusion, dont le succès est loin d’être garanti. La péremption peut également jouer un rôle : si une instance était en cours avant le jugement d’ouverture, le créancier doit veiller à la reprendre après avoir déclaré sa créance, une fois qu’il y est invité, pour éviter que la péremption ne soit acquise, ce qui serait une cause d’irrecevabilité de sa demande.
L’articulation avec la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer est un outil de recouvrement rapide, mais son articulation avec les délais de prescription et de péremption est subtile. Une erreur commune est de croire que le simple dépôt de la requête en injonction de payer constitue une diligence interruptive de la prescription de la créance. Il n’en est rien. Seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, une fois rendue par le juge, produit cet effet interruptif. Un créancier qui dépose sa requête peu avant l’expiration du délai de prescription prend donc un risque considérable : si la juridiction tarde à statuer ou rejette sa demande, sa créance pourrait être prescrite. De plus, l’ordonnance elle-même est frappée de caducité si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date, anéantissant tout effet interruptif.
Protêt et effets de commerce : conserver les recours cambiaires
En matière de droit commercial, le défaut de diligence est sanctionné par une autre forme de déchéance : la perte des recours cambiaires. Le porteur d’un effet de commerce (lettre de change, billet à ordre) impayé à l’échéance doit le faire « protester », c’est-à-dire faire constater officiellement le défaut de paiement par un acte de commissaire de justice. Ce protêt faute de paiement est une diligence particulière indispensable pour pouvoir se retourner contre les précédents signataires de l’effet (endosseurs, avaliseurs). L’absence de protêt dans les délais entraîne la déchéance du porteur, qui perd ses recours contre les garants. Bien que distincte de la péremption d’instance, cette sanction illustre le même principe fondamental : en procédure comme en droit commercial, l’inaction se paie par la perte d’un droit.
La péremption des voies de recours : une sanction aux effets renforcés
La péremption produit des effets particulièrement sévères lorsqu’elle intervient sur une voie de recours. L’article 390 du CPC dispose que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement de première instance l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que la décision initialement contestée devient définitive et exécutoire, sans qu’il soit possible de former à nouveau le recours. La sanction est donc double pour l’appelant négligent : non seulement l’instance de recours est éteinte, mais l’action elle-même est paralysée, le jugement initial étant devenu inattaquable. Cette règle s’applique même si le jugement n’avait pas été notifié.
Stratégies préventives et gestion du risque de péremption
Il n’existe pas de stratégie pour « retenir » ou faire revivre une instance une fois la péremption acquise. La seule approche viable est préventive. Pour l’avocat, le conseiller juridique ou le plaideur, la gestion du risque de péremption passe par une discipline rigoureuse. Il est impératif de tenir un échéancier précis des délais de procédure et de ne jamais laisser une affaire sans aucune diligence interruptive pendant une période approchant les deux ans. Chaque acte, même une simple demande de fixation par voie électronique, doit être documenté et conservé. Il faut comprendre que le risque est maximal dans les phases d’attente, notamment après l’échange des conclusions et avant la fixation de l’audience de plaidoirie, période où la direction de la procédure n’appartient plus aux seules parties. Une relance systématique et formalisée auprès du greffe du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) ou de la cour est la meilleure assurance contre les conséquences souvent irrémédiables de la péremption d’instance.
La péremption d’instance est une sanction sévère qui peut anéantir des années de procédure et faire perdre un droit substantiel. Si vous êtes confronté à une situation d’inertie procédurale ou si vous craignez les conséquences d’un délai qui s’allonge, il est essentiel d’agir. Pour une analyse approfondie de votre situation et un conseil adapté, prenez contact avec notre équipe.
Sources
- Code de procédure civile (CPC), articles 385 à 393
- Code civil, article 2243
- Code de commerce