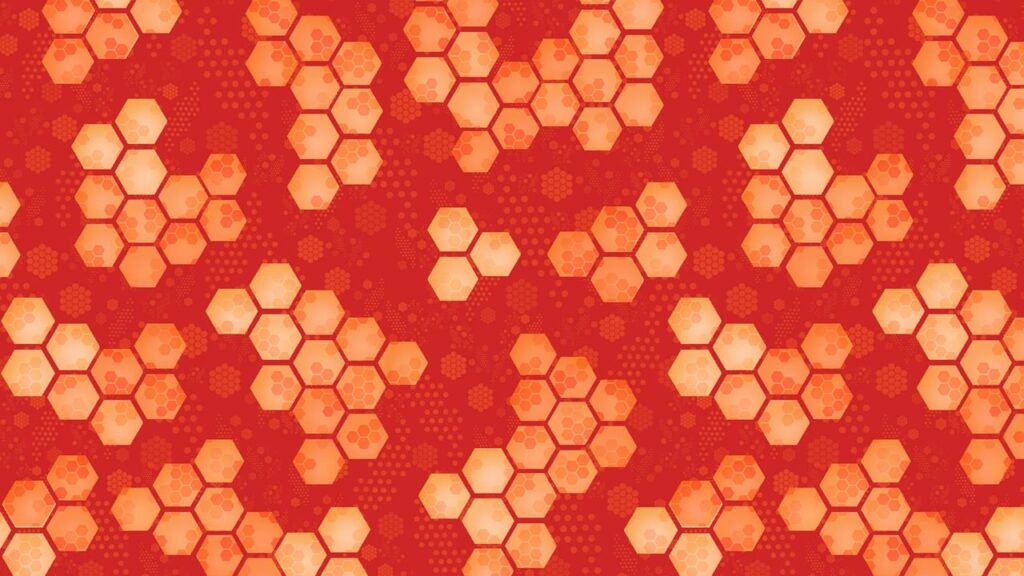L’exécution provisoire, cette dérogation au principe de l’effet suspensif des voies de recours ordinaires, permet au créancier de poursuivre l’exécution immédiate d’une décision judiciaire malgré l’exercice d’un appel ou d’une opposition. Mais quels sont ses effets concrets? Quand se déploient-ils? Comment influencent-ils les parties au litige?
Quand l’exécution provisoire déploie ses effets
L’exécution provisoire n’a d’intérêt que si la voie de recours suspensive (appel ou opposition) est effectivement exercée. À défaut, la décision passe en force de chose jugée et l’exécution devient définitive. Les effets de l’exécution provisoire jouent donc uniquement pendant l’instance d’appel ou d’opposition.
L’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire ». Concrètement, le créancier bénéficie d’un titre exécutoire immédiat, lui permettant de mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance.
Les conditions du recours à l’exécution forcée
Conditions objectives
- Le jugement doit être assorti de l’exécution provisoire (de droit ou judiciaire)
- La notification préalable du jugement au débiteur est obligatoire (article 503 du Code de procédure civile)
- Si l’exécution provisoire a été subordonnée à la constitution d’une garantie, celle-ci doit avoir été fournie
La Cour de cassation a rappelé l’importance de la notification préalable dans un arrêt du 14 septembre 2006 (Civ. 2e, n°04-20.602), en censurant des juges qui avaient condamné un mari à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance alors que l’ordonnance de non-conciliation lui attribuant le logement familial ne lui avait pas été notifiée.
Conditions subjectives
Du côté du débiteur, l’exécution volontaire reste possible mais requiert une grande prudence. L’article 410, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement. Le débiteur doit donc veiller à n’exécuter volontairement que les chefs de condamnation assortis de l’exécution provisoire.
Quant au créancier, le recours à l’exécution forcée relève de son pouvoir discrétionnaire. Il n’encourt aucune responsabilité s’il s’abstient de poursuivre l’exécution forcée (Civ. 3e, 4 juin 2008, n°07-14.118).
Avantages et limites pour le créancier
Bénéfices des règles de droit commun
- De la majoration des intérêts légaux (article L. 313-3 du Code monétaire et financier)
- De l’accès à toutes les procédures civiles d’exécution
- Du droit d’utiliser toutes les mesures conservatoires disponibles
La Cour de cassation a confirmé la compatibilité de cette exécution forcée avec les exigences du procès équitable de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Civ. 2e, 10 février 2005, n°03-15.067).
Limites spécifiques
- En matière de saisie immobilière, l’article L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée »
- Pour la radiation d’hypothèques, l’article 2440 du Code civil n’autorise la radiation d’une inscription hypothécaire qu’en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée
- L’exécution est toujours poursuivie aux risques et périls du créancier (article L. 111-10, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution)
Cette dernière limite est fondamentale. Contrairement à l’exécution définitive, l’exécution provisoire engage la responsabilité du créancier même en l’absence de faute. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’a confirmé le 24 février 2006 (n°05-12.679), en jugeant que cette responsabilité s’applique même en cas d’exécution spontanée par le débiteur après simple signification. Néanmoins, pour protéger ses intérêts, le débiteur peut, sous certaines conditions, demander l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
La radiation de l’appel faute d’exécution
L’article 524 du Code de procédure civile (ancien article 526) offre au créancier une arme redoutable: la radiation de l’appel formé par le débiteur qui n’exécute pas la décision de première instance.
Cette procédure permet au créancier de demander au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle. Pour échapper à cette radiation, le débiteur doit justifier:
- Avoir exécuté la décision
- Ou démontrer que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives
- Ou prouver qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter
La radiation n’est qu’une cause de suspension de l’instance d’appel, mais elle peut conduire à l’extinction définitive de l’instance par le jeu de la péremption (délai de deux ans).
La Cour de cassation a longtemps été divisée sur cette question, mais une décision du 18 juin 2009 (Civ. 2e, n°08-15.424) a considéré la décision de radiation comme une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Les conséquences à l’issue de l’instance
En cas de confirmation
Si le jugement est confirmé sur l’appel ou l’opposition, l’exécution définitive se substitue à l’exécution provisoire. La confirmation opère rétroactivement à la date du jugement attaqué (Civ. 2e, 13 juillet 2006, n°04-20.690).
Le créancier conserve le bénéfice de l’exécution initialement poursuivie et les garanties qu’il avait éventuellement dû fournir sont levées.
En cas d’infirmation ou de rétractation
L’article L. 111-10, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier […] rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Deux types d’obligations en découlent pour le créancier:
1. Obligation de restitution
Le créancier doit restituer au débiteur tout ce qu’il a reçu en exécution du jugement. Cette restitution s’opère sans qu’il soit nécessaire que la décision d’infirmation ou de rétractation l’ordonne expressément.
La jurisprudence considère que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions (Civ. 2e, 10 juillet 2008, n°07-16.802).
2. Obligation de réparation
Le créancier doit réparer le préjudice subi par le débiteur du seul fait de l’exécution forcée, sans qu’aucune faute ne soit exigée (Civ. 3e, 2 juillet 1974, n°73-20.046).
Cette responsabilité sans faute distingue fondamentalement l’exécution provisoire de l’exécution définitive.
La compétence pour statuer sur ces réparations appartient au juge de l’exécution en vertu de l’article L. 213-6, alinéa 4 du Code de l’organisation judiciaire.
L’exécution provisoire constitue un outil puissant mais à double tranchant. En pratique, un créancier bénéficiant d’une décision exécutoire par provision doit peser les avantages immédiats contre les risques de restitution et de réparation en cas d’infirmation.
Les enjeux financiers sont souvent considérables. Dans un dossier récent porté devant notre cabinet, un créancier ayant poursuivi l’exécution provisoire d’une condamnation de 150 000 € s’est vu condamné, après infirmation, non seulement à restituer cette somme mais aussi à verser 35 000 € de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés par le débiteur pour contracter un prêt et aux préjudices subis.
Vous vous demandez si vous devez poursuivre l’exécution forcée d’un jugement exécutoire par provision ou si au contraire vous devez contester l’exécution provisoire dont bénéficie votre adversaire? N’hésitez pas à nous contacter pour une analyse personnalisée de votre situation.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 111-10
- Code de procédure civile, articles 410, 503, 524
- Code civil, article 2440
- Code monétaire et financier, article L. 313-3
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 septembre 2006, n°04-20.602
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 juin 2008, n°07-14.118
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 février 2005, n°03-15.067
- Cour de cassation, Assemblée plénière, 24 février 2006, n°05-12.679
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2009, n°08-15.424
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 juillet 2006, n°04-20.690
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 juillet 2008, n°07-16.802
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 juillet 1974, n°73-20.046
- HOONAKKER Ph., « L’exécution provisoire de droit enfin consacrée par le législateur ! », Dalloz 2004, Chronique 2314