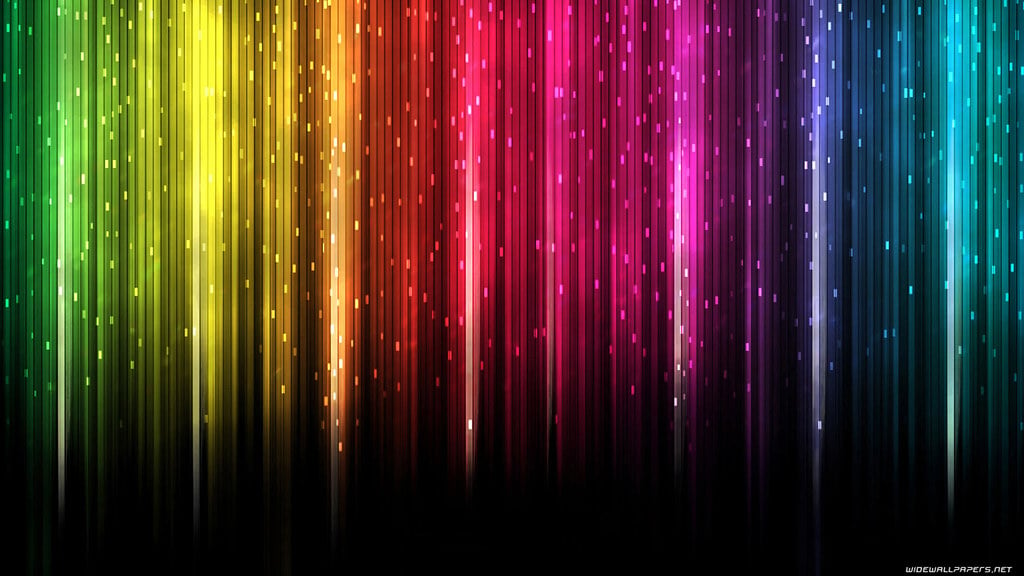Se lancer dans une procédure judiciaire, que ce soit pour faire valoir ses droits ou pour se défendre, soulève inévitablement la question des coûts. Au-delà des enjeux juridiques eux-mêmes, une préoccupation légitime et fréquente concerne la charge financière finale : qui devra supporter les frais engendrés par le procès ? Le langage juridique utilise souvent le terme de « dépens », mais cette notion, bien que centrale, ne recouvre pas l’intégralité des sommes engagées. Une autre catégorie de frais, souvent substantielle, celle des « frais irrépétibles », obéit à des règles différentes.
Cet article a pour objectif d’apporter un éclairage sur ces concepts fondamentaux. Nous allons définir ce que sont les dépens, expliquer qui, en règle générale, est amené à les payer, et surtout, clarifier la distinction essentielle entre ces dépens et les autres frais régis par le fameux article 700 du Code de procédure civile. Comprendre ces mécanismes est une première étape indispensable pour aborder sereinement une action en justice.
Les dépens : de quoi parle-t-on ?
Dans le contexte d’une procédure judiciaire, les dépens désignent un ensemble de frais spécifiques, directement liés au déroulement du procès et considérés par la loi comme nécessaires à la conduite de l’instance ou à l’exécution de la décision. On pourrait les voir comme les « frais officiels » de la procédure, ceux qui sont méticuleusement listés et dont le remboursement peut être ordonné par le juge.
Quels sont ces frais ? La liste est précisément établie par l’article 695 du Code de procédure civile (nous y reviendrons plus en détail dans un prochain article), mais elle inclut notamment :
- Les frais de signification d’actes (assignation, notification de jugement…) par un commissaire de justice (profession qui regroupe désormais les anciens huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires).
- La rémunération de l’expert judiciaire, mais uniquement si celui-ci a été désigné par le tribunal pour éclairer sa décision sur un point technique.
- Les indemnités dues aux témoins cités à comparaître (frais de transport, de séjour, éventuelle perte de salaire).
- Certains droits et taxes perçus par les greffes des tribunaux ou l’administration fiscale.
- Une part très réglementée et limitée de la rémunération de l’avocat, correspondant principalement à d’anciens actes de procédure tarifés ou à des interventions spécifiques comme dans les saisies immobilières.
- Le « droit de plaidoirie », une contribution fixe versée au régime de retraite des avocats.
Il est essentiel de comprendre que cette liste est limitative. Tout ce qui n’y figure pas n’est pas considéré comme un dépens. Par exemple, si vous décidez de consulter un expert de votre propre chef pour obtenir un avis technique avant même de saisir la justice, les honoraires de cet expert ne feront pas partie des dépens.
La règle d’or : la partie perdante paie les dépens (le principe de succombance)
La question qui brûle les lèvres est bien sûr : qui paie ces dépens à la fin ? Le Code de procédure civile, dans son article 696, pose un principe directeur, connu sous le nom de « principe de succombance ». La règle est simple en apparence : sauf si le juge en décide autrement de manière motivée, c’est la partie qui perd le procès qui est condamnée aux dépens.
Mais que signifie « succomber » ? Juridiquement, succomber, c’est échouer dans ses prétentions principales. C’est voir sa demande rejetée par le tribunal, ou être condamné à faire ou à payer ce que l’adversaire réclamait. La logique derrière cette règle est assez intuitive : la partie dont l’action ou la défense n’était pas fondée est considérée comme ayant, d’une certaine manière, provoqué les frais de la procédure. Que ce soit en engageant une action vouée à l’échec ou en résistant de manière injustifiée à une demande légitime, elle est présumée « responsable » des coûts engendrés par le litige et doit donc les assumer.
Prenons des exemples simples. Si vous poursuivez quelqu’un pour obtenir le paiement d’une facture impayée et que le juge vous donne entièrement raison, votre débiteur sera condamné à vous payer la facture et les dépens. Inversement, si vous attaquez un voisin pour une question de limite de propriété et que le tribunal juge votre demande totalement infondée, c’est vous qui supporterez les dépens de la procédure.
Il est important de noter que le juge applique généralement cette règle de la condamnation aux dépens de la partie perdante d’office, c’est-à-dire automatiquement, même si aucune des parties ne l’a expressément demandé dans ses conclusions. C’est une conséquence légale de la défaite judiciaire.
Nuances et exceptions : quand le juge peut déroger à la règle
Comme souvent en droit, le principe de la condamnation de la partie perdante aux dépens connaît des tempéraments. L’article 696 du Code de procédure civile lui-même prévoit que le juge peut, par décision motivée, mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge de l’autre partie. Cela signifie que, exceptionnellement, la partie qui a « gagné » sur le fond pourrait se voir imposer de payer tout ou partie des dépens.
Pourquoi une telle dérogation ? Le juge doit impérativement justifier sa décision. Il ne peut le faire que pour des motifs particuliers, souvent liés à l’équité ou au comportement des parties pendant le procès. Par exemple, une partie qui obtient gain de cause mais qui a inutilement compliqué la procédure, multiplié les incidents dilatoires, ou forcé l’autre partie à des démarches coûteuses et évitables, pourrait se voir sanctionnée par une condamnation partielle, voire totale, aux dépens. Imaginez le sentiment d’injustice si, bien qu’ayant raison sur le fond, votre adversaire par son attitude vous a contraint à des frais disproportionnés : le juge dispose d’une marge d’appréciation pour corriger de telles situations.
Certaines lois spécifiques prévoient également des régimes dérogatoires. Sans entrer dans des détails trop techniques, on peut citer le cas de certains divorces où la loi désigne par avance l’époux qui supportera les dépens, sauf si le juge estime devoir en décider autrement.
Enfin, il arrive que le juge ne statue pas immédiatement sur les dépens. C’est le cas notamment lorsqu’il rend une décision « avant dire droit », par exemple pour ordonner une mesure d’expertise. À ce stade, l’issue du litige n’est pas encore connue. Le juge peut alors décider de « réserver les dépens » : cela signifie qu’il reportera sa décision sur la charge finale des dépens au moment où il rendra son jugement sur le fond de l’affaire.
L’autre partie des frais : les « frais irrépétibles » de l’article 700 CPC
Abordons maintenant un aspect fondamental, souvent source de malentendus et parfois de déceptions pour les justiciables : tous les frais que vous pouvez être amené à engager dans le cadre d’un procès ne sont pas qualifiés de « dépens » et ne suivront donc pas automatiquement le sort de la partie perdante. Il existe une seconde catégorie, bien distincte : les « frais irrépétibles ».
Que signifie ce terme un peu austère ? « Irrépétible » veut simplement dire que ces frais ne sont pas, en principe, remboursables par la partie adverse au titre de la condamnation aux dépens. La raison est simple : ils ne figurent pas dans la liste limitative et précise de l’article 695 du Code de procédure civile. Ils représentent pourtant souvent une part très significative, voire la majorité, du coût total supporté par le justiciable.
Quels sont ces frais ? L’exemple le plus courant, et généralement le plus conséquent, concerne les honoraires de votre avocat. Le travail de conseil, d’analyse du dossier, de recherche juridique, de rédaction des conclusions (les arguments écrits soumis au juge), de préparation des plaidoiries, et la plaidoirie elle-même, tout cela est rémunéré par des honoraires librement convenus entre vous et votre avocat (dans le cadre d’une convention d’honoraires). Sauf cas très spécifiques liés aux quelques émoluments tarifés restants (que nous aborderons dans un prochain article), l’essentiel de cette rémunération n’entre pas dans les dépens et constitue des frais irrépétibles.
De la même manière, si vous décidez, pour renforcer votre dossier, de faire appel à un expert privé, à un consultant technique, ou de faire réaliser des constats spécifiques par un commissaire de justice sans que le juge l’ait ordonné, les coûts associés seront considérés comme des frais irrépétibles.
La conséquence directe est majeure : même si vous obtenez gain de cause et que votre adversaire est condamné aux dépens, ces frais irrépétibles restent, en principe, à votre charge. C’est une réalité parfois difficile à accepter lorsqu’on a investi du temps, de l’énergie et des ressources financières dans un litige dont on sort victorieux.
Mais alors, comment faire pour ces frais importants ? Le législateur a prévu un outil pour tenter d’en obtenir le remboursement, au moins partiel : c’est l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article permet à une partie (généralement celle qui gagne et qui n’est pas condamnée aux dépens) de demander au juge de condamner l’autre partie à lui verser une somme forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie de ces frais irrépétibles.
Le juge dispose ici d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’est pas obligé d’accorder l’intégralité des sommes demandées au titre de l’article 700. Il va statuer en tenant compte de l’équité (le caractère juste ou injuste de laisser ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie) et de la situation économique de la partie qui serait condamnée à payer. Le juge peut donc allouer une somme inférieure aux frais réellement exposés, voire refuser toute indemnisation au titre de l’article 700.
Bien distinguer les dépens (listés à l’article 695, payés par le perdant sauf exception) des frais irrépétibles (majorité des frais, notamment honoraires d’avocat, remboursables partiellement et sur décision du juge via l’article 700) est donc absolument essentiel pour toute personne envisageant ou subissant une procédure judiciaire. Cela permet d’avoir une vision plus réaliste des enjeux financiers et des sommes qu’il est possible d’espérer récupérer à l’issue du procès.
Pour une analyse personnalisée des frais potentiels liés à votre situation et des possibilités de recouvrement, notre équipe se tient à votre disposition.
Sources
- Code de procédure civile : Articles 695, 696, 700.