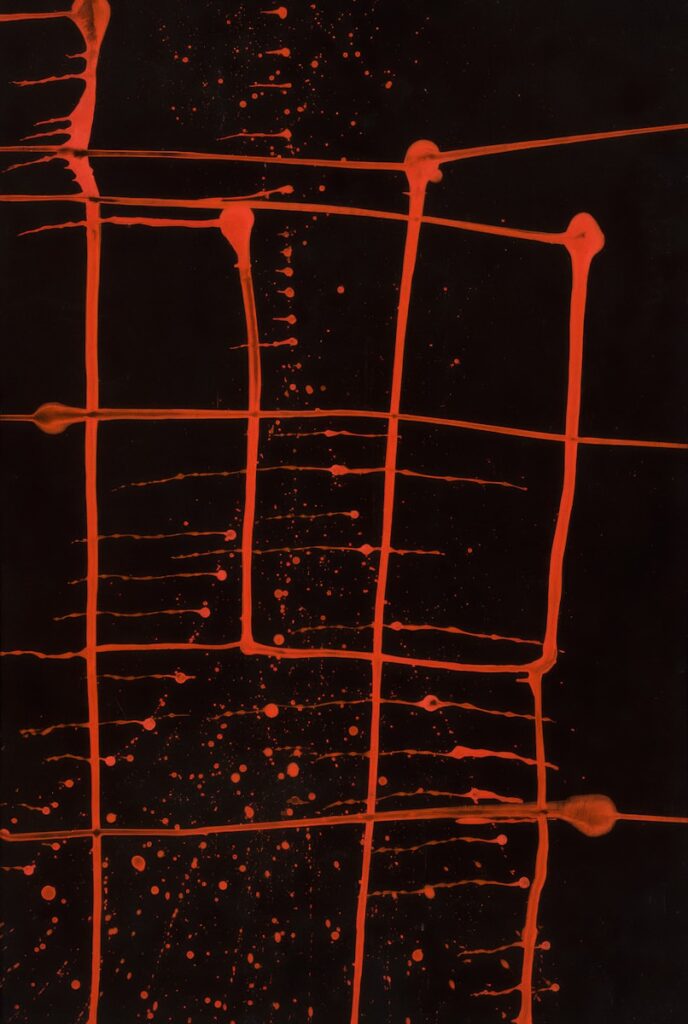Depuis la crise financière de 2007-2008 et la crise des dettes souveraines qui a suivi, l’Union européenne a entrepris une réforme profonde de la supervision bancaire. La création de l’Union bancaire, et en son sein du Mécanisme de Surveillance Unique (MSU), a marqué un tournant majeur. Ce mécanisme confie à la Banque Centrale Européenne (BCE) un rôle central dans la surveillance des établissements de crédit des États membres participants. Comprendre les missions et les pouvoirs étendus dévolus à la BCE dans ce cadre est essentiel pour les acteurs du secteur bancaire et leurs partenaires. Cet article détaille les compétences clés de la BCE au sein du MSU, éclairant ainsi le fonctionnement de cette architecture de surveillance renforcée à l’échelle européenne. Pour une vue d’ensemble, vous pouvez consulter notre article sur le fonctionnement global du MSU.
Les missions fondamentales confiées à la BCE par le MSU
Le règlement MSU (Règlement (UE) n° 1024/2013) constitue la pierre angulaire des compétences de la BCE en matière de surveillance prudentielle. Il lui attribue des missions spécifiques, visant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier de l’Union. Ces missions couvrent des aspects essentiels de la vie d’un établissement bancaire, de sa création à son fonctionnement quotidien, en passant par les opérations structurantes qu’il peut entreprendre.
Octroi et retrait des agréments bancaires : une compétence partagée
L’une des missions les plus fondamentales confiées à la BCE est sa compétence exclusive pour l’octroi et le retrait des agréments bancaires pour tous les établissements de crédit (qu’ils soient importants ou moins importants) situés dans les États membres participants. Cela signifie que toute entité souhaitant exercer l’activité d’établissement de crédit, définie comme la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public et l’octroi de crédits pour son propre compte, doit obtenir l’aval de la BCE.
La procédure d’octroi d’agrément, bien que relevant de la compétence finale de la BCE, implique une collaboration étroite avec les autorités compétentes nationales (ACN). La demande est initialement déposée auprès de l’ACN de l’État membre où l’établissement souhaite s’établir, conformément au droit national. L’ACN réalise une première évaluation pour vérifier si les conditions nationales et européennes (notamment issues de la directive CRD IV/V et du règlement CRR/CRR II) sont remplies. Si l’évaluation est positive, l’ACN transmet un projet de décision d’octroi d’agrément à la BCE.
La BCE procède alors à sa propre évaluation. Elle dispose d’un délai défini (généralement 10 jours ouvrables après notification du projet par l’ACN, potentiellement prolongeable) pour examiner le projet et éventuellement soulever des objections. Si la BCE estime que les conditions ne sont pas réunies, elle peut s’opposer à l’octroi de l’agrément, après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter ses observations. En l’absence d’objection dans le délai imparti, l’agrément est réputé accordé (principe de non-objection). C’est l’ACN qui notifie la décision finale (octroi ou refus) au demandeur.
De manière symétrique, la BCE détient la compétence exclusive pour retirer un agrément, que ce soit de sa propre initiative ou sur proposition de l’ACN. Les motifs de retrait sont encadrés par le droit de l’Union (notamment l’article 18 de la directive CRD IV) et le droit national applicable. Ils incluent le non-usage de l’agrément, la renonciation expresse, la cessation d’activité, l’obtention de l’agrément par des moyens irréguliers, ou encore le non-respect continu des conditions d’agrément ou des exigences prudentielles. La procédure de retrait implique également une consultation de l’ACN et, le cas échéant, de l’autorité de résolution, tout en garantissant le droit de l’établissement concerné d’être entendu.
Procédure d’évaluation des acquisitions et augmentations de participations qualifiées
La BCE est également seule compétente pour évaluer les projets d’acquisition ou d’augmentation de « participations qualifiées » dans des établissements de crédit relevant du MSU. Une participation qualifiée est définie comme la détention, directe ou indirecte, d’au moins 10% du capital ou des droits de vote d’un établissement, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur sa gestion. La procédure s’applique aussi aux franchissements des seuils de 20%, 30% (ou un tiers selon les droits nationaux, comme en France ) et 50%, ainsi qu’aux opérations rendant l’établissement cible une filiale de l’acquéreur.
Comme pour les agréments, la procédure implique l’autorité compétente nationale (ACN) de l’établissement cible. Le candidat acquéreur doit notifier son projet à l’ACN concernée. Celle-ci procède à une évaluation initiale au regard des critères fixés par la directive CRD IV (article 23). Ces critères visent à garantir une gestion saine et prudente de l’établissement cible et incluent l’honorabilité et la solidité financière du candidat acquéreur, la compétence de la future direction, la capacité de l’établissement à continuer de respecter les exigences prudentielles, et l’absence de soupçons liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
L’ACN transmet ensuite à la BCE une proposition de décision (opposition ou non-opposition) au moins 15 jours ouvrables avant la fin de la période d’évaluation globale, qui est de 60 jours ouvrables maximum à compter de la réception d’un dossier complet. Ce délai peut être suspendu une fois pour une demande d’informations complémentaires (suspension limitée à 20 ou 30 jours ouvrables selon le cas). La BCE prend la décision finale. Si la BCE ne s’oppose pas dans le délai imparti (en pratique, dans les 15 jours ouvrables restants après réception de la proposition de l’ACN), le projet est réputé approuvé. En cas d’opposition motivée de la BCE, le candidat acquéreur est informé et peut exercer des voies de recours. L’intervention de la BCE vise à assurer une évaluation harmonisée et à réduire le risque de décisions biaisées par des considérations nationales.
Le contrôle du respect des exigences prudentielles (fonds propres, liquidité, gouvernance)
Au-delà des étapes clés que sont l’agrément et les prises de participation, la mission principale de la BCE concerne la surveillance prudentielle continue des établissements de crédit, en particulier ceux qualifiés d’ »importants ». La BCE veille à ce que ces établissements respectent à tout moment les exigences définies par le droit de l’Union, notamment le paquet législatif CRR/CRD IV (et ses modifications CRR II/CRD V) ainsi que les transpositions nationales.
Cela recouvre plusieurs domaines essentiels:
- Exigences de fonds propres (Pilier 1 et Pilier 2) : La BCE contrôle le respect des ratios minimaux de fonds propres (CET1, Tier 1, Total Capital) définis par le règlement CRR. Elle évalue également la nécessité d’imposer des exigences de fonds propres supplémentaires (exigences dites de « Pilier 2 » ou P2R) pour couvrir des risques spécifiques à l’établissement qui seraient sous-estimés ou non couverts par le Pilier 1. Elle peut aussi formuler des recommandations de fonds propres additionnels (P2G). La BCE approuve également l’utilisation de modèles internes par les banques pour calculer leurs exigences de fonds propres pour les risques de crédit, de marché ou opérationnel.
- Gestion des risques : La BCE s’assure que les établissements disposent de processus et systèmes adéquats pour identifier, mesurer, gérer et surveiller l’ensemble des risques auxquels ils sont exposés : risque de crédit, de marché, opérationnel, de liquidité, de taux d’intérêt, de concentration, etc..
- Liquidité : Le contrôle porte sur le respect des ratios de liquidité (comme le Liquidity Coverage Ratio – LCR et le Net Stable Funding Ratio – NSFR) et sur la capacité de la banque à faire face à ses obligations à court et long terme. La BCE peut imposer des exigences spécifiques de liquidité.
- Grands risques : La BCE surveille l’exposition des banques à des contreparties uniques ou à des groupes de clients liés, afin d’éviter une concentration excessive des risques. Elle peut fixer des limites plus strictes que celles prévues par la réglementation.
- Gouvernance et contrôle interne : La BCE examine la solidité des dispositifs de gouvernance, l’adéquation des structures organisationnelles, l’efficacité des systèmes de contrôle interne, et le respect des exigences relatives à la composition et à l’aptitude (honorabilité, compétence, expérience, disponibilité) des organes de direction. Elle surveille également les politiques de rémunération.
- Transparence et publication d’informations : La BCE contrôle la qualité et la fiabilité des informations prudentielles que les banques doivent déclarer aux autorités (reporting) et publier à destination du marché (Pilier 3).
Pour mener à bien cette mission de contrôle, la BCE s’appuie sur un ensemble d’outils et de prérogatives, incluant l’analyse des données déclarées par les banques, le dialogue continu avec leurs dirigeants, et des contrôles plus approfondis comme le SREP, les inspections sur place et les tests de résistance.
La surveillance prudentielle directe des établissements importants
Si la BCE est compétente pour les agréments et les participations qualifiées de tous les établissements des États participants, sa surveillance prudentielle directe au quotidien se concentre sur les établissements de crédit jugés « importants » (Significant Institutions – SI). Les établissements « moins importants » (Less Significant Institutions – LSI) restent sous la surveillance directe de leur autorité compétente nationale (ACN), bien que la BCE exerce une surveillance indirecte et puisse décider à tout moment d’assurer elle-même la surveillance directe d’une LSI si nécessaire. Les critères définissant l’importance d’un établissement sont liés à sa taille (total d’actifs supérieur à 30 milliards d’euros), son importance économique pour le pays ou l’UE (ratio actifs/PIB supérieur à 20%, sauf si actifs < 5 Mds €), l’ampleur de ses activités transfrontalières, ou le fait qu’il ait reçu une aide financière publique directe via le MES ou le FESF. Les trois plus grands établissements de chaque État membre participant sont également considérés comme importants par défaut. Cette surveillance directe s’articule autour de processus clés.
Le processus d’examen et d’évaluation prudentiels (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process)
Le SREP est au cœur de la surveillance prudentielle exercée par la BCE sur les établissements importants. Il s’agit d’une évaluation annuelle complète de chaque banque, visant à apprécier de manière cohérente et prospective son profil de risque global et la viabilité de son modèle d’activité. Le SREP permet à la BCE de déterminer si une banque respecte l’ensemble des exigences prudentielles et de décider, le cas échéant, des mesures de surveillance à prendre.
L’évaluation SREP s’articule généralement autour de quatre éléments principaux :
- Analyse du modèle d’activité (Business Model Analysis) : Examen de la viabilité et de la durabilité de la stratégie commerciale et des sources de revenus de la banque.
- Évaluation de la gouvernance interne et de la gestion des risques : Analyse de la qualité de l’organe de direction, de la culture du risque, de l’efficacité du cadre de contrôle interne et des processus de gestion des risques.
- Évaluation des risques pesant sur le capital : Analyse quantitative et qualitative des risques susceptibles d’impacter les fonds propres de la banque (risque de crédit, de marché, opérationnel, de taux d’intérêt du portefeuille bancaire).
- Évaluation des risques pesant sur la liquidité et le financement : Analyse de la capacité de la banque à faire face à ses besoins de liquidité à court terme (risque de liquidité) et à maintenir une structure de financement stable à long terme (risque de financement).
Sur la base de cette évaluation globale, la BCE attribue à chaque banque un score SREP (allant de 1 à 4, 1 étant le meilleur score) reflétant son profil de risque et le niveau de préoccupation prudentielle. Cette évaluation débouche sur une décision SREP annuelle pour chaque banque importante. Cette décision peut inclure :
- Des exigences de fonds propres de Pilier 2 (P2R), juridiquement contraignantes, venant s’ajouter aux exigences minimales de Pilier 1.
- Des recommandations de fonds propres de Pilier 2 (P2G), non contraignantes, indiquant le niveau de fonds propres que la BCE attend de la banque pour faire face à des scénarios de crise potentiels (souvent basées sur les résultats des stress tests).
- Des exigences spécifiques de liquidité.
- D’autres mesures qualitatives visant à corriger les faiblesses identifiées dans la gouvernance, la gestion des risques ou le modèle d’activité.
Le SREP est un processus dynamique, mené par les équipes de surveillance conjointes (Joint Supervisory Teams – JST), qui combine analyse quantitative des données et jugement qualitatif des superviseurs.
L’organisation et la conduite des inspections sur place
Les inspections sur place constituent un outil de surveillance intrusif et essentiel pour la BCE. Elles permettent d’examiner en profondeur des aspects spécifiques du fonctionnement, des risques ou des contrôles d’une banque, directement dans ses locaux. Contrairement à la surveillance continue « sur pièces » (basée sur l’analyse de données et de documents), les inspections offrent une vision directe et permettent des investigations détaillées. Elles peuvent être déclenchées dans le cadre du programme de surveillance annuel (inspections planifiées) ou en réponse à des événements spécifiques nécessitant une analyse rapide (inspections ad hoc).
La BCE peut mener des inspections sur place auprès de toutes les entités soumises à sa surveillance (établissements de crédit importants et moins importants, compagnies financières holdings, etc.). Les inspections sont menées par des équipes dédiées, distinctes des JST assurant la surveillance au quotidien, afin de garantir l’indépendance de l’examen. Ces équipes sont composées d’agents de la BCE et peuvent inclure des agents des ACN concernées, voire des experts externes si nécessaire. Le chef de mission est toujours un agent de la BCE ou d’une ACN.
Une inspection sur place est initiée par une décision formelle de la BCE, adoptée selon la procédure de non-objection par le Conseil des gouverneurs, et notifiée à l’établissement concerné (sauf exceptions justifiant une inspection inopinée). Les inspecteurs disposent de pouvoirs étendus:
- Accès aux locaux professionnels.
- Demande de tout document pertinent.
- Examen des livres et enregistrements, prise de copies.
- Obtention d’explications écrites ou orales de toute personne appartenant à l’entité ou de ses représentants.
- Interrogation (sur base volontaire) de toute autre personne (ex: auditeurs externes).
Les inspections aboutissent à un rapport détaillant les constats (faiblesses, manquements). Ce rapport est transmis à la JST qui, sur cette base, formule des recommandations à l’intention de la banque, souvent communiquées via une « lettre de suite ». La JST assure ensuite le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations par la banque. Le non-respect peut entraîner des mesures de surveillance plus contraignantes, voire des sanctions.
La réalisation des tests de résistance (« stress tests »)
Les tests de résistance sont un autre outil fondamental de la surveillance prudentielle moderne. Ils consistent à simuler l’impact de scénarios économiques et financiers défavorables (récession sévère, choc sur les taux d’intérêt, chute des marchés…) sur la situation financière des banques, en particulier sur leurs fonds propres et leur rentabilité. L’objectif est d’évaluer la résilience des banques et d’identifier d’éventuelles vulnérabilités avant qu’elles ne se matérialisent.
La BCE joue un rôle clé dans la conduite des tests de résistance au sein de la zone euro. Elle participe aux tests de résistance menés à l’échelle de l’Union européenne (EU-wide stress tests) coordonnés par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE), généralement tous les deux ans. La BCE contribue à la définition des scénarios (en lien avec le Comité Européen du Risque Systémique – CERS) et de la méthodologie, puis supervise la mise en œuvre de l’exercice pour les banques importantes relevant de sa surveillance directe.
En complément de ces exercices européens, la BCE mène également ses propres tests de résistance annuels, conformément à la directive CRD IV. Ces tests peuvent cibler des risques spécifiques ou des portefeuilles particuliers.
Les résultats des tests de résistance sont un élément important pris en compte dans le cadre du SREP. Ils permettent notamment à la BCE :
- D’affiner son évaluation du profil de risque de chaque banque.
- De calibrer les exigences de fonds propres de Pilier 2 (P2R).
- De formuler des recommandations de fonds propres de Pilier 2 (P2G) pour absorber les pertes potentielles en cas de crise.
- D’identifier des faiblesses nécessitant des mesures de surveillance spécifiques (qualitatives ou quantitatives).
La BCE peut décider de publier tout ou partie des résultats des tests de résistance qu’elle mène, contribuant ainsi à la transparence et à la discipline de marché. L’évaluation complète (incluant AQR et stress test) réalisée en 2014 avant le lancement opérationnel du MSU a été un exercice fondateur majeur. Depuis, ces exercices sont devenus un élément récurrent du paysage prudentiel européen.
Les pouvoirs étendus de la BCE en matière de surveillance
Pour mener à bien ses missions de surveillance, la BCE dispose d’un arsenal de pouvoirs étendus, définis principalement par le règlement MSU (notamment les articles 10 à 13 pour les enquêtes et l’article 16 pour les mesures de surveillance) et complétés par les prérogatives héritées des autorités compétentes nationales via la directive CRD IV/V et le règlement CRR/CRR II. Ces pouvoirs doivent être exercés dans le respect du droit de l’Union et du principe de proportionnalité.
Le pouvoir d’exiger des mesures correctrices (fonds propres additionnels, plans de rétablissement)
Lorsque la BCE identifie des manquements aux exigences prudentielles, des risques susceptibles de compromettre la viabilité d’une banque, ou des faiblesses dans sa gouvernance ou sa gestion des risques, elle peut imposer des mesures correctrices. Ces mesures, listées notamment à l’article 16 du règlement MSU (qui reprend largement l’article 104 de la CRD IV), sont variées et graduées. La BCE peut notamment :
- Exiger des fonds propres supplémentaires (Pilier 2) : Imposer des exigences de fonds propres (P2R) au-delà du minimum réglementaire (Pilier 1) pour couvrir des risques spécifiques ou mal évalués par la banque.
- Imposer des exigences spécifiques de liquidité : Demander à la banque de détenir des actifs liquides supplémentaires ou de revoir sa gestion des échéances entre actifs et passifs.
- Exiger l’application d’une politique spéciale de provisionnement ou de traitement des actifs : Imposer des règles plus strictes pour la comptabilisation de certains actifs jugés particulièrement risqués.
- Demander le renforcement des dispositifs, processus et stratégies : Exiger une amélioration de la gouvernance, du contrôle interne, des systèmes de gestion des risques, etc..
- Exiger la présentation d’un plan de rétablissement de la conformité : Demander à la banque de soumettre un plan détaillé expliquant comment elle compte remédier aux manquements constatés, avec un calendrier précis. La BCE peut également exiger des modifications aux plans de redressement existants s’ils sont jugés insuffisants.
- Restreindre ou limiter l’activité : Interdire ou limiter certaines activités, opérations ou l’expansion du réseau si elles font peser des risques excessifs sur la banque.
- Exiger la cession d’activités risquées : Demander à la banque de se défaire de certaines activités jugées trop dangereuses pour sa solidité.
- Exiger la réduction du risque inhérent : Imposer des mesures pour diminuer les risques liés à certaines activités, produits ou systèmes (par exemple, via des couvertures ou des cessions).
- Limiter ou interdire la distribution de dividendes ou de rémunérations variables : Intervenir sur la politique de distribution si elle est jugée incompatible avec le maintien d’une assise financière saine.
- Exiger l’affectation des bénéfices au renforcement des fonds propres.
- Démettre des membres de l’organe de direction : Exiger le remplacement de dirigeants jugés inaptes.
Le choix de la mesure dépend de la gravité de la situation et du principe de proportionnalité. La BCE privilégie généralement le dialogue et les mesures les moins intrusives avant de recourir aux injonctions formelles.
Les pouvoirs d’enquête : demandes d’informations, auditions
Comme détaillé précédemment, la BCE dispose de larges pouvoirs d’enquête pour collecter les informations nécessaires à l’exercice de sa surveillance. Ces pouvoirs s’appliquent principalement aux établissements importants mais peuvent aussi concerner les moins importants. Ils incluent :
- Demandes d’informations (article 10 MSU) : La BCE peut exiger de toute entité supervisée (établissement de crédit, holding financière, etc.), de ses employés, ou même de ses prestataires externes, la communication de toute information ou document pertinent pour ses missions, dans un délai raisonnable. Le secret professionnel (sauf celui des avocats) ne peut lui être opposé. Ces demandes peuvent être ponctuelles ou récurrentes (reporting prudentiel régulier ou spécifique).
- Enquêtes générales (article 11 MSU) : Si les demandes d’information ne suffisent pas, la BCE peut lancer une enquête formelle. Cela lui permet d’examiner les livres et enregistrements, de prendre des copies, et de recevoir des explications écrites ou orales des personnes concernées. Elle peut interroger toute personne appartenant à l’entité visée (dirigeants, employés) et, sur base volontaire, toute autre personne (ex: auditeurs).
- Inspections sur place (article 12 MSU) : Le pouvoir le plus intrusif, permettant aux agents de la BCE (et des ACN) d’accéder aux locaux professionnels de l’entité pour mener des investigations approfondies sur site. Les inspecteurs disposent des mêmes pouvoirs que lors d’une enquête générale (accès aux documents, auditions, etc.).
Ces pouvoirs d’enquête sont essentiels pour permettre à la BCE de vérifier la conformité des banques à la réglementation, d’évaluer leurs risques de manière indépendante et de fonder ses décisions de surveillance sur des informations complètes et fiables.
L’utilisation des instruments macroprudentiels (coussins de fonds propres)
Outre la surveillance microprudentielle (focalisée sur la solidité individuelle des banques), la BCE joue également un rôle dans la politique macroprudentielle, qui vise à prévenir et atténuer les risques systémiques menaçant la stabilité financière dans son ensemble. L’article 5 du règlement MSU lui confère des compétences spécifiques concernant les instruments macroprudentiels prévus par la législation européenne (CRR/CRD IV/V), notamment les différents coussins de fonds propres.
En principe, la mise en œuvre de ces instruments relève des autorités nationales désignées dans chaque État membre participant. Cependant, la BCE dispose de pouvoirs d’intervention (« top-up powers »):
- Droit d’objection : Lorsqu’une autorité nationale envisage d’activer ou de modifier un instrument macroprudentiel (par exemple, fixer le taux du coussin de fonds propres contracyclique), elle doit notifier son intention à la BCE. La BCE dispose de 5 jours ouvrables pour s’opposer à la mesure proposée si elle l’estime inappropriée. En l’absence d’objection, la mesure nationale peut être appliquée.
- Pouvoir d’imposer des mesures plus strictes : Si la BCE juge que les mesures prises (ou non prises) par une autorité nationale sont insuffisantes pour contrer un risque systémique ou macroprudentiel identifié, elle peut décider d’imposer elle-même des exigences plus strictes aux établissements de crédit concernés. Cela peut concerner l’augmentation des taux des différents coussins de fonds propres (conservation, contracyclique, risque systémique, pour les établissements d’importance systémique mondiale ou autre) ou l’application d’autres mesures prévues par l’article 458 du CRR (par exemple, exigences plus sévères sur les grands risques, la publication d’informations, etc.). La BCE doit notifier son intention à l’autorité nationale concernée, qui peut formuler des objections.
Ce pouvoir de « top-up » permet à la BCE d’assurer une application plus cohérente et potentiellement plus rigoureuse des outils macroprudentiels au sein de la zone MSU, contribuant ainsi à une meilleure prévention des risques systémiques. La BCE exerce ces pouvoirs en collaboration étroite avec les autorités nationales et le Comité Européen du Risque Systémique (CERS).
Le pouvoir de sanction de la BCE
Pour assurer le respect de la réglementation prudentielle et de ses propres décisions, la BCE est dotée d’un pouvoir de sanction administrative pécuniaire. Ce pouvoir est défini principalement par l’article 18 du règlement MSU et complété par le règlement (CE) n° 2532/98 (modifié pour tenir compte des missions de surveillance).
Types de sanctions administratives pécuniaires
La BCE peut infliger des amendes administratives aux entités qui commettent certaines infractions. Les infractions pouvant être sanctionnées directement par la BCE concernent principalement:
- Les manquements aux règlements européens directement applicables (essentiellement le règlement CRR/CRR II) commis par des établissements importants.
- Les manquements aux règlements ou aux décisions de la BCE elle-même, commis par des établissements importants ou moins importants.
Les sanctions sont exclusivement pécuniaires. La BCE ne peut prononcer de sanctions d’ordre professionnel (comme une interdiction d’exercer) ni de sanctions pénales.
Le montant des amendes est plafonné:
- Soit au double du profit tiré de l’infraction ou de la perte évitée grâce à elle, si ces montants sont quantifiables.
- Soit à 10% du chiffre d’affaires annuel total de l’exercice précédent de l’entité juridique concernée (ou de sa société mère ultime en cas de filiale).
La BCE doit fixer le montant de l’amende en respectant les principes d’efficacité, de proportionnalité et de dissuasion, en tenant compte de la gravité de l’infraction, de la situation financière de l’entité, de sa coopération et d’une éventuelle récidive.
Pour les infractions aux dispositions nationales (transposant les directives comme CRD IV/V) ou pour sanctionner des personnes physiques (dirigeants, membres du conseil), la BCE doit demander à l’autorité compétente nationale (ACN) d’ouvrir une procédure et d’utiliser ses propres pouvoirs de sanction nationaux. L’ACN informe ensuite la BCE des suites données.
Procédure de sanction et garanties des droits de la défense
La procédure de sanction engagée par la BCE respecte les droits fondamentaux et les garanties procédurales. Lorsqu’elle soupçonne une infraction relevant de sa compétence directe, la BCE peut ouvrir une enquête confiée à une unité d’enquête interne indépendante. Cette unité dispose des pouvoirs d’investigation de la BCE (demandes d’informations, auditions, accès aux documents).
À l’issue de l’enquête, si des griefs sont retenus, l’unité d’enquête les notifie à l’entité concernée, qui dispose alors d’un délai pour présenter ses observations écrites et a le droit d’accéder au dossier (sous réserve de confidentialité). Une audition peut être organisée.
L’unité d’enquête transmet ensuite son dossier et une proposition de décision (sanction ou classement) au Conseil de surveillance prudentielle. Ce dernier examine le dossier, peut demander des investigations complémentaires ou modifier la proposition. Il adopte un projet de décision final, en s’assurant que l’entité a pu faire valoir sa défense sur tous les griefs retenus. Ce projet est soumis au Conseil des gouverneurs selon la procédure de non-objection habituelle.
Tout au long de la procédure, l’entité visée bénéficie des droits de la défense, incluant le droit d’être entendu, le droit à un recours effectif et le principe ne bis in idem (ne pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits). Les décisions de sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission administrative de réexamen de la BCE et/ou devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Si vous êtes confronté à une procédure de sanction, il est recommandé de faire appel à un avocat pour le MSU afin de garantir la protection de vos droits.
Publication des sanctions
En règle générale, les sanctions pécuniaires imposées par la BCE sont rendues publiques sur son site internet. La publication mentionne l’identité de l’entité sanctionnée, la nature de l’infraction et le montant de l’amende. Cette publication a lieu même en cas de recours.
Toutefois, la BCE peut décider de retarder la publication ou de publier la sanction de manière anonyme si la publication immédiate et nominative risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire à une enquête pénale en cours, ou de causer un préjudice disproportionné à l’entité concernée. Les informations sur les sanctions restent accessibles sur le site de la BCE pendant au moins cinq ans. Les informations relatives aux éventuels recours devant la CJUE sont également publiées. Les sanctions sont aussi communiquées à l’ABE.
Coopération et échange d’informations
Le bon fonctionnement du MSU repose fondamentalement sur une coopération étroite et un échange fluide d’informations entre la BCE et les nombreuses autorités nationales et internationales impliquées dans la supervision bancaire. Le règlement MSU et le règlement-cadre MSU établissent les principes et les modalités de cette coopération.
Collaboration avec les autorités nationales (ACN et autorités de résolution)
La collaboration entre la BCE et les autorités compétentes nationales (ACN) des États membres participants est la clé de voûte du MSU. Les ACN assistent la BCE dans la préparation et la mise en œuvre de ses missions de surveillance. Elles sont le premier point de contact pour les demandes d’agrément ou les notifications de prises de participation qualifiée, et effectuent une première analyse avant transmission à la BCE. Pour les établissements moins importants, les ACN assurent la surveillance directe, mais sous la supervision indirecte de la BCE et conformément à ses orientations et instructions éventuelles.
Un échange constant et complet d’informations est prévu : les ACN doivent fournir à la BCE toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, et réciproquement, la BCE partage les informations pertinentes avec les ACN. Ce partage vise à assurer une vision complète de la situation des banques et à éviter les demandes redondantes. La coopération se matérialise notamment au sein des Équipes de Surveillance Conjointes (JST), composées d’agents de la BCE et des ACN concernées, qui assurent la surveillance quotidienne des établissements importants.
La BCE coopère également avec les autorités nationales de résolution (ANR). Bien que la résolution ne relève pas directement du MSU mais du Mécanisme de Résolution Unique (MRU), une coordination est indispensable. La BCE est consultée lors de l’élaboration des plans de résolution par les ANR et transmet à ces dernières toute information pertinente, notamment lorsqu’elle estime qu’un établissement est en situation de défaillance avérée ou prévisible (« failing or likely to fail »), condition préalable au déclenchement d’une procédure de résolution. Le retrait d’agrément par la BCE est également coordonné avec l’autorité de résolution.
Coopération avec les autorités de pays tiers
La dimension internationale du secteur bancaire rend nécessaire la coopération entre la BCE et les autorités de surveillance des pays situés en dehors de l’Union européenne (pays tiers). L’article 8 du règlement MSU autorise la BCE à établir des contacts et à conclure des accords administratifs (Memoranda of Understanding – MoUs) avec les autorités de surveillance de pays tiers. Ces accords visent principalement à faciliter l’échange d’informations confidentielles (sous réserve de garanties équivalentes en matière de secret professionnel) et à coordonner les activités de surveillance pour les groupes bancaires présents des deux côtés de la frontière.
La BCE peut également, dans ce cadre, organiser la participation d’autorités de pays tiers aux collèges d’autorités de surveillance qu’elle met en place pour les groupes bancaires européens ayant des activités significatives à l’étranger. Cette coopération internationale est essentielle pour assurer une surveillance efficace des groupes bancaires mondiaux et prévenir l’arbitrage réglementaire. La BCE coordonne ses actions en la matière avec l’ABE. Le champ d’application exact du MSU est également un élément clé, vous pouvez en apprendre davantage sur le champ d’application du MSU.
Les missions et les pouvoirs conférés à la BCE au sein du MSU ont profondément transformé le paysage de la supervision bancaire en Europe. Si vous êtes confronté à des questions relatives à l’application de cette réglementation ou si vous interagissez avec la BCE dans le cadre de ses missions de surveillance, notre cabinet peut vous accompagner pour analyser votre situation et défendre vos intérêts, y compris concernant la mise en place de sûretés et garanties.
N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour discuter de vos options.
Sources
- Règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (Règlement MSU).
- Règlement (UE) N° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (Règlement-cadre MSU).
- Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CRD IV), modifiée notamment par la Directive (UE) 2019/878 (CRD V).
- Règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR), modifié notamment par le Règlement (UE) 2019/876 (CRR II).
- Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (BRRD), modifiée notamment par la Directive (UE) 2019/879 (BRRD II).
- Règlement (CE) N° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions.