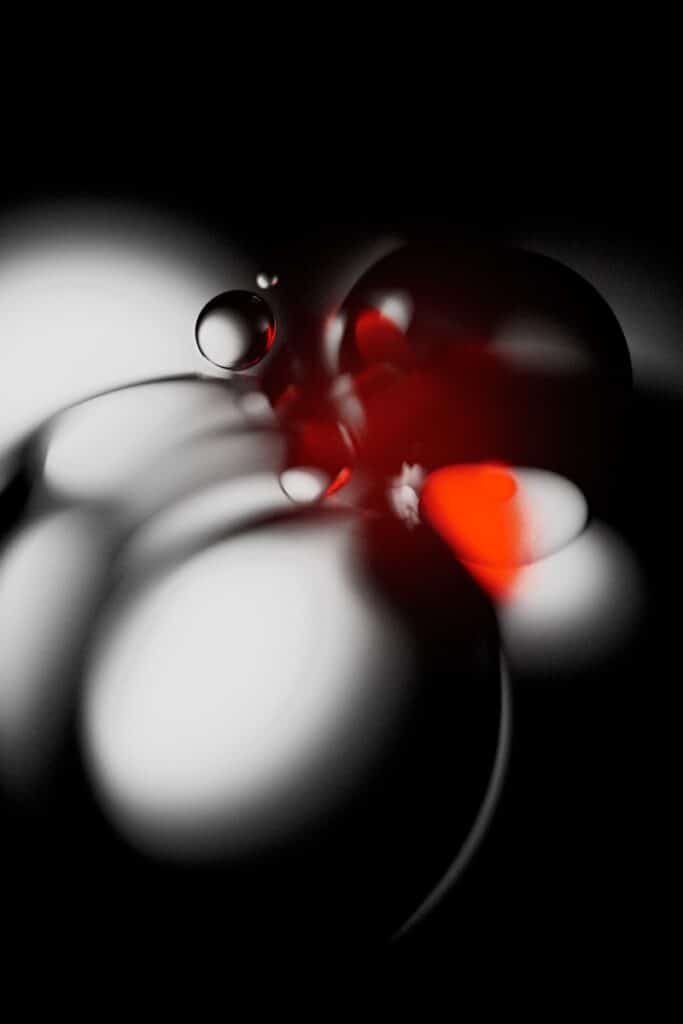Dans le sillage de l’hypothèque maritime, une autre catégorie de garanties spécifiques au monde naval joue un rôle essentiel : les privilèges maritimes. Moins connus du grand public, ils n’en sont pas moins redoutables pour les créanciers qui en bénéficient. Contrairement à l’hypothèque qui naît d’un contrat, le privilège est accordé directement par la loi à certaines créances jugées particulièrement dignes de protection.
Pourquoi le droit maritime a-t-il instauré ces droits de priorité spécifiques, parfois même supérieurs à ceux d’une hypothèque inscrite ? Historiquement, à une époque où l’hypothèque sur les navires n’existait pas ou était difficile à mettre en œuvre, les privilèges étaient le principal moyen d’assurer le crédit nécessaire à l’expédition maritime. Ils garantissaient ceux qui fournissaient des services ou des biens indispensables à la conservation du navire ou à la réussite du voyage. Aujourd’hui encore, ils protègent des créanciers qui, souvent, n’ont pas eu la possibilité de négocier une autre forme de garantie. Mais quelles sont exactement ces créances privilégiées ? Comment fonctionnent ces garanties et quelle est leur portée réelle ? Cet article se propose de démystifier les privilèges maritimes.
Qu’est-ce qu’un privilège maritime ?
Un privilège maritime est un droit que la loi accorde à un créancier d’être payé par préférence aux autres créanciers sur le prix de vente du navire. C’est une forme de sûreté légale, qui existe indépendamment de toute convention entre les parties. Sa caractéristique fondamentale est d’être un véritable droit réel grevant le navire. Cela signifie qu’il confère à son titulaire non seulement un droit de préférence (être payé avant les autres), mais aussi un droit de suite (pouvoir saisir le navire même s’il a été vendu à un tiers). C’est là une différence majeure avec les privilèges de droit commun qui, portant sur des meubles, se heurtent souvent à la règle « en fait de meubles, possession vaut titre ».
Ce caractère de droit réel est si marqué qu’on parle parfois de créance « réelle » attachée au navire lui-même. L’idée sous-jacente est que le navire, en quelque sorte, répond personnellement de certaines dettes nées de son exploitation, et ce, indépendamment de qui est le débiteur contractuel (le propriétaire, l’armateur exploitant non propriétaire, ou même un affréteur). Ainsi, un fournisseur ayant contracté avec un affréteur peut, si sa créance est privilégiée, exercer son droit sur le navire appartenant au propriétaire, bien que ce dernier ne soit pas son débiteur direct. La Cour de cassation a clairement distingué ce droit in rem (sur la chose, le navire) du droit in personam (contre la personne du débiteur). C’est une originalité forte du droit maritime.
L’histoire des privilèges maritimes en France remonte à l’Ordonnance de la Marine de 1681 et a été codifiée dans le Code de commerce de 1807. Le système initial était très large mais limité dans le temps (souvent au dernier voyage). L’arrivée de l’hypothèque maritime a conduit à repenser ce régime. La Convention internationale de Bruxelles de 1926, ratifiée par la France, a cherché à harmoniser et surtout à limiter le nombre de privilèges primant l’hypothèque. La loi française du 3 janvier 1967 s’en est largement inspirée, en distinguant deux grandes catégories : les privilèges de premier rang, qui priment les hypothèques, et les privilèges de second rang, qui viennent après. Malgré les efforts d’harmonisation (Convention de Genève de 1993, peu ratifiée), des différences persistent entre les législations nationales, notamment entre la conception romano-germanique (privilège lié à la nature de la créance) et la conception anglo-saxonne (privilège pour ceux ne pouvant obtenir d’autre garantie).
Ces divergences rendent la question de la loi applicable complexe en contexte international. Quelle loi détermine si une créance est privilégiée ? Quelle loi régit le classement entre privilèges concurrents ? La jurisprudence française récente semble s’orienter vers une application cumulative : la créance doit être considérée comme privilégiée à la fois par la loi qui la régit (par exemple, la loi du contrat de fourniture) et par la loi du lieu où le navire est saisi (lex rei sitae). Pour le classement entre les différents créanciers lors de la distribution du prix de vente, c’est en revanche la loi du for (lex fori), c’est-à-dire la loi du tribunal qui organise la vente, qui prime logiquement.
Une autre caractéristique importante des privilèges maritimes est leur caractère souvent occulte : ils ne font l’objet d’aucune publicité sur un registre. Un acheteur potentiel ou un créancier hypothécaire ne peut donc pas savoir avec certitude, par une simple consultation publique, quels privilèges pourraient grever le navire. Cette opacité est toutefois tempérée par leur durée de vie très limitée, comme nous le verrons.
Quelles sont les créances bénéficiant d’un privilège de premier rang ?
La loi du 3 janvier 1967 (article 31) établit une liste limitative et précise des créances qui bénéficient d’un privilège de premier rang. Ce sont les seules qui priment les hypothèques maritimes, quel que soit le rang d’inscription de ces dernières. Ces créances sont considérées comme essentielles à la vie maritime ou résultant de risques inhérents à celle-ci. En voici l’énumération :
- Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix : Il s’agit des frais engagés dans l’intérêt commun de tous les créanciers pour réaliser le gage que constitue le navire (frais de saisie, de garde pendant la procédure, frais de vente elle-même). Ces frais sont prélevés en premier sur le prix obtenu.
- Les droits de tonnage ou de port, autres taxes publiques de même espèce, frais de pilotage, frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port : Ce sont des créances liées à l’escale du navire. Sont visées les taxes dues à l’autorité portuaire, les impôts spécifiques, les rémunérations des pilotes (dont l’intervention est souvent obligatoire), mais aussi les frais nécessaires pour garder et conserver le navire en bon état pendant son séjour dans le dernier port avant la saisie. La jurisprudence interprète parfois largement les « frais de garde et conservation », pouvant y inclure les primes d’assurance « risque port » ou même certains frais liés au maintien de l’équipage à bord pendant une immobilisation forcée. Les frais engagés dans les ports antérieurs ne bénéficient pas de ce privilège spécifique (ils pourraient éventuellement relever du 6ème privilège).
- Les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, de l’équipage et des autres personnes engagées à bord : C’est le privilège des gens de mer. Il garantit leurs salaires, mais aussi les indemnités liées (congés payés, indemnité de licenciement, frais de rapatriement), ainsi que les cotisations sociales obligatoires dues par l’armateur aux organismes compétents (comme l’ENIM en France). En revanche, les pénalités de retard pour paiement tardif de ces cotisations ne sont pas couvertes par le privilège.
- Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, et la contribution du navire aux avaries communes : Ce privilège garantit ceux qui ont contribué à sauver le navire ou la cargaison d’un péril de mer. Il couvre les indemnités dues aux sauveteurs ou assistants, ainsi que les sommes dues par le propriétaire du navire au titre de la contribution aux avaries communes (lorsque des sacrifices – par exemple, jeter une partie de la cargaison par-dessus bord – ont été faits pour le salut commun de l’expédition). Le fondement est clair : ces créanciers ont préservé le gage des autres créanciers.
- Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, pour lésions corporelles aux passagers et équipages, pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages : Ce privilège couvre une large gamme de créances délictuelles ou contractuelles résultant de l’exploitation du navire. Il garantit les victimes d’accidents de navigation (abordage entre navires, collision avec un quai…), les passagers blessés, ou encore les propriétaires de marchandises endommagées ou perdues pendant le transport. La justification est moins évidente que pour les précédents ; elle est en partie historique et liée à l’idée que ces victimes n’ont souvent pas pu négocier de garantie préalable.
- Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage : C’est le privilège dit « du capitaine », bien qu’il bénéficie en réalité aux fournisseurs ou prêteurs. Il garantit les dettes contractées par le capitaine (agissant dans le cadre de ses pouvoirs légaux) lorsqu’il est loin du port d’attache, pour faire face à des besoins réels et urgents : réparations indispensables, achat de combustible, avitaillement nécessaire pour poursuivre le voyage. La loi de 1969 a étendu ce privilège aux contrats similaires conclus par l’agent maritime ou le consignataire du navire, reconnaissant ainsi l’évolution des pratiques commerciales. Il faut cependant que le contrat ait été passé pour les besoins du navire et non pour le compte personnel de l’affréteur, par exemple.
Ces six catégories constituent le cercle fermé des privilèges maritimes de premier rang.
Existe-t-il d’autres privilèges (second rang) ?
Oui, la loi de 1967 (article 33) précise que les créanciers peuvent également invoquer les privilèges prévus par le droit commun (Code civil ou lois spéciales). Cependant, et c’est une différence capitale, ces privilèges dits « de second rang » ou « ordinaires » ne prennent rang qu’après les hypothèques maritimes inscrites.
Quels sont ces privilèges ? Le plus fréquemment invoqué est sans doute le privilège du conservateur de la chose (prévu par le Code civil), lorsque des dépenses ont été faites pour conserver le navire (qui n’entreraient pas dans les catégories spécifiques de l’article 31). La jurisprudence est cependant restrictive : il faut prouver que la dépense était nécessaire à la conservation même du navire, et non simplement utile à son exploitation. Le privilège du vendeur de meubles impayés (par exemple, pour du matériel livré mais non payé, qui n’aurait pas été incorporé) peut aussi être invoqué.
Les privilèges fiscaux généraux (ceux qui ne correspondent pas aux taxes spécifiques visées à l’article 31-2°) sont également considérés comme des privilèges de second rang en matière maritime, même si la loi fiscale leur accorde parfois une priorité plus élevée en droit commun. La spécificité du droit maritime l’emporte ici.
Enfin, il faut rappeler le cas particulier du créancier nanti sur du matériel d’équipement (loi de 1951, aujourd’hui dans le Code de commerce). Comme vu précédemment, si ce matériel est incorporé au navire, le nantissement n’est pas opposable au créancier hypothécaire, et il ne constitue pas non plus un privilège primant l’hypothèque.
La hiérarchie est donc claire : Privilèges de premier rang > Hypothèques maritimes > Privilèges de second rang > Créanciers chirographaires. Pour une compréhension approfondie des hypothèques maritimes et de leur position dans cet ordre de préférence, n’hésitez pas à consulter notre article dédié.
Comment s’exercent les privilèges maritimes ?
Connaître l’existence et le rang d’un privilège est une chose, savoir concrètement comment le créancier peut l’exercer en est une autre.
L’assiette du privilège
Sur quoi porte le privilège ? L’article 31 de la loi de 1967 indique qu’il porte sur :
- Le navire : Comme l’hypothèque, il s’agit du bâtiment lui-même avec ses accessoires (agrès, apparaux…).
- Le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée : C’est une différence importante avec l’hypothèque. Le fret représente les gains de l’expédition. Toutefois, le privilège ne peut s’exercer sur le fret que s’il est encore dû par le chargeur ou s’il se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent de l’armateur. Une fois payé à l’armateur et versé sur son compte, il se fond dans son patrimoine général et le privilège s’éteint. Le prix du passage payé par les passagers est assimilé au fret.
- Les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage : Il s’agit principalement des indemnités qui viennent remplacer le navire ou le fret : indemnités dues par un tiers responsable pour dommages matériels au navire non réparés ou pour perte de fret ; indemnités dues pour avaries communes ; rémunérations pour assistance ou sauvetage (après déduction de la part revenant à l’équipage).
En revanche, les indemnités d’assurance (qui sont le gage préférentiel des créanciers hypothécaires) et les subventions publiques ne sont pas considérées comme des accessoires du navire ou du fret et ne sont donc pas comprises dans l’assiette des privilèges.
Une exception notable concerne le privilège des gens de mer (article 31-3°) : pour garantir leurs salaires et créances liées, leur privilège porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant leur contrat d’engagement, et non seulement sur le fret du voyage où la créance est née.
Les droits du créancier privilégié
Le privilège confère essentiellement un droit de préférence et, pour ceux de premier rang, un droit de suite.
Le droit de préférence permet au créancier de faire saisir le navire et d’être payé en priorité sur le prix de vente. La saisie est possible même si le navire n’appartient pas au débiteur direct du créancier privilégié (cas de l’affrètement). Le classement entre les créanciers privilégiés de premier rang est complexe :
- D’abord, on classe par voyage : les créances du dernier voyage priment celles des voyages précédents (incitation à agir vite). Exception : les salaires de l’équipage couvrant plusieurs voyages sont tous colloqués au rang du dernier voyage.
- Ensuite, au sein d’un même voyage, on suit l’ordre numérique de l’article 31 (les frais de justice avant les taxes portuaires, etc.).
- Enfin, pour les créances d’un même numéro (par exemple, plusieurs fournisseurs relevant du 6ème privilège), elles viennent en concurrence au marc le franc (répartition proportionnelle si le prix est insuffisant). Exceptions : pour les créances d’assistance/sauvetage (n°4) et celles pour besoins du navire (n°6), le classement se fait dans l’ordre inverse de leur date de naissance (la plus récente prime la plus ancienne), afin d’encourager ceux qui interviennent en dernier pour sauver ou maintenir le navire.
Le droit de suite (article 39 de la loi de 1967) est réservé aux seuls privilèges de premier rang. Il permet au créancier de suivre le navire en quelques mains qu’il passe et de le saisir même après sa vente à un tiers acquéreur. C’est un droit très puissant mais, comme nous allons le voir, il est limité dans le temps.
Combien de temps durent les privilèges maritimes ?
Les privilèges maritimes sont des droits puissants mais éphémères. Leur extinction obéit à des règles spécifiques, en plus des causes communes d’extinction des obligations (paiement, prescription de la créance principale…).
D’abord, ils s’éteignent par la vente judiciaire du navire. Que la vente ait lieu en France ou à l’étranger (sous réserve de reconnaissance du jugement étranger), elle a pour effet de « purger » les privilèges : l’acquéreur reçoit le navire libre de ces charges, et les créanciers privilégiés doivent faire valoir leurs droits sur le prix de vente. La confiscation du navire par une autorité publique (par exemple, pour infraction douanière) éteint également les privilèges, ce qui peut être très préjudiciable pour les créanciers. De même, la constitution d’un fonds de limitation de responsabilité par l’armateur fait disparaître les privilèges (sauf pour certaines créances comme celles de l’équipage ou d’assistance).
Ensuite, et c’est crucial, les privilèges de premier rang s’éteignent par l’écoulement d’un délai très court, généralement considéré comme un délai de péremption (non susceptible des interruptions ou suspensions de droit commun, sauf exception). Ce délai est de :
- Un an pour la plupart des privilèges (frais de justice, taxes, salaires, assistance, abordage, etc.).
- Six mois seulement pour les créances de fournitures ou réparations contractées par le capitaine ou l’agent pour les besoins réels du navire (privilège n°6).
Le point de départ de ce délai varie selon la nature de la créance (fin des opérations d’assistance, jour du dommage, date de livraison prévue des marchandises, naissance de la créance pour les fournitures, exigibilité pour les autres cas). Il est important de noter que ce délai concerne le privilège lui-même, et non la créance sous-jacente. Une fois le privilège éteint par le temps, le créancier perd sa priorité et son droit de suite, mais il peut toujours réclamer sa créance à titre chirographaire si celle-ci n’est pas elle-même prescrite selon les règles qui lui sont propres.
Pour interrompre ce court délai, il ne suffit pas d’envoyer une mise en demeure ou d’assigner le débiteur en paiement. Il faut un acte dirigé contre le navire lui-même, typiquement une saisie (conservatoire ou exécution).
Enfin, le droit de suite attaché aux privilèges de premier rang s’éteint spécifiquement deux mois après la publication de l’acte de transfert volontaire de propriété (vente amiable). Passé ce délai très court après la publicité de la vente, l’acquéreur est à l’abri des poursuites des créanciers privilégiés antérieurs dont il n’aurait pas eu connaissance.
Les privilèges maritimes sont des outils juridiques complexes mais essentiels pour de nombreux acteurs du monde maritime. Que vous soyez créancier cherchant à garantir votre dû ou propriétaire/armateur confronté à ces réclamations, une analyse experte est indispensable. Contactez notre cabinet pour évaluer vos droits et obligations et bénéficier de l’expertise de nos avocats en sûretés maritimes.
Sources
- Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer (articles 31 à 42).
- Loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 sur l’armement et les ventes maritimes.
- Code civil (principes généraux des privilèges).
- Convention de Bruxelles du 10 avril 1926 pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes.