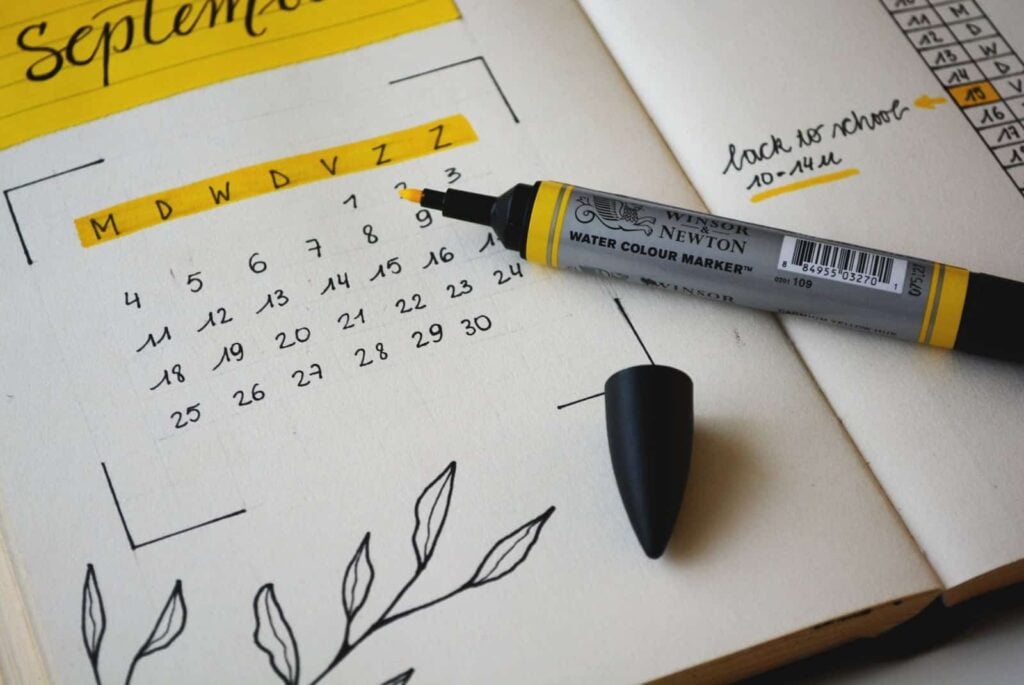Le droit maritime possède ses propres règles et ses juridictions spécifiques. Parmi elles, les tribunaux maritimes occupent une place particulière dans l’architecture judiciaire française. Créés par l’ordonnance du 2 novembre 2012, ils ont remplacé les anciens tribunaux maritimes commerciaux (TMC) pour juger des infractions aux règles de sécurité applicables au navire et à la navigation. Cette juridiction pénale spécialisée reste pourtant largement méconnue du grand public. Découvrons son fonctionnement, sa composition et son rôle dans notre système juridique.
De l’ancien au nouveau régime des tribunaux maritimes
L’histoire des tribunaux maritimes est complexe. Avant la Révolution, les juges de l’amirauté connaissaient des actions civiles, pénales et disciplinaires concernant les marins. L’idée d’un régime pénal spécifique aux navigateurs existait déjà.
Les tribunaux maritimes commerciaux ont été institués par un décret-loi du 24 mars 1852. Ils jugeaient les fautes contre la discipline du bord et les délits maritimes définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM).
Une étape décisive fut franchie le 2 juillet 2010. Ce jour-là, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la composition des TMC. Le motif : la présence de militaires ou de fonctionnaires soumis à l’autorité hiérarchique du gouvernement violait le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions.
Cette décision a accéléré la réforme. L’ordonnance du 2 novembre 2012 a profondément modifié la loi du 17 décembre 1926 et créé les tribunaux maritimes actuels. Le changement est entré en vigueur le 1er janvier 2015.
La composition actuelle des tribunaux maritimes
La composition des tribunaux maritimes repose sur le principe de l’échevinage : des magistrats professionnels siègent aux côtés d’assesseurs issus du monde maritime.
Chaque tribunal maritime comprend :
- Trois magistrats professionnels, dont le président, désignés par le président du tribunal judiciaire
- Deux assesseurs maritimes
Les assesseurs maritimes sont choisis pour leur expérience de la navigation maritime. Cette expérience peut provenir de la marine marchande, de la pêche, ou même de la plaisance. Ils sont inscrits sur une liste pour une durée de cinq ans non renouvelable, après sélection par une commission présidée par le président du tribunal judiciaire.
Pour garantir leur indépendance, les fonctionnaires de l’État et des collectivités publiques en activité ne peuvent pas siéger comme assesseurs maritimes, sauf s’ils ont cessé leur activité depuis plus de cinq ans.
Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent serment et suivent une formation obligatoire dispensée par l’École nationale de la sécurité et de l’administration de la mer.
La compétence matérielle des tribunaux maritimes
Les tribunaux maritimes jugent les infractions maritimes définies par la loi. L’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 précise que ces infractions comprennent :
- Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports
- Les délits prévus aux articles 42, 43 et 44 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes
- Les contraventions connexes à ces délits
Concrètement, ces tribunaux traitent des infractions liées à la sécurité de la navigation, comme :
- Le non-respect des règles de circulation maritime
- L’absence de titre de sécurité ou de certificat de prévention de la pollution
- Le refus d’obéissance à un navire de guerre
- La navigation en violation d’une interdiction de départ
- L’absence d’assistance à un navire en danger
- L’exercice du commandement sans les qualifications requises
Ils peuvent également connaître de certains délits du code pénal lorsqu’ils sont connexes à un délit maritime, notamment :
- L’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal)
- Les blessures involontaires (article 222-19)
- La mise en danger d’autrui (article 223-1)
- Le défaut d’assistance à personne en péril (article 223-6)
En revanche, les crimes, même commis en mer, échappent à leur compétence. De même, certains délits maritimes restent jugés par les juridictions de droit commun, comme ceux liés à l’identification des navires ou au droit du travail maritime.
La compétence territoriale et l’organisation pratique
En France, six tribunaux maritimes siègent à :
- Bordeaux
- Brest
- Cayenne
- Le Havre
- Marseille
- Saint-Denis de La Réunion
Leur ressort territorial est fixé par le décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014. Ils couvrent l’ensemble du territoire national et des eaux sous juridiction française.
Le tribunal maritime compétent peut être celui :
- Du port d’immatriculation du navire
- Du port où le navire a été conduit
- Du lieu d’attachement en douane du navire
- Du port de débarquement de la personne mise en cause
- Du lieu d’implantation du centre régional de surveillance maritime concerné
Cette règle permet une certaine souplesse dans la détermination du tribunal compétent.
Les règles de procédure spécifiques
La procédure devant les tribunaux maritimes suit largement le droit commun, avec quelques particularités liées au contexte maritime.
L’enquête sur les infractions maritimes
Outre les officiers et agents de police judiciaire, peuvent constater les infractions maritimes :
- Les commandants des bâtiments de l’État
- Les administrateurs des affaires maritimes
- Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis
Le capitaine d’un navire joue un rôle particulier. S’il constate une infraction à bord, il peut effectuer les actes d’enquête nécessaires. Il informe alors l’autorité administrative qui prévient le procureur de la République. À la première escale, il transmet les pièces de l’enquête.
Les poursuites et l’instruction
La poursuite des délits maritimes relève du procureur de la République du tribunal judiciaire auprès duquel est institué le tribunal maritime. L’instruction suit les règles du code de procédure pénale.
Le jugement et ses particularités
Contrairement aux anciens tribunaux maritimes commerciaux, les tribunaux maritimes actuels connaissent de l’action civile. Les victimes peuvent donc se constituer partie civile.
Les décisions des tribunaux maritimes peuvent être contestées par voie d’appel, conformément au droit commun.
Pour les délits maritimes, le tribunal peut prononcer diverses peines complémentaires spécifiques, comme :
- Le retrait des droits afférents aux brevets maritimes
- La suspension du permis de conduire en mer
- L’interdiction de pratiquer la navigation dans les eaux françaises
Ces sanctions visent à protéger la sécurité maritime en écartant temporairement ou définitivement les personnes ayant commis des infractions graves.
Les tribunaux maritimes constituent un maillon essentiel de la chaîne judiciaire dans le monde de la mer. Ils garantissent l’application de règles spécifiques par des juges connaissant les réalités maritimes. Si vous exercez une activité en rapport avec la navigation maritime, la pêche ou la plaisance, vous pourriez un jour être confronté à cette juridiction. Pour toute question relative au droit maritime ou si vous faites l’objet de poursuites devant un tribunal maritime, notre cabinet peut vous accompagner et défendre vos intérêts avec l’expertise nécessaire dans ce domaine si particulier.
Sources
- Loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime
- Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime
- Décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014 fixant la liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes
- Code des transports, cinquième partie (Transport et navigation maritimes)
- Code pénal, articles 221-6, 222-19, 223-1 et 223-6