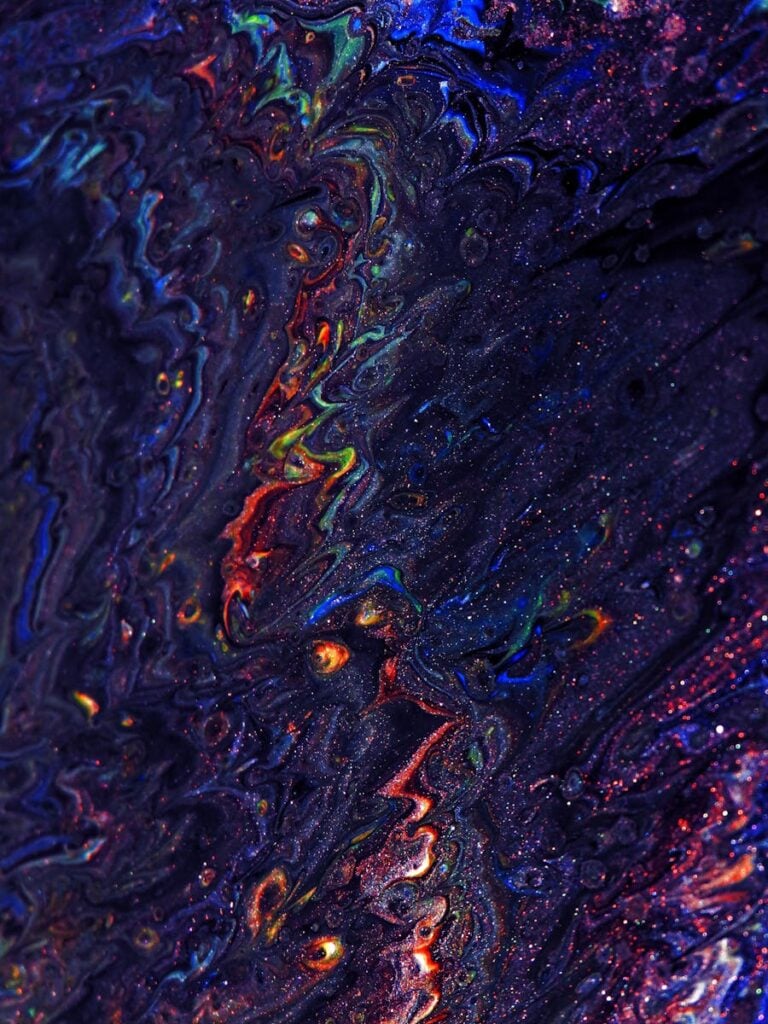Quelle solution pour contester un contrat judiciaire mal ficelé? La nature hybride de cet acte juridique complexifie la question des recours possibles. Entre régime contractuel et dimensions judiciaires, les praticiens doivent naviguer avec précaution.
Régime des voies de recours applicables
Le contrat judiciaire, cette intersection entre le conventionnel et le judiciaire, possède un régime de recours spécifique. Sa nature est double : contractuelle par sa source et judiciaire par sa forme.
La jurisprudence est constante sur ce point. Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, « le jugement par lequel un juge se borne à donner acte aux parties de leur accord est dépourvu de toute valeur juridique indépendamment de cet accord » (Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-10.511).
Ce principe fondamental détermine les voies de recours ouvertes.
Le contrat judiciaire tire son autorité non pas de l’intervention du juge, mais de la volonté des parties. C’est cette origine conventionnelle qui dicte le régime des recours. Ainsi, le contrat judiciaire n’emprunte pas les voies de recours classiques des jugements.
Exclusion de l’appel classique et du pourvoi en cassation
La conséquence directe de la nature contractuelle du contrat judiciaire est l’exclusion des voies de recours réservées aux décisions juridictionnelles.
L’appel est fermé. La Cour de cassation a clairement tranché : « une décision qui ne fait que constater un contrat judiciaire n’est pas susceptible d’appel » (Civ. 3e, 25 févr. 2016, n° 14-26.905).
Cette position se justifie par le caractère non juridictionnel de l’acte du juge. Celui-ci se contente de constater l’accord des parties, sans faire œuvre créatrice ni exercer son pouvoir juridictionnel.
De même, le pourvoi en cassation n’est pas envisageable contre un contrat judiciaire. Ce recours extraordinaire vise à censurer la non-conformité au droit d’une décision de justice. Or, le contrat judiciaire n’étant pas une décision juridictionnelle, il échappe à ce contrôle.
Cette exclusion peut surprendre les plaideurs mal informés. Ils découvrent parfois tardivement l’impossibilité de faire appel d’un contrat judiciaire défavorable.
Actions en nullité et en rescision contractuelles
Si les voies de recours juridictionnelles sont fermées, quelles options restent aux parties insatisfaites?
Le contrat judiciaire étant soumis au droit commun des contrats, il ne peut être remis en cause que par les actions en nullité contractuelle. Comme le précise la doctrine, « le contrat judiciaire relève du régime des conventions : la voie de l’appel fermée et le contrat judiciaire ne peut être remis en cause que par l’exercice des voies de nullité principales » (Guinchard et al.).
En pratique, cela signifie qu’une partie peut attaquer le contrat judiciaire par:
- L’action en nullité pour vice du consentement (erreur, dol, violence)
- L’action en rescision pour lésion (dans les cas limités où elle est admise)
- L’action en nullité pour incapacité
Ces actions doivent être exercées par voie principale devant le tribunal compétent. Elles obéissent aux règles du droit commun, notamment en matière de prescription.
Un exemple concret? Une transaction homologuée par un juge pourra être attaquée pour dol si une partie a intentionnellement dissimulé des informations essentielles. Le recours ne visera pas l’acte d’homologation mais le contrat lui-même.
Évolutions législatives récentes
Le législateur a progressivement clarifié le régime des recours contre le contrat judiciaire.
Une évolution majeure concerne l’article 2052 du Code civil. Avant la réforme du droit des contrats de 2016, cet article énonçait que « la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Cette formulation malheureuse créait une confusion sur la nature réelle de la transaction et suggérait erronément qu’elle puisse faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a modifié cet article qui dispose désormais que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». La référence à l’autorité de chose jugée a donc été supprimée, ce qui clarifie le régime applicable.
Cette évolution législative montre la volonté du législateur de garantir une plus grande cohérence entre la nature du contrat judiciaire et les voies de recours qui lui sont applicables.
La difficulté persiste néanmoins pour les « homologations ». Malgré son nom, l’homologation d’un accord ne convertit pas celui-ci en décision judiciaire. Le droit français connaît encore certaines imperfections terminologiques qui peuvent égarer les praticiens.
À retenir : même homologuée, la convention garde sa nature contractuelle et doit être attaquée par les voies de nullité contractuelles.
En cas de doute sur la qualification exacte d’un acte et les voies de recours qui lui sont applicables, une consultation juridique s’impose. L’erreur sur ce point peut être fatale puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité du recours exercé.
Vous envisagez de contester un contrat judiciaire? Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit processuel et des contrats peut vous accompagner dans l’identification des stratégies pertinentes et la mise en œuvre des recours adaptés.
Sources
- Code civil, article 2052 (version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)
- Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-10.511, RTD civ. 2008. 662, obs. J. Hauser
- Civ. 3e, 25 févr. 2016, n° 14-26.905
- Chainais, Ferrand et Guinchard, « Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil », n° 1056, p. 714
- Deharo Gaëlle, « Contrat judiciaire », Répertoire de procédure civile, septembre 2017