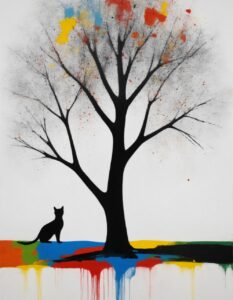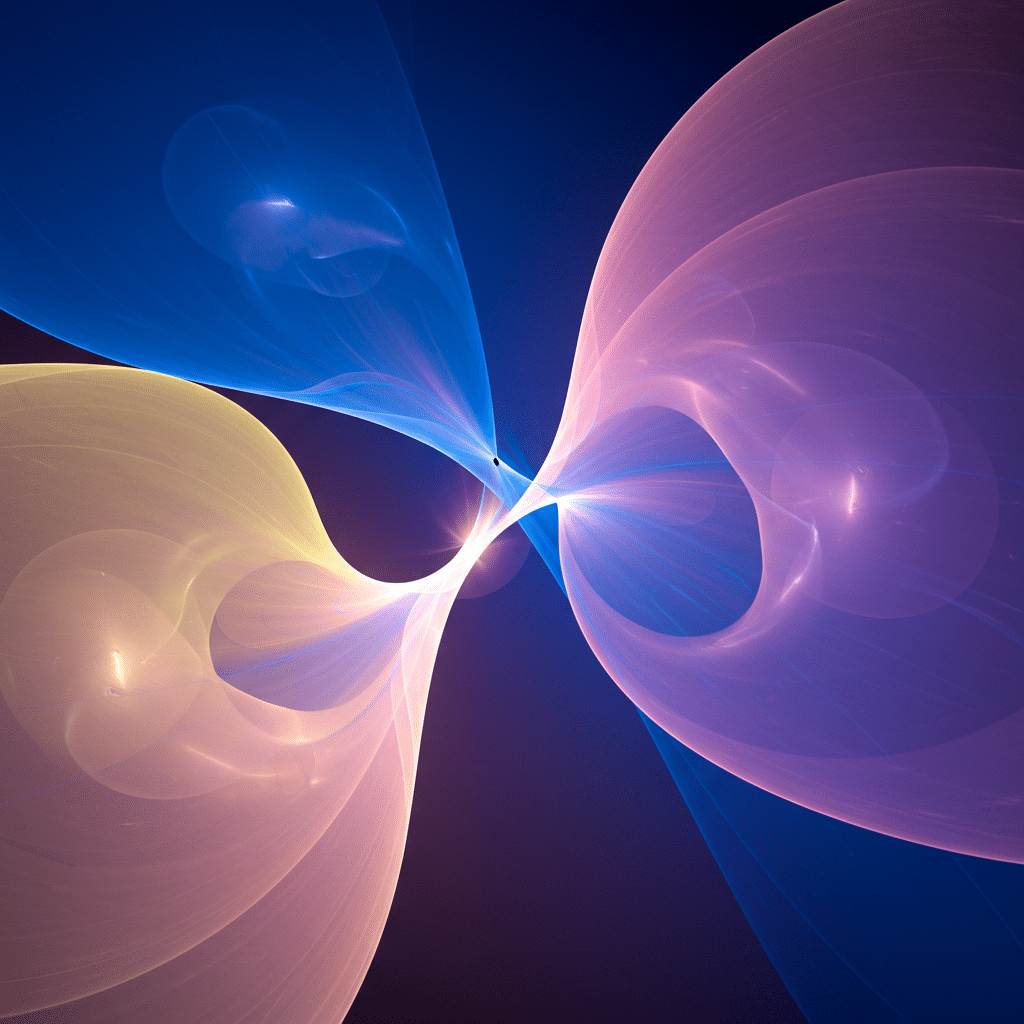« `html
Lorsque l’État entre dans une relation juridique avec une personne privée, il devient un sujet de droit comme un autre. Cette position particulière nécessite une représentation adaptée devant les juridictions judiciaires. C’est là qu’intervient l’Agent judiciaire de l’État (AJE), dont le mandat légal remonte à 1790 et qui s’est vu confier la mission essentielle de représenter l’État dans tous les contentieux judiciaires à caractère pécuniaire.
L’État partie au procès civil
L’État, bien que puissance publique, conclut quotidiennement des contrats, gère des biens immobiliers, et agit comme employeur. Ces activités engendrent des litiges relevant du droit privé, traités par les tribunaux judiciaires.
Contentieux économiques et financiers
En matière économique, l’AJE intervient notamment dans les contestations de cessions de créances (loi Dailly), les appels en garantie lors de marchés de construction, ou encore les cas d’emprise irrégulière.
À titre d’exemple, dans un jugement récent du Tribunal judiciaire d’Albi (10 septembre 2019, RG n° 18/00291), l’État a dû répondre d’un appel en garantie concernant un vice de construction sur un édifice public. L’AJE a représenté l’État dans ce litige où les règles du droit privé s’appliquaient pleinement.
Droit du travail et sécurité sociale
L’AJE défend également l’État employeur pour ses contractuels de droit privé. Le Tribunal du travail de Papeete a ainsi tranché plusieurs litiges en 2019 (RG n° 18/00301 et RG n° 19/00068) où l’État était poursuivi en sa qualité d’employeur privé.
En matière de sécurité sociale, l’AJE intervient pour le règlement des cotisations sociales pour les collaborateurs occasionnels, ainsi que lors de contentieux relatifs à la faute inexcusable de l’employeur. La Cour d’appel de Paris (14 juin 2019, RG n° 14/11246) a eu à connaître d’un tel litige concernant le paiement de cotisations sociales par l’État.
Responsabilité pour dommages causés par un véhicule
Un domaine majeur d’intervention de l’AJE concerne les accidents impliquant des véhicules de l’État. La loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 donne une compétence exclusive aux juridictions judiciaires pour traiter ces litiges, substitue la responsabilité de l’État à celle de ses agents, et s’applique à tous types de véhicules (terrestres, maritimes, aériens).
Cette législation trouve son fondement dans la volonté d’unifier le contentieux des accidents de circulation tout en désengorgeant les juridictions administratives. Pour le justiciable, cette disposition s’avère favorable puisqu’elle garantit l’indemnisation par une personne publique solvable.
L’État demandeur en matière pénale
L’État comme organisme de sécurité sociale
Quand ses agents sont victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, l’État prend en charge les frais médicaux et les indemnités. En tant que tiers payeur, il peut ensuite se retourner contre les responsables pour obtenir le remboursement des sommes versées.
L’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a modifié le régime du recours subrogatoire des tiers payeurs en introduisant trois réformes majeures :
- Un recours poste de préjudice par poste de préjudice
- Un droit de préférence pour la victime partiellement indemnisée
- La limitation du recours aux préjudices pris en charge
La Cour de cassation a précisé dans plusieurs arrêts de mai et juin 2009 que les prestations d’invalidité peuvent s’imputer non seulement sur les pertes de revenus, mais aussi, pour leur part excédentaire, sur le déficit fonctionnel permanent. Une jurisprudence confirmant que les pensions de retraite prématurée s’imputent uniquement sur les préjudices économiques a suivi (Civ. 2e, 25 octobre 2012, n° 11-24.029).
L’État victime directe d’une infraction
Constitution de partie civile
L’État peut aussi être victime directe d’infractions et exercer les droits reconnus à la partie civile. Il intervient notamment en cas de détournement de fonds publics, d’atteintes à ses biens, ou de vol d’œuvres d’art lui appartenant.
Dans les affaires de dégradation du domaine public routier, l’AJE peut se constituer partie civile pour demander réparation. Les tribunaux de police sont compétents pour ordonner la réparation des dommages causés à la voie publique, sur demande du ministère public.
Reconnaissance du préjudice moral de l’État
La jurisprudence a progressivement admis l’existence d’un préjudice moral pour l’État. Dans un arrêt du 10 mars 2004, la Cour de cassation a reconnu que l’État pouvait demander réparation du préjudice moral résultant de délits commis par ses agents, lorsque ces agissements « jettent le discrédit sur l’ensemble de la fonction publique et affaiblissent l’autorité de l’État » (Crim. 10 mars 2004, n° 02-85.285).
Cette évolution jurisprudentielle s’est confirmée avec des décisions ultérieures, comme l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 25 mai 2016 (RG n° 16/00420) concernant un détournement de fonds par une greffière-régisseuse. La cour a reconnu un préjudice moral résultant de l’atteinte au crédit de l’État et de l’autorité judiciaire.
Détournements de fonds européens
Pour les détournements de fonds européens, l’AJE est compétent pour agir devant les juridictions françaises. Les textes européens, notamment l’article 280 du Traité instituant la Communauté européenne, imposent aux États membres de prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude contre les intérêts financiers de l’Union que pour leurs propres intérêts.
Dans une affaire jugée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (25 octobre 2011, RG n° 11/00376), l’AJE s’est valablement constitué partie civile pour obtenir réparation du préjudice financier subi par l’État suite au détournement de subventions européennes (fonds FEDER).
Stratégies pour les justiciables
- Identifier le bon interlocuteur : dans les litiges avec l’État impliquant une demande pécuniaire, l’AJE est le représentant légal exclusif, sous peine de nullité de la procédure.
- Évaluer la prescription applicable : l’État bénéficie d’une prescription quadriennale pour le paiement de ses créances, ce qui réduit les délais d’action par rapport au droit commun.
- Examiner les possibilités de transaction : l’AJE dispose d’un pouvoir de transaction une fois l’instance initiée. Cette voie permet souvent un règlement plus rapide et moins coûteux.
- Anticiper les spécificités procédurales : les règles d’exécution des décisions de justice contre l’État diffèrent du droit commun, notamment l’impossibilité de recourir aux voies d’exécution forcée.
Les litiges avec l’État présentent des particularités techniques qui peuvent dérouter. Un accompagnement juridique, dès les premières étapes de la procédure, garantit le respect des formalités et délais spécifiques qui s’imposent. Ne jamais oublier que derrière l’État, entité abstraite, se trouve un représentant précis dont l’identité conditionne la validité même de l’action.
Sources
- Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 relative au contentieux des dommages causés par un véhicule
- Article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (article 25) modifiant le recours subrogatoire des tiers-payeurs
- Jurisprudence : Crim. 10 mars 2004, n° 02-85.285 ; Civ. 2e, 25 octobre 2012, n° 11-24.029
- Tribunal judiciaire d’Albi, 10 septembre 2019, RG n° 18/00291
- Cour d’appel de Paris, 14 juin 2019, RG n° 14/11246
- Cour d’appel de Lyon, 25 mai 2016, RG n° 16/00420
- Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 25 octobre 2011, RG n° 11/00376
« `