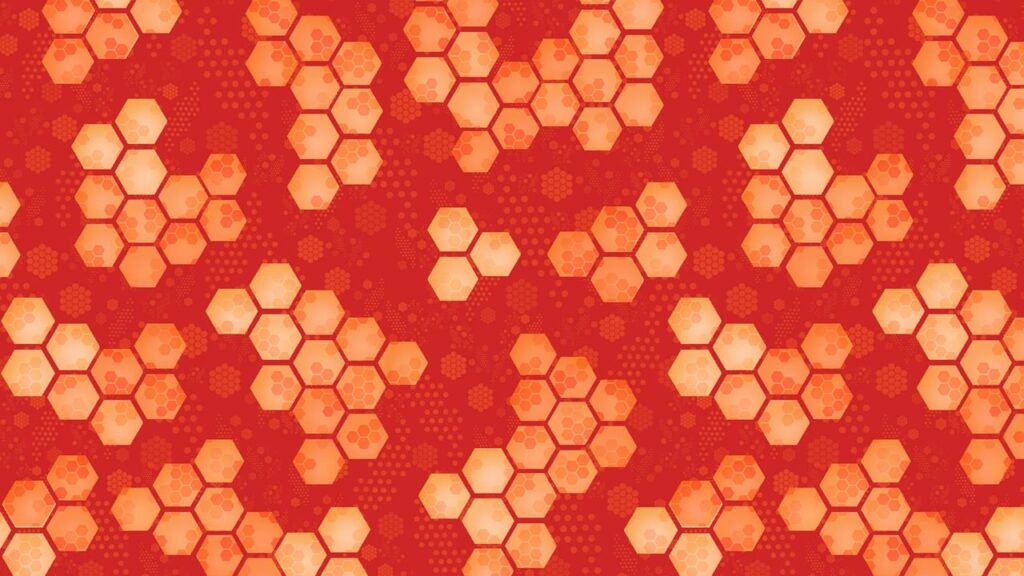Vous avez confié un objet de valeur à quelqu’un qui refuse de vous le rendre ? Vous avez acheté un bien que le vendeur ne vous livre pas ? La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer représente une solution efficace pour obtenir rapidement un titre exécutoire. Elle permet de forcer la remise d’un bien meuble sans passer par un procès classique.
Présentation de la procédure d’injonction
Définition et objectif
L’injonction de délivrer ou de restituer est une procédure simplifiée permettant à un créancier d’obtenir un titre exécutoire pour contraindre un débiteur à lui remettre un bien meuble. Elle vise à éviter le recours à une procédure judiciaire longue et coûteuse.
Comme le précise l’article L. 222-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Il s’agit d’une procédure non contradictoire dans un premier temps, reposant sur le principe de l’inversion du contentieux.
Cadre légal
Cette procédure est régie par les articles R. 222-11 à R. 222-16 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces textes déterminent les conditions de recevabilité, la compétence juridictionnelle, et les suites possibles de l’ordonnance.
Intérêt de cette procédure
L’intérêt majeur réside dans sa rapidité et son efficacité. Sans cette procédure, il faudrait engager une action au fond devant le tribunal, avec les délais que cela implique.
Par exemple, pour un commerçant ayant vendu un matériel sous réserve de propriété et dont l’acheteur ne paie pas, cette procédure permet de récupérer rapidement le bien.
Mise en œuvre de la procédure
Dépôt de la requête
La requête doit être présentée au juge de l’exécution. Elle doit contenir, à peine d’irrecevabilité, plusieurs éléments :
- La désignation détaillée du bien dont la remise est demandée
- Les justificatifs de la demande (contrat, bon de commande, preuve de paiement…)
Comme le souligne l’article R. 222-12 du Code des procédures civiles d’exécution : « À peine d’irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande. »
Les justificatifs varient selon l’origine du droit invoqué. La jurisprudence a clarifié qu’il n’est pas nécessaire qu’un contrat existe entre le propriétaire et le débiteur du bien revendiqué (CA Paris, 9 mai 1996).
Compétence du juge de l’exécution
Le juge compétent est exclusivement le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Cette règle est d’ordre public.
L’article R. 222-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que : « La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d’office son incompétence. »
Ni le président du tribunal de commerce, ni le juge du surendettement ne sont compétents en la matière. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 24 novembre 1993 (n° 91-16.740).
Contenu de l’ordonnance
Si le juge fait droit à la requête, l’ordonnance comporte une injonction adressée au débiteur de délivrer ou de restituer le bien. Cette ordonnance doit être motivée, même si elle est rendue non contradictoirement.
La motivation peut être succincte. La Cour de cassation admet qu’une ordonnance puisse adopter les motifs de la requête sans les reproduire (Cass. 1re civ., 24 oct. 1978).
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation en opportunité. Il peut refuser ou modifier les conditions de transport et de remise du bien sollicitées.
Suites de l’ordonnance
Signification de l’ordonnance
L’ordonnance doit être signifiée à la personne tenue de la remise par un huissier de justice. Elle ne peut pas être simplement notifiée par voie postale.
Selon l’article R. 222-13 du Code des procédures civiles d’exécution, la signification contient, à peine de nullité, une sommation précisant deux options pour le débiteur :
- Soit transporter le bien à ses frais au lieu indiqué dans un délai de 15 jours
- Soit former opposition s’il dispose de moyens de défense
Cette signification a été jugée abusive lorsqu’elle a été délivrée après que le créancier gagiste a reçu paiement de la somme garantie par le bien réclamé (TGI Riom, JEX, 23 mars 1993).
Délai d’opposition et apposition de la formule exécutoire
Le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification pour former opposition.
Sans opposition dans ce délai, le créancier peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire. Cette formalité transforme l’ordonnance en titre exécutoire ayant les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.
Le greffier qui délivre la formule exécutoire vérifie uniquement l’absence d’opposition, sans contrôler la régularité de la signification.
Exécution forcée
Une fois la formule exécutoire apposée, l’ordonnance devient un titre exécutoire permettant la mise en œuvre d’une saisie-appréhension.
L’article R. 222-16 offre un avantage supplémentaire : si l’appréhension est réalisée dans un délai de deux mois à compter de l’exécutoire, elle peut être effectuée sans commandement préalable, ce qui crée un effet de surprise.
Cette mesure efficace est possible si le bien se trouve « entre les mains de la personne visée dans l’injonction », même sans les conditions habituelles de l’article R. 222-3 (présence du débiteur et absence d’offre de transport).
Contestations et voies de recours
Opposition du débiteur
L’opposition est une voie de recours spécifique ouverte au débiteur. Elle doit être formée au greffe du juge de l’exécution par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette opposition n’a pas à être motivée. La Cour d’appel d’Arras l’a confirmé dans une décision du 9 décembre 1993. Le débiteur doit cependant exprimer clairement son intention de contester.
La forme de l’opposition est encadrée par l’article R. 222-13, 2° du Code des procédures civiles d’exécution. La jurisprudence a précisé qu’il n’est pas nécessaire que le terme « opposition » soit mentionné, si le désaccord est clairement exprimé (CA Rennes, 8 nov. 2013, n° 11/04329).
Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sans distinction selon que l’ordonnance a été signifiée à personne ou non.
Saisine du juge du fond
En cas d’opposition, c’est au demandeur à la remise de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
L’article R. 222-14 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « En cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. »
Le juge compétent est le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature du litige, et non le juge de l’exécution qui n’a pas compétence pour connaître du fond.
Conséquences de l’opposition
L’opposition fait obstacle à ce que l’ordonnance devienne exécutoire. Elle ne saisit cependant aucune juridiction automatiquement.
Si la juridiction compétente n’est pas saisie dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, celle-ci devient caduque, ainsi que les mesures conservatoires prises.
La Cour de cassation a précisé que le défaut de saisine de la juridiction compétente n’entraîne la caducité qu’en cas d’opposition régulière (Cass. 2e civ., 7 janv. 1999, n° 96-20.975).
Caducité des mesures conservatoires
La caducité frappe non seulement l’ordonnance mais aussi les mesures conservatoires prises sur son fondement, comme une saisie-revendication.
Cette caducité intervient si le juge du fond n’est pas saisi dans les deux mois de la signification de l’ordonnance. Le créancier doit donc être vigilant sur ce délai.
L’article R. 222-14, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution est clair : « La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. »
La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer constitue un outil précieux pour les créanciers. Elle permet d’obtenir rapidement la remise d’un bien sans passer par une procédure longue au fond. Toutefois, sa mise en œuvre exige une expertise juridique et une attention particulière aux délais et formalités.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution : articles L. 222-1 à L. 222-2 et R. 222-11 à R. 222-16
- Cour de cassation, 1re Civ., 24 novembre 1993, n° 91-16.740
- Cour de cassation, 1re Civ., 24 octobre 1978
- Cour de cassation, 2e Civ., 7 janvier 1999, n° 96-20.975
- Cour d’appel de Paris, 9 mai 1996
- Cour d’appel de Rennes, 8 novembre 2013, n° 11/04329
- TGI Riom, JEX, 23 mars 1993
- Cour d’appel d’Arras, JEX, 9 décembre 1993
- « Saisie-revendication » – Rémy BOUR – Avril 2017, Répertoire de procédure civile
- « Saisie-appréhension – Rémy BOUR – Décembre 2015, Répertoire de procédure civile
- « Saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels » – Catherine Tirvaudey-Bourdin – JurisClasseur Procédure civile – Août 2022