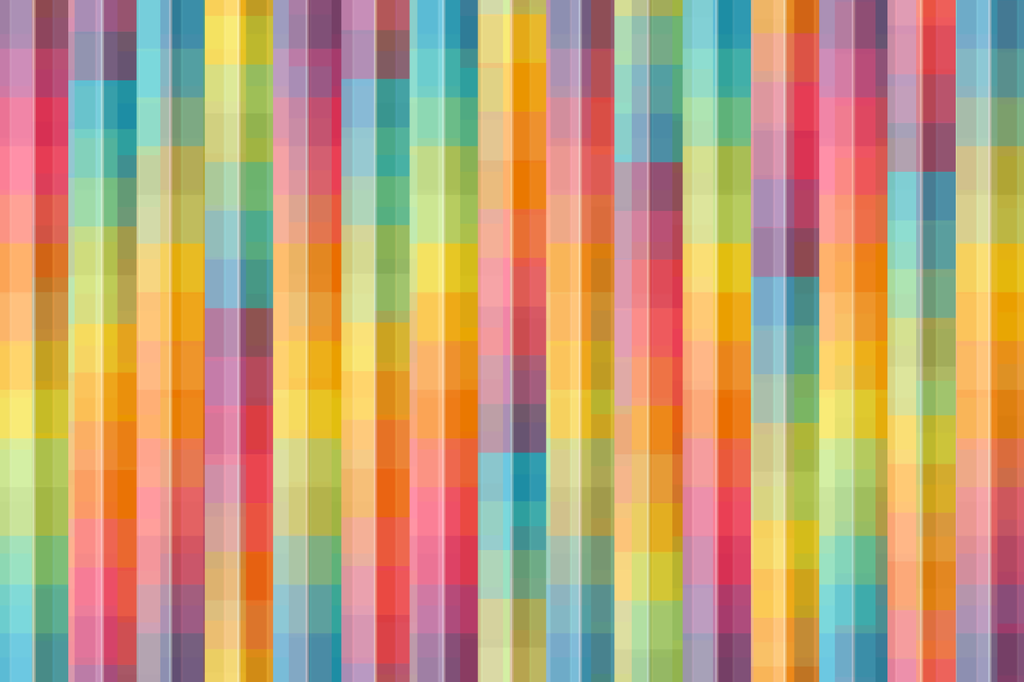Lorsqu’un créancier s’inquiète du recouvrement de sa dette, l’inaction peut coûter cher, face à un débiteur susceptible d’organiser son insolvabilité. Les mesures conservatoires constituent des outils juridiques préventifs, conçus pour sécuriser et préserver les droits du créancier en attendant une décision de justice définitive. Elles permettent de « geler » une partie du patrimoine du débiteur afin de garantir sa solvabilité future. La prise d’une mesure conservatoire est une démarche technique qui requiert l’expertise d’un avocat pour garantir sa validité et son efficacité. Cet article a pour but de fournir une vue d’ensemble de ces mécanismes essentiels des voies d’exécution, en survolant les aspects qui sont traités en profondeur dans nos ouvrages dédiés.
Introduction aux mesures conservatoires : finalité et cadre général
Le but premier d’une mesure conservatoire est de parer à l’insolvabilité potentielle d’un débiteur. Il s’agit d’une action préventive qui vise à garantir l’efficacité d’une future exécution forcée. Concrètement, elle frappe certains biens du débiteur d’indisponibilité, l’empêchant de les vendre, de les donner ou de les dissimuler. Le demandeur qui prend l’initiative d’une telle mesure cherche à sauvegarder son droit de gage général, c’est-à-dire le droit pour tout créancier de saisir les biens de son débiteur pour obtenir le paiement de sa créance. Ces procédures agissent comme une véritable garantie judiciaire, assurant au poursuivant que les biens resteront dans le patrimoine du débiteur jusqu’à ce que la dette soit réglée.
Distinction fondamentale : saisies conservatoires et sûretés judiciaires
Le Code des procédures civiles d’exécution distingue deux grandes familles de mesures conservatoires, qui partagent des dispositions communes mais dont les mécanismes au but différent. D’une part, les saisies conservatoires visent à rendre indisponibles des biens mobiliers appartenant au débiteur. Il peut s’agir de biens corporels (un véhicule, du mobilier) ou incorporels. Parmi les saisies, la plus courante est sans doute la saisie conservatoire de créances, qui permet de bloquer les fonds détenus par un tiers, comme une banque. D’autre part, les sûretés judiciaires ont pour objet de grever un bien d’une garantie au profit du créancier. Elles prennent la forme d’inscriptions provisoires d’hypothèque sur un immeuble ou de nantissement sur un fonds de commerce. Cette inscription confère au bénéficiaire un droit de préférence sur le bien, lui assurant d’être payé en priorité en cas de vente.
Les conditions générales de mise en œuvre des mesures conservatoires
Le recours à une mesure conservatoire n’est pas anodin et est subordonné à des conditions précises, qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire ou non. Cette matière est encadrée par une loi stricte pour protéger chaque personne impliquée.
Exigence d’une créance fondée en son principe et d’une menace de recouvrement
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution pose une double condition. Premièrement, le créancier doit justifier d’une créance qui « paraît fondée en son principe ». Une apparence de droit suffit à ce stade. Deuxièmement, il doit prouver l’existence de « circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Cette menace ne se résume pas au simple risque d’insolvabilité mais peut être caractérisée par des comportements concrets du débiteur : la pratique de dissipation de son actif, des donations suspectes à des proches, ou encore sa mauvaise foi manifeste face aux tentatives de recouvrement amiable, pouvant causer un dommage irréversible.
L’autorisation judiciaire préalable ou la dispense
En principe, toute mesure conservatoire doit être autorisée par un juge. Toutefois, l’article L. 511-2 du même code prévoit des cas de dispense importants. Le créancier n’a pas besoin d’autorisation judiciaire s’il est déjà en possession :
- d’un titre exécutoire, même non définitif ;
- d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ;
- d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque impayé ;
- d’un contrat de louage d’immeubles écrit, pour les loyers impayés.
Dans ces situations, le droit du demandeur est suffisamment établi pour lui permettre d’agir directement, sous sa propre responsabilité. L’application de cette dispense doit être rigoureuse.
Le rôle central du juge de l’exécution (jex) et du président du tribunal de commerce
La mise en place et la contestation des mesures conservatoires sont placées sous le contrôle de magistrats spécialisés, garantissant l’équilibre entre les droits du créancier et la protection du débiteur, conformément aux principes de la procédure civile.
Compétence d’attribution et territoriale du jex pour les mesures conservatoires
Le Juge de l’Exécution (JEX) est le juge naturel des mesures conservatoires. C’est le juge du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur qui est compétent pour autoriser la mesure. Par exception, lorsque la créance est de nature commerciale et qu’aucune instance n’a encore été engagée, l’autorisation peut être demandée au président du tribunal de commerce, en application du code de commerce. Le JEX dispose d’une compétence exclusive pour trancher les difficultés relatives à l’exécution de ces mesures, ses pouvoirs lui permettant d’apprécier la validité du titre, l’apparence de la créance et la réalité de la menace.
Procédure de mainlevée et de contestation
Le débiteur qui estime qu’une mesure conservatoire a été pratiquée à tort peut en demander la mainlevée. Le juge compétent varie : si la mesure a été autorisée par un juge, la demande doit lui être adressée. Si elle a été pratiquée sans accord préalable, la contestation est portée devant le JEX du lieu où demeure le débiteur. Le débiteur peut contester la mesure et formuler des demandes de mainlevée, par exemple en fournissant une garantie suffisante pour couvrir le montant de la créance. Toutes les autres contestations, notamment celles qui touchent à l’exécution même de la saisie, relèvent de la compétence du JEX du lieu d’exécution.
Délais impératifs et risque de caducité des mesures conservatoires
La validité des mesures conservatoires est conditionnée au respect de délais stricts, dont l’inobservation entraîne leur disparition rétroactive. Cette règle vise à ne pas laisser le débiteur dans une situation d’incertitude.
Délai d’exécution de la mesure et d’obtention du titre exécutoire
Une fois l’ordonnance d’autorisation obtenue, le créancier dispose d’un délai de trois mois pour la faire exécuter par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Passé ce délai, l’autorisation devient caduque. De plus, après l’exécution de la mesure, si le créancier ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire, il a l’obligation d’engager une procédure ou une instance pour en obtenir un. Cette action en justice doit être introduite dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire. Le non-respect de ce délai est sanctionné par la caducité de la mesure, qui est alors considérée comme n’avoir jamais existé.
Les effets généraux des mesures conservatoires : indisponibilité des biens et droit de gage général du créancier
Une fois mise en place, la mesure conservatoire produit des effets juridiques immédiats et contraignants pour le débiteur, tout en conférant des droits spécifiques au créancier pour sécuriser la valeur de sa créance.
Conséquences de l’indisponibilité des biens saisis
L’effet principal d’une saisie conservatoire est de rendre les biens saisis indisponibles. Le débiteur en conserve la garde et l’usage, mais il lui est formellement interdit de les vendre, de les donner ou de les déplacer. Tout acte de disposition accompli en violation de cette interdiction serait inopposable au saisissant et exposerait le débiteur à des sanctions pénales pour réparer le préjudice. Cette indisponibilité garantit que les biens resteront dans le patrimoine du débiteur pour pouvoir être saisis ultérieurement.
Le droit de gage général du créancier et la protection des intérêts
Les mesures conservatoires sont l’une des expressions les plus concrètes du droit de gage général reconnu à tout créancier sur le patrimoine de son débiteur. Elles permettent de transformer un droit théorique en une garantie effective. Dans le cas d’une saisie conservatoire de créances, la mesure confère même au créancier saisissant un droit de préférence sur les sommes bloquées. Cela signifie qu’il sera payé avant les autres créanciers chirographaires sur les fonds rendus indisponibles, une actualité juridique constante en droit des affaires.
Articulation avec les procédures de surendettement des particuliers
La situation d’un débiteur peut se complexifier lorsqu’une mesure conservatoire entre en collision avec une procédure de surendettement, un domaine où des règles protectrices spécifiques s’appliquent pour prévenir une situation de détresse pour une personne, tel qu’un salarié.
Suspension automatique des poursuites et effacement des dettes
Lorsqu’un particulier, par exemple un salarié, dépose un dossier de surendettement et que celui-ci est déclaré recevable, des conséquences immédiates se produisent. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité entraîne la suspension légale et automatique des procédures d’exécution, ce qui inclut les mesures conservatoires en cours. Il est alors interdit aux créanciers de pratiquer une mesure conservatoire. Cette suspension a pour but de stabiliser les ressources financières du débiteur. Dans les cas les plus graves, si une procédure de rétablissement personnel est prononcée, elle aboutit à un effacement des dettes non professionnelles, ce qui anéantit définitivement les créances et les mesures qui les garantissaient, notamment sur un bien immobilier. Ce besoin de protection du salarié et de sa famille est au cœur du dispositif.
Le processus de conversion des mesures conservatoires en mesures d’exécution forcée
Une mesure conservatoire n’est qu’une étape préliminaire. Pour obtenir le paiement effectif, le demandeur doit la transformer en une mesure d’exécution forcée une fois qu’il a obtenu une décision de justice définitive.
Conversion de la saisie conservatoire de biens mobiliers corporels en saisie-vente
Dès que le créancier obtient un titre exécutoire, il peut demander la conversion en saisie-vente. Il doit pour cela signifier au débiteur un acte de conversion qui lui donne un dernier délai pour payer. Si le débiteur ne s’exécute pas, l’intervention du commissaire de justice peut alors procéder à la vente des biens. Le débiteur dispose d’un mois pour tenter de vendre les biens à l’amiable lui-même ; à défaut, il sera procédé à une vente forcée aux enchères publiques.
Conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution
Pour les créances, la conversion en saisie-attribution est une étape clé qui transfère immédiatement la propriété de la somme saisie au créancier. L’acte de conversion, signifié au tiers saisi (généralement la banque), vaut attribution immédiate. Le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester. En l’absence de contestation, le tiers saisi doit verser les fonds au créancier. Cette procédure est particulièrement efficace car elle assure un règlement rapide.
La mise en œuvre d’une mesure conservatoire est une démarche technique qui requiert une analyse approfondie et une information précise pour garantir sa validité et son efficacité. Si vous êtes confronté au sein de votre entreprise à un risque de non-recouvrement de vos créances, n’hésitez pas à contacter notre cabinet pour un conseil sur mesure.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’une mesure conservatoire ?
Une mesure conservatoire est une procédure d’urgence qui permet à un créancier de rendre indisponibles des biens de son débiteur pour sécuriser le paiement futur d’une dette, avant même d’avoir obtenu un jugement définitif.
Quelle est la différence entre une saisie conservatoire et une sûreté judiciaire ?
La saisie conservatoire bloque des biens mobiliers (argent, véhicule) pour empêcher leur disparition. La sûreté judiciaire (hypothèque, nantissement) grève un bien, souvent un actif immobilier, d’une garantie au profit du créancier, lui donnant un droit de préférence en cas de vente, sans pour autant rendre le bien matériellement indisponible.
Faut-il toujours l’autorisation d’un juge ?
Non, une autorisation n’est pas nécessaire si le demandeur dispose déjà d’un titre exécutoire (même non définitif), d’une décision de justice, d’un chèque impayé ou d’un contrat de bail écrit pour des loyers impayés.
Combien de temps une mesure conservatoire est-elle valable ?
Après son exécution, si le créancier n’a pas de titre exécutoire, la loi impose d’engager une procédure pour en obtenir un dans un délai d’un mois. Faute de quoi, la mesure devient caduque et est considérée comme n’ayant jamais existé.
Peut-on contester une mesure conservatoire ?
Oui, le débiteur peut demander la mainlevée de la mesure devant le juge qui l’a autorisée ou, à défaut, devant le Juge de l’Exécution, s’il estime que les conditions ne sont pas réunies (créance non fondée, absence de menace) ou en fournissant une garantie suffisante.
Que se passe-t-il après avoir obtenu un jugement définitif ?
La mesure conservatoire doit être « convertie » en mesure d’exécution forcée : une saisie-vente pour les biens mobiliers ou une saisie-attribution pour les créances, afin de permettre au créancier d’être effectivement payé.