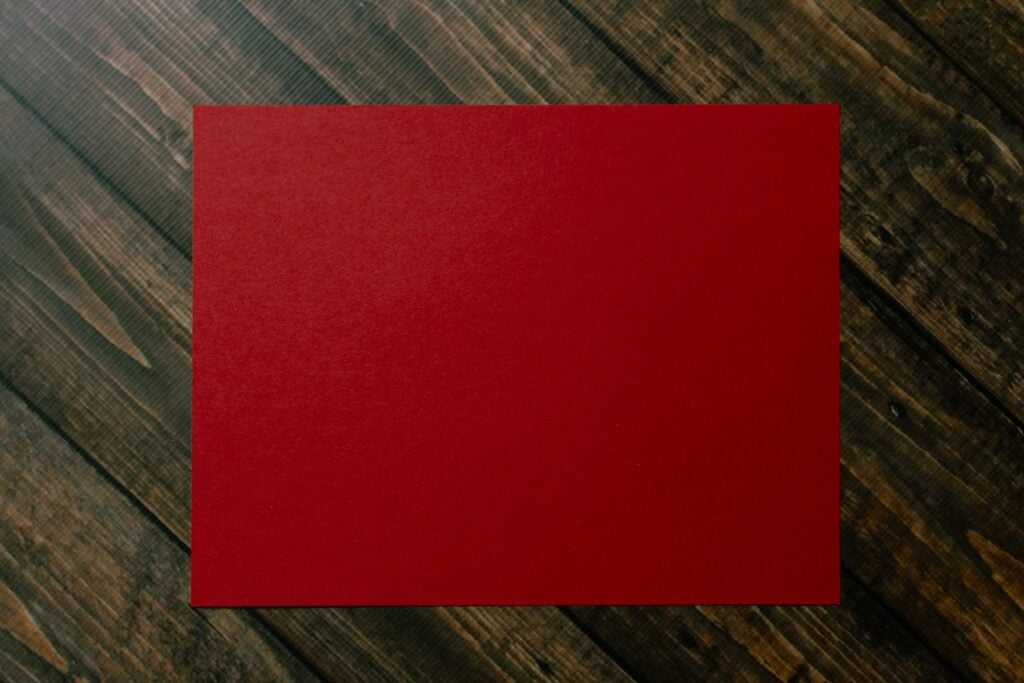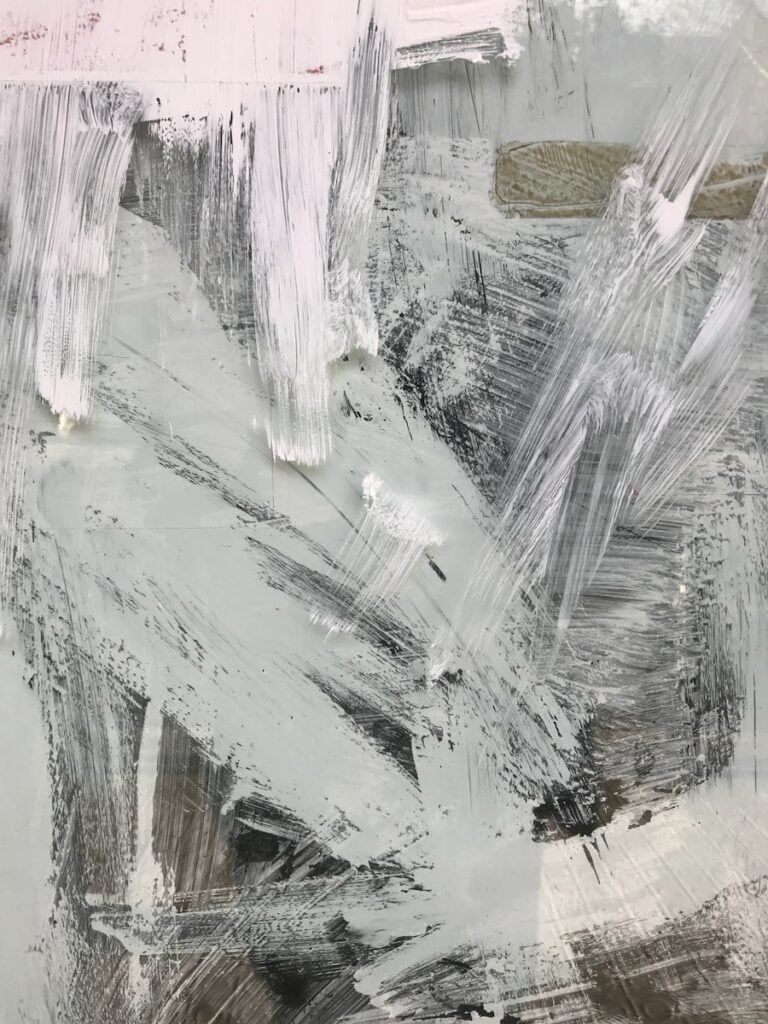La conclusion d’un procès soulève une question essentielle pour le client et son conseil : qui paie les frais de justice ? L’article 696 du Code de procédure civile pose un principe général : la partie perdante est, sauf décision motivée du juge, condamnée aux dépens. Cependant, une confusion fréquente existe entre les dépens, qui sont une catégorie de frais précisément définie, et l’ensemble des coûts juridiques réellement supportés au cours d’une procédure. Une part significative des dépenses, notamment la majeure partie des honoraires de votre avocat, n’est pas comprise dans les dépens et relève d’un autre mécanisme, celui de l’article 700.
Mais alors, que recouvre précisément le terme de « dépens » ? Quels sont les frais spécifiques que la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser ? Il ne s’agit pas d’une notion vague laissée à l’appréciation du juge. Au contraire, la loi est très claire. C’est l’article 695 du Code de procédure civile qui en dresse la liste, et cette liste, fruit d’un cadre législatif précis, est strictement limitative. Il faut la considérer comme un inventaire exhaustif : si un frais n’y figure pas expressément, il ne peut être qualifié de dépens. Une analyse détaillée de cet article est donc indispensable pour tout justiciable souhaitant avoir une meilleure maîtrise du risque financier d’une décision de justice et des sommes qu’il peut espérer récupérer.
L’inventaire limitatif de l’article 695 du code de procédure civile
L’article 695 du Code de procédure civile énumère les seuls frais pouvant être qualifiés de dépens. Cette liste est limitative, ce que la jurisprudence constante de la cour supérieure confirme de manière constante. Concrètement, si une dépense n’est pas explicitement mentionnée dans cet article, elle ne pourra pas être mise à la charge de la partie perdante à ce titre. Elle pourra éventuellement faire l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles (article 700), mais son remboursement est alors laissé à la libre appréciation du juge. Comprendre cette liste est donc une première étape pour évaluer le risque financier d’une instance.
Les frais administratifs et fiscaux directement liés à la justice
Le premier poste de dépens, visé par le 1° de l’article 695, concerne les coûts générés par le fonctionnement de l’appareil judiciaire et administratif. Il s’agit des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou par l’administration fiscale. Sont par exemple concernés les frais de publication d’actes auprès d’un officier de la publicité foncière (anciennement conservation des hypothèques) lorsqu’une procédure porte sur un bien immobilier, comme dans le cas d’une saisie immobilière. Des contributions spécifiques, lorsqu’elles sont applicables, entrent aussi dans cette catégorie. On peut citer le « droit affecté au fonds d’indemnisation des avoués » ou la « contribution pour la justice économique », bien que cette dernière, instituée à titre expérimental depuis le 1er janvier 2025 à la suite du débat parlementaire, soit limitée à certains tribunaux de commerce.
Attention toutefois, ce texte du Code de procédure civile exclut expressément « les droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ». Si un jugement rendu constate une vente et que cette opération génère des droits d’enregistrement, ces derniers ne sont pas des dépens. Ils ne sont pas nés de la procédure elle-même, mais de la mutation de propriété.
Les coûts liés à l’intervention des professionnels de justice
Une part importante des dépens est constituée par la rémunération de certains professionnels dont l’intervention est requise par la loi ou une décision de justice. Leur juste compréhension est essentielle pour le client.
Les émoluments et débours des commissaires de justice
Les dépens incluent les « débours tarifés » (article 695, 5°) et les « émoluments des officiers publics ou ministériels » (article 695, 6°). Cela vise principalement les commissaires de justice (qui ont succédé aux huissiers de justice) pour les actes de procédure qu’ils accomplissent. Il peut s’agir de la signification d’une assignation, d’une saisie auprès d’un tiers saisi, ou de l’exécution d’une décision d’expulsion. Leurs « émoluments » correspondent à la partie de leur rémunération fixée par un tarif réglementé, tandis que les « débours » sont les frais qu’ils ont avancés pour réaliser un acte (par exemple, les frais de serrurier lors d’une expulsion ordonnée). Si un notaire est commis par le juge pour une tâche précise dans le cadre du procès, par exemple pour élaborer un projet de partage, sa rémunération tarifée entre également dans les dépens.
La rémunération réglementée et limitée de l’avocat
C’est un point souvent source de confusion. L’article 695, 7° du Code de procédure civile précise que seule la rémunération des avocats « dans la mesure où elle est réglementée » constitue un dépens. Or, cette part réglementée, appelée « émolument de postulation », qui était la rémunération de l’avocat inscrit à un barreau pour représenter une partie devant un tribunal où il ne pouvait plaider lui-même, a été très largement supprimée. Elle ne subsiste que pour certaines matières très spécifiques comme la saisie immobilière, le partage judiciaire, la licitation ou les sûretés judiciaires.
À cela s’ajoute le « droit de plaidoirie », une contribution fixe de 13 € par plaidoirie, dont le montant est fixé par le ministre de la Justice et qui est bien un dépens. En dehors de ces cas résiduels, l’essentiel du travail de votre avocat (conseil, analyse, rédaction des conclusions, plaidoirie) est rémunéré par des honoraires libres qui ne sont pas des dépens. Ils relèvent des frais de l’article 700, dont nous parlerons plus loin.
La rémunération des experts et techniciens désignés par le juge
Il s’agit souvent du poste de dépens le plus conséquent. L’article 695, 4° vise la rémunération des « techniciens ». Ce terme recouvre principalement les experts judiciaires, mais aussi les consultants ou constatants désignés par une décision de justice pour éclairer le tribunal sur un point technique. Le point fondamental est le suivant : seule la rémunération du technicien officiellement commis par le juge entre dans les dépens. Si une partie mandate de sa propre initiative un expert pour obtenir un rapport privé afin de constituer une preuve, les honoraires de ce dernier ne seront pas qualifiés de dépens. Ils pourront, au mieux, être partiellement remboursés sur le fondement de l’article 700.
Les frais liés à l’audition et à la protection des personnes
Un procès peut nécessiter de faire entendre des personnes ou de protéger leurs intérêts. Les frais associés peuvent être qualifiés de dépens.
- L’indemnité des témoins : Lorsqu’une personne est officiellement citée à comparaître pour témoigner, que ce soit au tribunal ou lors d’une mesure d’instruction comme une enquête, elle a droit à une indemnité. L’article 695, 3° prévoit que cette indemnité est un dépens. Elle couvre les frais de transport, d’hébergement et la compensation pour la perte de salaire subie.
- L’audition du mineur : Dans les procédures impliquant un enfant (divorce, autorité parentale, union civile) et affectant son état civil, le juge peut désigner une personne qualifiée pour l’entendre (psychologue, enquêteur social…). La rémunération de cette personne désignée par le juge est un dépens, comme le spécifie l’article 695, 11°.
- L’enquête sociale : De même, les frais des enquêtes sociales ordonnées par le juge en matière familiale (adoption, tutelles) sont des dépens (article 695, 10°).
Les frais de procédure à dimension internationale
Quand une affaire a une dimension internationale, des coûts spécifiques apparaissent. L’article 695 du Code de procédure civile en tient compte. Sont ainsi compris dans les dépens :
- Les frais de traduction des actes lorsque la loi, un contrat international ou un engagement international de la France l’exige (article 695, 2°). C’est le cas pour la signification d’un acte de procédure à une partie résidant à l’étranger.
- Les frais de notification d’un acte à une personne se trouvant dans un autre pays (article 695, 8°).
- Les frais d’interprétariat et de traduction nécessaires pour des mesures d’instruction (expertise, audition) menées à l’étranger à la demande d’une juridiction française, dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment au sein de l’Union européenne (article 695, 9°).
La règle est stricte : si vous faites traduire des documents pour les besoins de votre dossier sans qu’une obligation légale ou une décision du juge ne l’impose, ces frais ne sont pas des dépens.
Ce que les dépens ne couvrent pas : les frais irrépétibles de l’article 700
L’analyse de l’article 695 est incomplète si l’on n’aborde pas ce qu’il exclut. C’est souvent là que se situe la plus grande part des coûts réels d’un procès pour un client. Ces frais, dits « irrépétibles », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile.
La distinction fondamentale avec les honoraires de l’avocat
Comme nous l’avons vu, la quasi-totalité des honoraires que vous versez à votre avocat pour son travail de conseil, d’analyse stratégique, de rédaction d’écritures et de plaidoirie n’est pas comprise dans les dépens. Ces frais constituent des honoraires dits « irrépétibles ». La partie qui gagne le procès peut demander au juge de condamner la partie adverse à lui rembourser une partie de ces honoraires. Le juge dispose cependant d’un pouvoir d’appréciation total : il peut accorder une somme, qui est souvent forfaitaire et ne couvre que rarement l’intégralité des honoraires payés, ou refuser toute indemnisation, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Cette distinction est essentielle pour que le client ait une vision juste des enjeux financiers, du gain potentiel et de l’opportunité de poursuivre ou non une affaire.
Les autres frais non compris dans les dépens
Au-delà des honoraires de l’avocat, de nombreux autres frais ne sont pas des dépens. On peut citer :
- Les honoraires d’un expert ou d’un consultant privé que vous mandatez vous-même.
- Vos frais de déplacement personnels pour assister aux audiences ou aux expertises.
- Les coûts de documentation et de recherche pour constituer votre dossier.
- Les frais de constat de commissaire de justice réalisés à votre initiative, sans décision judiciaire préalable.
Pour l’ensemble de ces frais, la seule voie de remboursement possible, hors prise en charge par un contrat d’assurance protection juridique, est une demande fondée sur l’article 700, avec l’aléa que cela comporte.
Le cas particulier des actes nuls par la faute d’un professionnel
Le Code de procédure civile protège le justiciable contre les erreurs des professionnels du droit. Si un acte de procédure se révèle inutile ou est annulé en raison d’une faute d’un avocat ou d’un commissaire de justice, les frais afférents ne sont pas considérés comme des dépens. Les articles 697 et 698 prévoient même que ces frais peuvent être mis directement à la charge du professionnel fautif. C’est une garantie importante pour qu’une négligence n’alourdisse pas la charge financière du procès pour le client.
La vérification et le recouvrement des dépens : une procédure encadrée
Une fois la décision de justice rendue et la condamnation aux dépens prononcée, leur recouvrement n’est pas automatique. Il suit une procédure spécifique qui vise à garantir la justesse des montants réclamés. La partie qui a obtenu la condamnation doit d’abord faire établir un compte détaillé de l’ensemble des dépens. Ce décompte est ensuite soumis au greffe du tribunal pour vérification administrative.
Le greffier délivre alors un « certificat de vérification » qui est notifié à la partie condamnée. Cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour le contester en temps utile. En l’absence de contestation avant l’expiration du délai, le certificat devient un titre exécutoire de plein droit. En cas de désaccord, la contestation est portée devant le président de la juridiction, qui statue par une « ordonnance de taxe ». Cette procédure garantit que seuls les frais légalement qualifiés de dépens et correctement calculés peuvent faire l’objet d’un recouvrement. La maîtrise de ces mécanismes, qui peuvent inclure une exécution provisoire de l’ordonnance de taxe, est souvent nécessaire pour procéder à l’exécution forcée du jugement.
Maîtriser la notion de dépens est indispensable pour toute personne engagée dans une procédure judiciaire. Cela permet non seulement de dialoguer efficacement avec son avocat sur les coûts prévisibles, mais aussi de comprendre la portée financière exacte d’un jugement rendu et passé en force de chose jugée. Pour une analyse approfondie de votre situation et une stratégie adaptée à vos enjeux, prenez contact avec notre cabinet : un juriste spécialisé vous apportera l’aide nécessaire.
Sources
- Code de procédure civile (CPC) : Articles 695, 696, 697, 698, 700 à 725. Cette codification est la source principale du droit en la matière.
- Code de commerce (C. Com) : Pour les tarifs réglementés des avocats, des commissaires de justice et autres auxiliaires, ainsi que la classification des actes de procédure.
- Code de la sécurité sociale (CSS) : Pour les dispositions relatives au droit de plaidoirie.
- Doctrine et jurisprudence : Les avis des grands juristes et les arrêts de principe (notamment ceux publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation) permettent de comprendre l’esprit des textes et leur application concrète.
- Bulletins d’information juridique et journaux officiels : (par exemple, le Journal Officiel de la République Française pour les lois et décrets, comme celui du 1er octobre 2011 sur la contribution juridique).