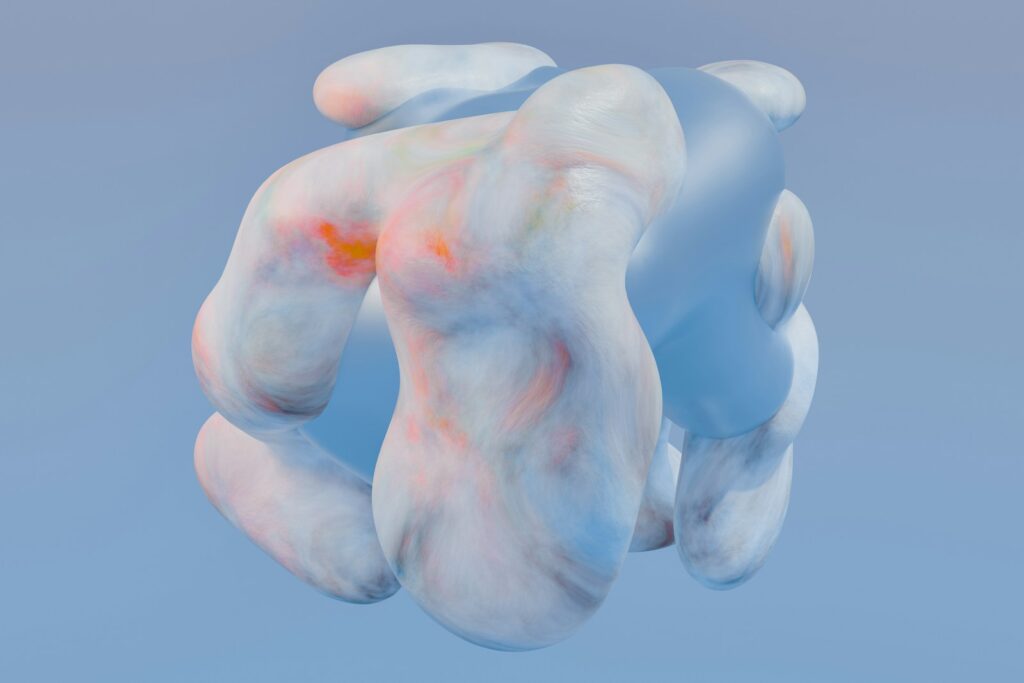Dans une économie où les échanges commerciaux et industriels reposent sur la précision et la fiabilité des mesures, la France, comme tous les pays développés, dispose d’un cadre juridique strict encadrant les unités de mesure. Cette réglementation, parfois méconnue des entreprises, constitue pourtant un élément fondamental du droit commercial et peut entraîner des sanctions en cas de non-respect. Comprendre les obligations liées aux unités de mesure s’avère donc essentiel pour tout professionnel utilisant des instruments de mesure dans le cadre de ses activités.
Le système international d’unités (SI) en France
Historique et fondements juridiques
Le système métrique décimal est obligatoire en France depuis la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures. Cette loi historique a posé les bases d’un système unifié qui a ensuite évolué pour devenir ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Système International d’unités (SI).
Ce système a été consacré au niveau international par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM). En droit français, c’est principalement le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, qui définit les unités légales. Ce texte fondamental a été modifié à plusieurs reprises pour s’adapter aux évolutions technologiques et aux harmonisations européennes.
Au niveau européen, la directive n° 80/181/CEE du 20 décembre 1979, modifiée par plusieurs directives ultérieures, harmonise l’emploi des unités de mesure dans l’ensemble de l’Union européenne.
Les unités de mesure légales en France
Le système légal français comprend sept unités SI de base :
- Le mètre (unité de longueur)
- Le kilogramme (unité de masse)
- La seconde (unité de temps)
- L’ampère (unité d’intensité du courant électrique)
- Le kelvin (unité de température thermodynamique)
- La mole (unité de quantité de matière)
- La candela (unité d’intensité lumineuse)
À ces unités de base s’ajoutent des unités supplémentaires comme le radian (angle plan) et le stéradian (angle solide), ainsi que des unités dérivées comme le mètre carré (superficie) ou le mètre cube (volume).
Par ailleurs, certaines unités hors système sont autorisées par l’article 4 du décret de 1961, comme le mille pour les distances en navigation maritime et aérienne (1 852 mètres) ou le nœud (vitesse correspondant à 1 mille par heure).
Le décret de 1961 est complété par un tableau général des unités de mesure légales en annexe, qui peut être consulté sur le site internet du Bureau de la métrologie du ministère de l’Industrie.
Obligations d’emploi des unités légales
Domaines d’application obligatoire
L’article 8 du décret du 3 mai 1961 interdit d’employer des unités de mesure autres que les unités légales pour la mesure des grandeurs dans plusieurs domaines précis :
- L’économie
- La santé
- La sécurité publique
- Les opérations à caractère administratif
Cette obligation s’applique à toutes les transactions commerciales, qu’il s’agisse de vente de biens ou de prestations de services, dès lors qu’une mesure intervient dans la détermination du prix ou des caractéristiques du produit ou service.
Concrètement, un commerçant ne peut pas, par exemple, vendre des tissus au yard, mais doit les proposer au mètre. De même, un garagiste ne peut pas indiquer la puissance d’un moteur uniquement en chevaux-vapeur, mais doit utiliser le kilowatt.
Exceptions et dérogations possibles
La règle connaît toutefois quelques exceptions. Ainsi, l’utilisation d’unités non légales est permise :
- Pour les nécessités du commerce international hors de l’Union européenne
- Dans le cadre de dérogations accordées par arrêté du ministre de l’Industrie, si l’intérêt public le rend nécessaire
Par ailleurs, il est possible d’ajouter des indications exprimées en d’autres unités à condition qu’elles soient secondaires par rapport à l’indication en unité légale. Ces indications complémentaires doivent être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l’indication principale en unité légale.
De plus, l’emploi d’unités de mesure qui ne sont plus légales reste autorisé pour les produits et équipements mis sur le marché avant le 1er mars 1982 ou en service à cette date, ainsi que pour leurs pièces et parties nécessaires à leur complément ou remplacement. Cette tolérance ne s’applique toutefois pas aux dispositifs indicateurs des instruments de mesure, qui doivent être gradués en unités légales.
Instruments de mesure : conformité aux unités légales
Obligations des fabricants et distributeurs
Les fabricants, importateurs et distributeurs d’instruments de mesure sont soumis à des obligations strictes. L’article 12 du décret du 3 mai 1961 leur interdit de :
- Mettre en vente, livrer, exposer, commander, mettre en service ou employer des instruments de mesure non conformes aux textes réglementaires
- Commercialiser des instruments comportant des inscriptions ou graduations autres que celles résultant de l’emploi des unités légales
Ces professionnels doivent s’assurer que les instruments qu’ils commercialisent sont conformes au système légal d’unités et, le cas échéant, disposent des certifications nécessaires (comme l’approbation de type ou la vérification primitive, que nous abordons dans notre article sur les procédures de contrôle des instruments de mesure).
La conformité aux unités légales est une condition préalable indispensable à la commercialisation des instruments de mesure et à leur mise en service sur le territoire français.
Obligations des utilisateurs professionnels
Les utilisateurs professionnels d’instruments de mesure sont également soumis à des obligations importantes. Ils ne peuvent détenir dans leurs locaux commerciaux ou professionnels (magasins, ateliers, établissements industriels ou commerciaux) des instruments non conformes aux unités légales.
Cette interdiction s’étend également à la détention sur la voie publique, dans les chantiers, ports, gares, aéroports, halles, foires ou marchés. La simple présence d’un instrument non conforme dans ces lieux peut donc être sanctionnée, même s’il n’est pas en usage.
Les professionnels doivent par ailleurs veiller au maintien en conformité de leurs instruments et s’assurer qu’ils font l’objet des vérifications périodiques requises par la réglementation. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 1961, le fait de mettre en service un appareil sans avoir demandé les vérifications prévues par les règlements est passible de sanctions.
Une exception existe toutefois pour les objets présentant un caractère historique ou artistique, ou ceux destinés à des fins scientifiques, qui peuvent déroger à ces règles.
Sanctions en cas de non-respect
Infractions et amendes prévues
Le non-respect des dispositions relatives aux unités de mesure est sanctionné par l’article 14 du décret du 3 mai 1961, qui prévoit l’application d’une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, soit 450 euros au maximum.
Cette sanction s’applique notamment aux infractions suivantes :
- La non-observation des règles relatives aux unités (article 5)
- L’emploi de dénominations ou symboles non réglementaires (article 6)
- L’utilisation d’unités autres que les unités légales (article 8)
- La mise en vente, livraison ou utilisation d’instruments non conformes (article 12-1°)
- La détention de tels instruments dans des lieux professionnels (article 12-2°)
En cas d’infraction, les instruments de mesure non conformes peuvent en outre être saisis et confisqués, même si l’auteur de l’infraction bénéficie de circonstances atténuantes.
Par ailleurs, l’article R. 643-2 du code pénal sanctionne également d’une amende prévue pour les contraventions de troisième classe l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements.
Jurisprudence et cas concrets
La jurisprudence fournit plusieurs exemples d’application de ces sanctions. Dans un arrêt du 16 mars 1982, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi condamné le président-directeur général d’un magasin de grande surface dont certaines pompes à essence étaient déplombées ou débitaient une quantité fausse de carburant.
Dans une autre affaire, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 21 novembre 1983, que ne méconnaît pas le système métrique légal une méthode d’évaluation de la surface locative brute d’un local commercial (méthode GLA) incluant l’épaisseur des murs et des cloisons séparatives, dès lors que cette surface est exprimée en mètres carrés, qui constituent l’unité de base légale.
Il convient de noter que les sanctions peuvent être aggravées lorsque l’infraction est constitutive d’une tromperie sur la quantité des choses livrées, en application de l’article L. 213-1 du code de la consommation. Dans ce cas, l’auteur de l’infraction encourt un emprisonnement de deux ans et une amende de 37 500 euros. Ces peines sont même doublées, selon l’article L. 213-2 du même code, si la tromperie a été commise à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts.
Enfin, au-delà des sanctions pénales, le non-respect de la réglementation peut également donner lieu à des actions civiles en dommages-intérêts intentées par les victimes, comme l’a reconnu la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 1893.
Pour éviter ces risques juridiques et financiers, nos services d’accompagnement en droit de la métrologie légale peuvent vous aider à mettre en place une stratégie de conformité adaptée à votre activité.
Besoin d’un conseil sur la conformité de vos instruments de mesure? Contactez notre cabinet pour un accompagnement personnalisé.
Sources
- Loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures
- Décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
- Directive européenne n° 80/181/CEE du 20 décembre 1979
- Code pénal, article R. 643-2
- Code de la consommation, articles L. 213-1 et L. 213-2