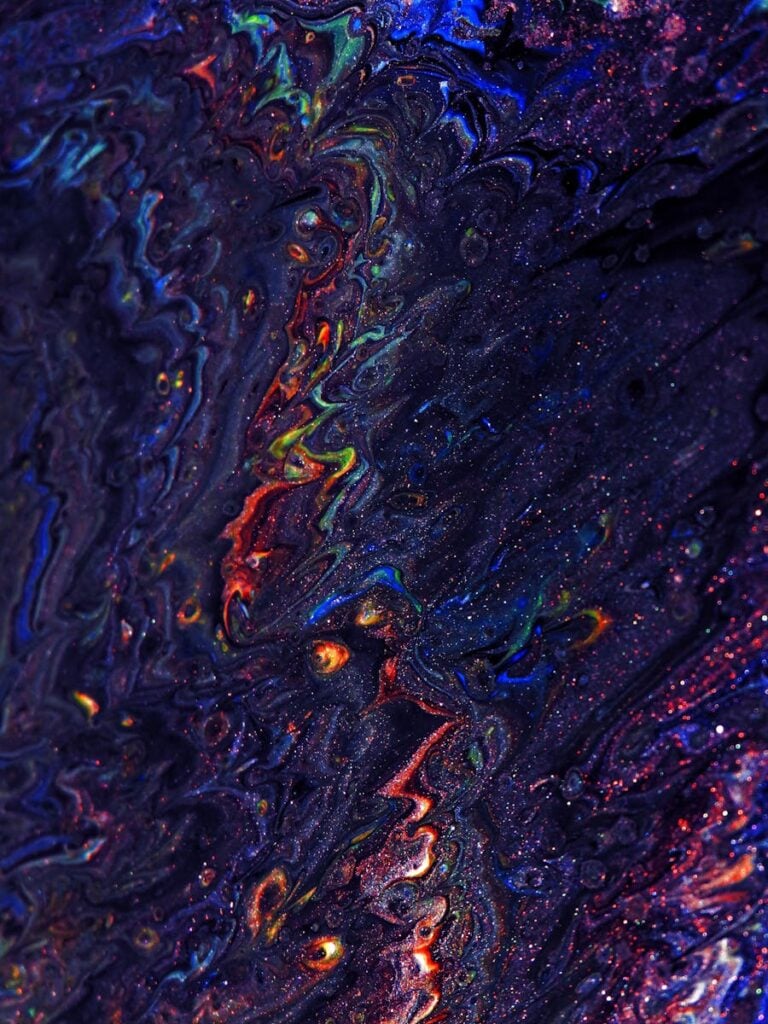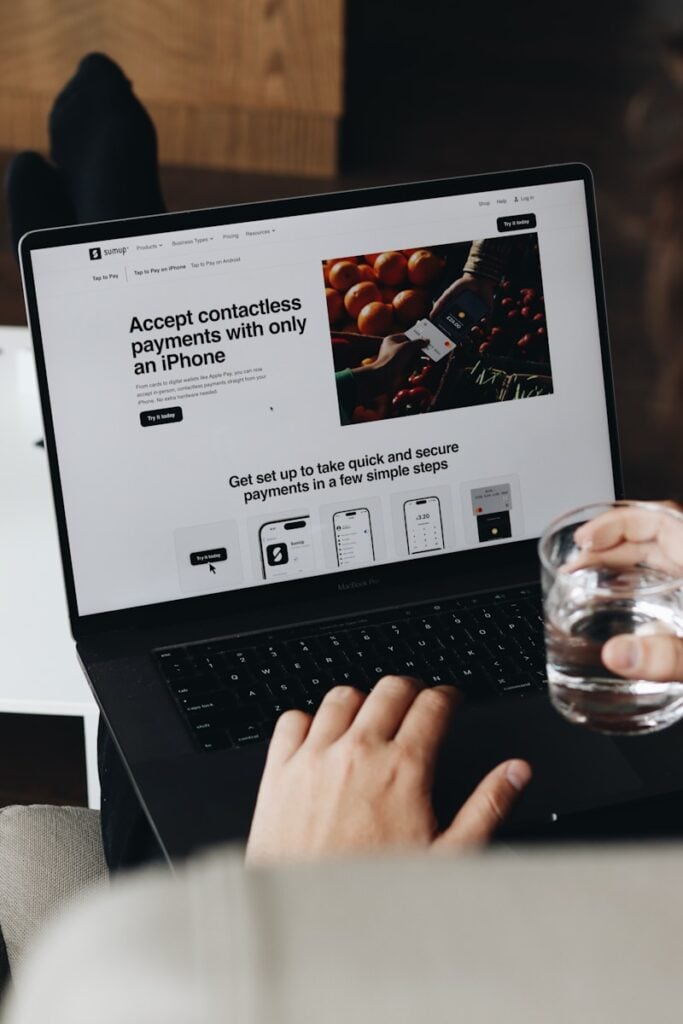La saisie-attribution, procédure d’exécution par excellence pour le recouvrement des créances de sommes d’argent, repose sur un principe simple en apparence : un créancier, muni d’un titre exécutoire, peut appréhender les sommes dues à son débiteur par un tiers. Cependant, cette simplicité s’efface lorsque la créance n’est pas encore née ou exigible au jour de la saisie. Le droit de l’exécution se heurte alors à une distinction fondamentale, subtile et aux conséquences pratiques majeures : celle entre la créance future mais certaine, qui entre dans le champ de la saisie, et la créance purement éventuelle, simple expectative insaisissable. Cette frontière, tracée par la jurisprudence, détermine la validité même de la procédure et engage la responsabilité de tous les acteurs, du créancier au tiers saisi.
Les fondements de la saisissabilité des créances en droit français
Pour saisir la complexité des créances futures, il est indispensable de revenir aux principes qui gouvernent la saisie-attribution. Il est crucial de comprendre la différence entre une mesure conservatoire, comme la saisie conservatoire, qui vise à garantir une créance, et une mesure d’exécution comme la saisie-attribution, qui vise à en obtenir le paiement forcé. Cette procédure est strictement encadrée par le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
Rappel des principes généraux de la saisie-attribution
La procédure de saisie-attribution est définie par l’art. L. 211-1 du CPCE. Elle permet à un créancier disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Avant d’aborder la distinction complexe entre créance certaine et éventuelle, il est essentiel de maîtriser les principes fondamentaux de la saisie-attribution et son mécanisme d’effet d’attribution immédiate. Ce mécanisme confère au créancier saisissant la propriété de la créance saisie dès l’acte de saisie signifié par l’huissier de justice, le tiers saisi (ou tiers détenteur) devenant son débiteur direct. Toutefois, le champ d’application de cette mesure connaît des exclusions notables. Les rémunérations du travail (ou salaire), en raison de leur caractère alimentaire, font l’objet d’une procédure spécifique, la saisie des rémunérations, qui organise une répartition entre les créanciers et préserve une fraction insaisissable pour le débiteur, connue sous le nom de solde bancaire insaisissable (SBI). De même, les créances purement alimentaires, comme les pensions, sont en principe insaisissables, sauf pour le paiement d’aliments déjà fournis.
Distinction avec les autres droits incorporels et simples facultés
La saisie-attribution est strictement cantonnée aux créances de sommes d’argent. Cette restriction la distingue d’autres mécanismes visant à appréhender le patrimoine du débiteur, comme la saisie-vente. Les droits incorporels tels que les parts sociales ou les valeurs mobilières ne relèvent pas de la saisie-attribution mais d’une procédure de saisie et de vente de droits incorporels. Le créancier doit alors provoquer la vente forcée de ces droits pour être payé sur le prix. Il faut également distinguer la créance, droit actuel dans le patrimoine du débiteur, de la simple faculté, qui n’est qu’une potentialité. Par exemple, une ouverture de crédit non utilisée ne constitue pas une créance saisissable du client contre sa banque, mais une simple promesse de prêt. De même, la jurisprudence a fermement établi que la faculté de rachat d’un contrat d’assurance-vie n’est pas une créance du souscripteur contre l’assureur. Tant que le souscripteur n’a pas exercé son droit de rachat, il ne détient qu’une prérogative personnelle, insaisissable par ses créanciers.
Distinction fondamentale entre créance certaine et créance éventuelle en saisie-attribution
La question de la saisissabilité des créances futures est au cœur d’un abondant contentieux. La jurisprudence, pour y répondre, a élaboré une distinction cardinale entre la créance certaine, même future, et la créance purement éventuelle. Cette analyse de la créance future doit être distinguée du régime spécifique applicable à la saisie des créances successives distinctes, comme les dividendes ou les redevances, qui posent des questions de saisissabilité différentes. L’enjeu est de taille : une saisie portant sur une créance jugée simplement éventuelle sera déclarée nulle pour défaut d’objet, ouvrant la voie à une contestation de la saisie, souvent à peine de nullité de l’acte.
Définition et portée de la créance certaine et de la créance éventuelle
Une créance, pour être saisissable, doit être certaine dans son principe au jour de la saisie. Cela ne signifie pas qu’elle doive être liquide et exigible ; en effet, l’art. L. 112-1 du CPCE admet expressément la saisie de créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Une créance certaine est donc une créance qui existe déjà, même si son paiement est différé (créance à terme) ou subordonné à la réalisation d’un événement futur et incertain (créance conditionnelle). À l’opposé, la créance purement éventuelle n’est qu’une simple expectative, une espérance de droit qui n’a pas encore d’existence juridique. La Chambre civile de la Cour de cassation a progressivement affiné son vocabulaire, abandonnant la notion ambiguë de « créance en germe » pour consacrer l’expression « créance éventuelle » afin de désigner cette simple potentialité, la rendant insaisissable. Elle a jugé, par exemple, qu’une saisie ne pouvait porter sur une créance dont la naissance dépendait d’un agrément ministériel non encore obtenu.
Résolution des contradictions jurisprudentielles sur les créances futures
La jurisprudence a parfois pu sembler contradictoire, affirmant d’un côté que le caractère « éventuel » d’une créance n’est pas un obstacle à la saisie, et de l’autre, qu’une saisie ne peut porter sur une créance éventuelle. Ces apparentes contradictions se résolvent par une analyse fine du critère de la certitude. Le débat doctrinal a été vif, certains auteurs plaidant pour une saisissabilité large des créances éventuelles, arguant par analogie de la vente des choses futures ou de la souplesse de la cession Dailly. Cependant, la position majoritaire, consacrée par la Cour de cassation, maintient une ligne de partage stricte. La justification profonde de cette distinction réside dans la protection du tiers saisi. On ne peut lui imposer les contraintes d’une saisie alors même que son obligation envers le débiteur n’est pas encore née. L’acte de saisie signifié par l’huissier de justice ne peut avoir pour effet de contraindre un tiers à s’engager ou à payer une dette qui n’existe pas encore dans son principe.
Les critères jurisprudentiels de la certitude : acte ou fait juridique générateur
Pour distinguer la créance certaine de la simple expectative, la jurisprudence a recours à un critère fondamental : la créance doit trouver sa source dans un acte ou un fait juridique déjà accompli au jour de la saisie. C’est l’existence de ce fait générateur qui ancre la créance dans le patrimoine du débiteur et la rend saisissable.
La créance née d’un acte juridique existant (conditionnelle ou à terme)
Lorsqu’un contrat est valablement formé, il fait naître des obligations et donc des créances. Peu importe que ces créances soient affectées de modalités. Une créance à terme, dont seule l’exigibilité est reportée, est parfaitement saisissable. Il en va de même pour la créance conditionnelle. Par exemple, la créance d’indemnité d’assurance naît dès la conclusion du contrat, bien qu’elle soit soumise à la condition suspensive de la survenance du sinistre. De même, une créance de restitution de fonds affectée d’une condition est saisissable. Le créancier saisissant devra simplement attendre la réalisation de la condition pour en obtenir le paiement. En revanche, tant que le partage n’a pas eu lieu, un coïndivisaire ne détient qu’un droit éventuel sur les biens en indivision, et non une créance certaine sur une somme d’argent.
La créance née d’un fait juridique consommé
Une créance peut également naître d’un fait juridique, tel qu’un délit ou un quasi-délit. La créance en réparation d’un préjudice naît dès la survenance du fait dommageable. Elle est donc certaine dans son principe et saisissable, même si son montant n’est pas encore fixé par une décision de justice. Le jugement viendra simplement liquider la créance, mais ne la créera pas. De même, la remise d’une somme d’argent à un tiers (notaire, banque) à charge de la restituer au débiteur fait naître immédiatement une créance de restitution saisissable. La saisie pratiquée avant cette remise serait cependant sans objet, car la créance n’existerait pas encore.
Cas complexes et nuances jurisprudentielles : autorisation, volonté et contradictions apparentes
La détermination de l’existence de la créance se complexifie lorsque sa naissance dépend d’un élément extérieur ou de la volonté de l’une des parties. Ces situations-limites ont donné lieu à des précisions jurisprudentielles essentielles.
Créances soumises à autorisation administrative ou judiciaire
La jurisprudence distingue nettement la créance conditionnelle de celle soumise à une autorisation. Lorsqu’un acte juridique est subordonné, pour sa validité même, à une autorisation administrative (agrément ministériel, décision préfectorale) ou judiciaire (autorisation du juge des tutelles), la créance qui en découlerait n’a aucune existence juridique tant que l’autorisation n’a pas été accordée. Par exemple, le prix de cession d’un office notarial n’est pas saisissable avant l’agrément du Garde des Sceaux. De même, une indemnité agricole soumise à une décision préfectorale n’est qu’une espérance tant que l’administration n’a pas statué.
Créances dépendant d’une manifestation de volonté du débiteur
Une créance dont la naissance est suspendue à une décision volontaire du débiteur ou du tiers n’est pas une créance certaine, mais une simple faculté. Elle échappe à la saisie-attribution. L’exemple typique est celui de la promesse unilatérale de vente : le bénéficiaire de la promesse ne devient débiteur du prix qu’au jour de la levée de l’option. Avant cette date, le promettant ne détient contre lui aucune créance saisissable. De même, le droit de l’associé aux dividendes ne se transforme en créance certaine contre la société qu’après la décision de l’assemblée générale de distribuer les bénéfices. Avant cette décision, il ne s’agit que d’un droit social, une vocation aux bénéfices, et non d’une créance de somme d’argent.
L’impact des réformes et mécanismes spécifiques sur la saisissabilité des créances futures
Le droit commun de la saisie-attribution, rigoureux quant à la certitude de la créance, est parfois assoupli par des mécanismes spécifiques ou influencé par le contexte particulier des procédures collectives.
La cession Dailly et la saisissabilité des créances futures
La cession de créances professionnelles, régie par la loi dite « Dailly », offre une souplesse bien plus grande que la saisie-attribution. Ce mécanisme permet à une entreprise de céder à un établissement de crédit des créances futures ou même simplement éventuelles, résultant d’un acte « à intervenir ». La loi Dailly offre une souplesse notable, car les mécanismes de la cession Dailly permettent de mobiliser des créances futures ou simplement déterminables, contournant certaines rigidités de la saisie-attribution. Cette cession peut même être consentie à titre de garantie pour un crédit. La validité de la cession de créances simplement éventuelles s’explique par la nature de l’opération, qui reste le plus souvent cantonnée aux rapports entre l’entreprise et sa banque, sans que le débiteur cédé en soit notifié tant qu’aucun incident ne survient.
Saisissabilité des créances futures dans le contexte des procédures collectives
L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire) à l’encontre du débiteur a un impact direct sur la saisissabilité de ses créances. Le jugement d’ouverture gèle le passif et interdit toute nouvelle inscription de sûreté. Une saisie-attribution pratiquée après le jugement d’ouverture serait nulle. Concernant les créances futures, la question est de savoir si elles sont nées avant ou après le jugement. La jurisprudence considère qu’une créance issue d’un contrat conclu avant le jugement d’ouverture est née à cette date, même si son exécution est postérieure. En matière de cession Dailly, le cessionnaire peut se prévaloir de la cession de créances futures, même nées d’une activité poursuivie après le jugement, si le bordereau de cession est antérieur à la date de cessation des paiements.
Rôle et responsabilités du tiers saisi face aux créances futures et conditionnelles
Le tiers saisi, souvent un établissement bancaire ou un notaire, est un acteur central de la saisie-attribution. Ses obligations sont lourdes et sa responsabilité peut être engagée, particulièrement face à la complexité des créances futures ou conditionnelles.
Obligation générale de déclaration du tiers saisi
L’art. L. 211-3 du CPCE impose au tiers saisi une obligation de déclaration immédiate et précise envers le commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Il est tenu de fournir toute information pertinente sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi, les modalités qui les affectent (terme, condition) et les éventuelles cessions ou saisies antérieures. Cette déclaration est cruciale car elle fixe l’assiette de la saisie. Un manquement à cette obligation, que ce soit par un refus de déclarer, une déclaration tardive ou une déclaration inexacte, expose le tiers saisi à de lourdes sanctions. Après une mise en demeure, il peut être condamné à payer personnellement le montant de la saisie, ou à verser des dommages-intérêts au créancier qui aurait subi un préjudice.
Responsabilités spécifiques des banques et notaires face aux créances futures
Les banques et les notaires, en tant que tiers saisis, sont particulièrement exposés. La gestion de comptes bancaires ou de fonds détenus pour le compte de clients les place en première ligne. En pratique, les obligations de l’établissement bancaire en tant que tiers saisi sont mises en œuvre sans avertissement préalable du débiteur, la dénonciation de la saisie au débiteur intervenant dans un délai de huit jours, ce qui souligne l’importance de sa déclaration précise. Une déclaration erronée sur la nature d’une créance (la qualifier de certaine alors qu’elle n’est qu’éventuelle, par exemple) peut engager leur responsabilité civile professionnelle. Le créancier, s’appuyant sur cette déclaration, pourrait poursuivre la procédure et se voir ensuite opposer la nullité de la saisie lors d’une contestation. Le préjudice résultant de cette procédure inutile pourrait alors être mis à la charge du tiers saisi fautif.
La distinction entre une créance certaine et une créance éventuelle est l’une des plus subtiles en droit de l’exécution. Face à la complexité de la jurisprudence et aux enjeux financiers, l’assistance d’un avocat expert en voies d’exécution est souvent déterminante pour sécuriser la mise en œuvre d’une procédure ou pour contester une saisie abusive. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de commerce